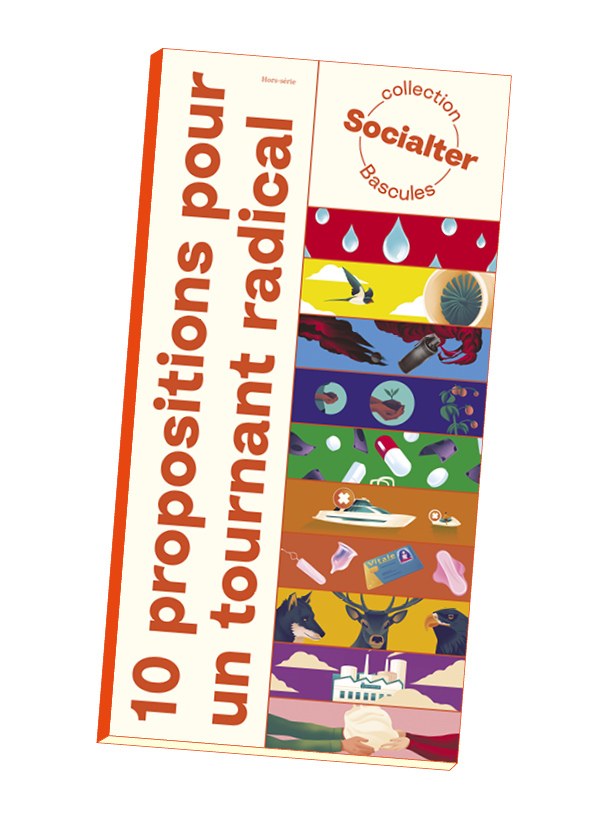La police ne cesse d’enflammer le débat public. À coups de matraque taylorisés, à tirs de LBD40 en série, à nuages de gaz lacrymogène épais, parfois même à croche-pieds mesquins, elle s’impose. Il n’est plus possible d’ignorer cette institution. Et pourtant, le débat public continue à largement occulter un ensemble de faits sur la police. S’enchaîne alors un cycle vicieux : à partir de diagnostics erronés sur les mécanismes à l’origine des violences et discriminations policières, les remèdes proposés produisent le même effet qu’un coup d’épée dans l’eau.
Texte à retrouver dans Bascules #3 - 10 propositions pour un tournant radical, en kiosque, librairie et sur notre boutique.
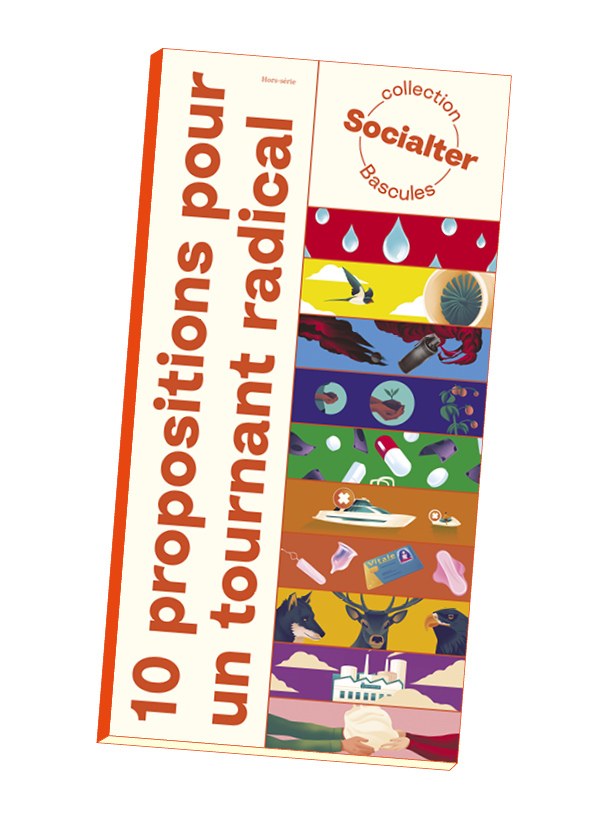
Les tenants de ce cycle vicieux demandent généralement un mélange de plus de formations, de plus de diversité et de nouveaux outils techniques comme des caméras-piétons ou des armes non létales « moins vulnérantes » (notez la beauté de la novlangue ministérielle) – sans se rendre compte que la police bénéficie déjà de moyens et d’effectifs records. Ici nous proposons d’explorer une autre piste, toute simple : s’intéresser à l’institution policière elle-même. Car, fondamentalement, on ne peut attendre des agents, dont elle configure le comportement, qu’ils renoncent à s’y conformer.
Panorama de l’activité policière : violences et discriminations
Posons tout d’abord les faits. L’année 2023 a été cadencée par le battement des matraques. La mobilisation contre la réforme des retraites a commencé avec un journaliste mutilé, elle s’est terminée avec ce que le gouvernement appelle pudiquement des réquisitions : des grévistes, éboueurs et raffineurs, ramenés au travail par des policiers. Entre les deux, 400 manifestants écologistes blessés à Sainte-Soline et trois mois de mouvement social avec une participation très élevée, qui est d’autant plus impressionnante que chaque nouvelle semaine de mobilisation apportait son lot de nouvelles vidéos et récits de violences policières. Tellement répandues et récurrentes, les violences policières ont fait l’objet d’une première estimation statistique à l’échelle du pays. Plus précisément, le rapport de l’Observatoire des Street-médics indique le nombre de manifestants blessés sur une courte période allant du début des « gilets jaunes » en novembre 2018 à la grève contre la réforme des retraites de 2019 1. Sur cette année, les forces de l’ordre ont blessé près de 25 000 manifestants. En ajoutant les effets du gaz lacrymogène, le compteur dépasse les 300 000 personnes, soit l’équivalent de la population de Montpellier.
« La police n’empêche pas le crime. C’est un des secrets les mieux gardés de la vie moderne. »
Une autre manière de rendre compte de l’explosion des violences policières consiste à retracer l’évolution du recours aux armes dites non létales – les balles en caoutchouc du LBD40, les différentes grenades explosives et lacrymogènes. D’environ 3 000 tirs annuels en 2009, la police est passée à 33 000 en 2018, et depuis le chiffre gravite autour de 12 000. Spectaculaire en soi, cette multiplication par quatre de l’usage de la force est d’autant plus édifiante que ni les manifestants ni la société dans son ensemble ne sont devenus plus violents. Les discours sur « l’ensauvagement » ou la « décivilisation » se heurtent là au mur des faits. Paradoxalement, les données suggèrent au contraire que le plus fort taux de croissance des menaces à l’intégrité physique et mentale de la population vient de ceux qui prétendent incarner la sécurité.
Les paradoxes sont féconds pour mieux appréhender la réalité. Poursuivons donc ce bref panorama des connaissances sur la police. Les travaux scientifiques sur cette dernière nous apprennent notamment qu’il « a été démontré que les stratégiesprincipales adoptées par la police moderne ont peu ou pas d’effet sur le crime » 2. L’auteur de ces propos, le politologue américain David H. Bayley, est une référence en la matière. Au bout de plusieurs dizaines d’années de recherche, il ne tourne plus autour du pot : « La police n’empêche pas le crime. C’est un des secrets les mieux gardés de la vie moderne. Les experts le savent, la police le sait, mais le public ne le sait pas. Pourtant, la police prétend qu’elle est la meilleure défense de la société contre le crime et argue en continu que, si elle obtient plus de ressources, en particulier des effectifs, elle sera en mesure de protéger la population contre le crime. C’est un mythe. » 3À l’inverse, le racisme institutionnel de la police est bien une réalité. En 2009, une étude française a mis en évidence ce que les habitants des banlieues savent depuis longtemps : « Selon les sites d’observation, les Noirs couraient entre 3,3 et 11,5 fois plus de risque que les Blancs d’être contrôlés » et les Arabes « couraient entre 1,8 et 14,8 fois plus de risques que les Blancs d’être contrôlés par la police (ou les douanes). » 4 Dix ans plus tard, le Défenseur des droits fait le même constat d’une « discrimination systémique » 5. De manière similaire, un ensemble de données pointent vers l’existence d’un sexisme institutionnel policier.
La discrimination, normalité institutionnelle
Le constat de ces violences et discriminations policières pose la question de leur origine. Car comprendre les fondements d’un phénomène est une étape indispensable pour altérer sa prévalence. En l’occurrence, les constats mènent dans la même direction : l’institution policière. À travers l’image de la citadelle assiégée, la recherche atteste en effet qu’elle fabrique des agents qui se sentent assiégés par la population. Les policiers tendent alors, en vertu de cette conception du monde qui leur est transmise au cours de la socialisation professionnelle, à considérer la population générale au mieux avec méfiance, au pire avec hostilité. Parmi les différents groupes de la société subissant des préjugés policiers particulièrement négatifs, on trouve les personnes se mobilisant dans le cadre de mouvements sociaux mais aussi la population non Blanche et – comme le suggèrent des indices concordants – les femmes. La particularité de la discrimination institutionnelle réside dans le fait qu’elle n’a pas besoin d’individus intentionnellement discriminatoires. Comme le souligne le sociologue Stuart Hall, les normes de comportement discriminatoires « sont portées au sein de la culture professionnelle d’une organisation et transmises de manière informelle et implicite par sa routine, ses pratiques quotidiennes en tant que partie indestructible de l’habitus institutionnel » 6.
« La police produit un “ repli clanique ” entre initiés, que les agents entretiennent ensuite tout au long de leur trajectoire professionnelle. »
La discrimination est donc une routine professionnelle, qui fait pleinement partie de ce qui est considéré comme le travail de police normal. En d’autres termes, l’institution transforme des individus qui, avant de franchir sa porte, ne faisaient pas nécessairement preuve de traitement inégal de leur entourage. La police produit un « repli clanique » entre initiés, que les agents entretiennent ensuite tout au long de leur trajectoire professionnelle : ils « n’hésitent pas à forger un récit vraisemblable pour couvrir un collègue ou justifier une action non conforme à l’éthique policière ou au protocole judiciaire » 7. En une phrase, la police se caractérise par une étanchéité extraordinaire vis-à-vis de l’extérieur et par une formidable cohésion intérieure. Dès lors on comprend mieux pourquoi l’origine sociale des policiers ne les rend pas sensibles aux revendications du mouvement ouvrier lors des mouvements de grève. Cet éclairage institutionnel permet également de comprendre pourquoi l’augmentation de la diversité de genre ou de race dans les rangs de la police ou encore la mise en place de formations ne pourra pas faire disparaître le racisme et le sexisme policiers. Par son fonctionnement même, l’institution annule les effets potentiels de telles réformes. Son histoire est d’ailleurs riche en exemples quant aux pratiques mises en œuvre pour éloigner les subjectivités policières de celles du reste de la population.
Trois pistes pour une gestion populaire de l’ordre public
L’histoire récente offre également d’autres renseignements qui peuvent constituer autant de points de repère pour une gestion de l’ordre public sans police. Dans cette optique, les pratiques populaires de l’Afrique du Sud et de l’Irlande du Nord de la deuxième moitié du xxe siècle méritent considération. Quelles que soient les insuffisances et difficultés réelles des deux cas, la leçon fondamentale est que leur existence même démontre la possibilité de gérer les conflits sans police. Regardons ces expériences de plus près. Estimant que la police n’assure pas la sûreté des personnes et qu’elle ajoute des déviances supplémentaires, les populations de ces deux pays ont mis en place une autre forme de régulation des différends. Sur le plan organisationnel, cette nouvelle forme de régulation illustre un certain nombre de garde-fous à mettre en place afin d’éviter le retour de ce qui caractérise précisément la police : la formation d’une institution en charge de la coercition, distincte de la société, au sein de laquelle les individus adoptent un esprit de corps extraordinairement prononcé. Parmi ces garde-fous on peut souligner trois éléments cruciaux : la rotation régulière des fonctions, le lien organique avec la communauté locale et la démarche de transformation sociale.
« La communauté locale était régulièrement appelée à s’exprimer sur la qualité du service fourni par les gestionnaires de l’ordre. »
La mise en place de la rotation est un levier central pour transformer la gestion de l’ordre public de métier en une simple fonction. Cette fonction est remplie par les membres de la population à tour de rôle pendant une durée limitée. Son effet principal consiste à court-circuiter la logique de l’impunité. Inutile de couvrir un collègue violent ou discriminant par esprit de corps ou espoir carriériste, car il n’y a pas de corps à protéger ni de carrière à poursuivre. À terme, tous les acteurs de la gestion de l’ordre public se retrouvent dans la société civile. Une fois de retour dans cette dernière, mieux vaut avoir fait preuve d’un comportement correct envers les autres. Le lien organique avec la communauté locale est un autre marqueur central de la gestion populaire de l’ordre public.
Cette vision du local permet au passage de jeter une nouvelle lumière sur l’idée de police de proximité. Si le débat autour de ce type de police supposément plus à l’écoute de la population surgit avec une régularité impressionnante, c’est précisément parce qu’à l’échelon local ce réseau dense de liens sociaux et de connaissances interpersonnelles encadrant un espace circonscrit est une source de pouvoir extraordinaire. Comme l’écrit le sociologue Nikolas Rose, « la communauté n’est pas simplement un territoire au sein duquel le crimedoit être contrôlé, elle est un moyen de contrôle » 8. Au fond, la police de proximité représente une appropriation policière des connaissances et liens qui organisent la vie quotidienne à l’échelon local. Cette appropriation conduit à terme à la désorganisation des relations de confiance sur lesquelles ces mêmes connaissances et liens sont construits. Autrement dit, la police de proximité repose sur une logique autodestructrice qui tend à emporter avec elle les solidarités qui unissent la population d’un endroit donné.
Entre les lignes, cette critique de la police de proximité laisse néanmoins transparaître un potentiel émancipateur contenu dans l’échelon local. Lisons la suite des propos de Rose sur la communauté locale : « Ses connaissances détaillées sur elle-mêmeet les activités de ses habitants sont à utiliser, ses liens, relations,forces et affiliations sont à célébrer, ses centres d’autorité et méthodes de résolution de conflit sont à encourager, nourrir, façonner et instrumentaliser pour améliorer la sûreté de chacun et de tous. » 9 En reconnaissant le pouvoir de la communauté locale, le débat autour de la police de proximité permet donc, malgré lui, de mieux comprendre la portée des pratiques sud-africaines et nord-irlandaises. En effet, dans les deux cas ce pouvoir a été mis au service de la communauté locale et, de surcroit, il y a été soumis à un contrôle démocratique. Car la communauté locale était régulièrement appelée à s’exprimer sur la qualité du service fourni par les gestionnaires de l’ordre. Le lien organique avec la communauté locale permet donc d’introduire une dose de démocratie dans la gestion de l’ordre tout en s’intéressant réellement aux besoins de victimes et aux motifs des déviants. En parallèle, en plaçant les gestionnaires de l’ordre au milieu de la communauté locale, plutôt que de les garder dans une institution distincte, ce lien organique empêche la formation d’une vision policière de type citadelle assiégée.
Toutefois, les difficultés des expériences sud-africaines et nord-irlandaises ne sont pas à balayer d’un revers de main. Parmi ces difficultés, on trouve un traitement des actes déviants peu cohérent, un manque de ressources, des responsabilités insuffisamment déterminées, le défi d’assurer l’ordre sans tomber dans la surveillance entre habitants du même quartier et le risque d’idéaliser la communauté locale. Ces problèmes indiquent que l’application des exigences en matière de démocratie et d’égalité n’a pas été pleinement réussie. Mais il serait erroné d’attribuer les difficultés de la gestion populaire de l’ordre public exclusivement à une insuffisance d’organisation, tout en ignorant d’une part le contexte socio-économique et d’autre part la réaction étatique à l’autonomie politique des communautés locales. En effet, en plus de l’hostilité des États sud-africain et britannique, dans les deux cas les nouvelles institutions étaient débordées par l’ampleur des déviances produites par des sociétés traversées par des inégalités profondes.
Ce constat signale que la perspective selon laquelle le dépassement de la police doit s’inscrire dans un mouvement qui « cherche à transformer la société sans en même temps essayer de prendre le pouvoir d’État » 10 fait l’impasse sur les structures réelles du pouvoir politique. Cette position est répandue dans la discussion contemporaine aux États-Unis à propos de l’abolition de la police 11. Bien entendu, cette observation ne signifie pas pour autant que des pratiques favorisant une gestion de l’ordre sans police n’ont pas un potentiel immédiat de transformation sociale et individuelle. Mais sans desserrer la contrainte du pouvoir étatique et des rapports sociaux capitalistes sur lesquels il repose, ce potentiel restera condamné à décevoir ses propres ambitions.
Même si l’objectif de rendre la police obsolète était largement partagé dans la population, la police continuerait de s’imposer. La troisième piste consiste donc à penser en même temps l’organisation populaire de l’ordre public et la transformation sociale. Les tentatives de dépassement du capitalisme au cours du xxe siècle montrent en effet que la libération de ce mode de production ne suffit pas pour bloquer la réémergence d’institutions oppressives. Il s’ensuit qu’une transformation socio-économique ne peut être découplée de l’effort de bâtir une nouvelle forme de gestion collective des différends sur un fondement émancipateur à même d’infuser dans les interactions quotidiennes. •
1 Rapport disponible sur le site obs-medics.org
2 David H. Bayley, Police for the Future, Oxford University Press, 1996.
3 Ibid, p.3.
4 Fabien Jobard et René Levy, Police et minorités visibles : les contrôles d’identité à Paris, Open Society Justice Initiative, 2009. p. 10.
5 Voir le site juridique.defenseurdesdroits.fr
6 Stuart Hall, « From Scarman to Stephen Lawrence », History Workshop Journal, no 48, 1999, p. 195.
7 GenevièvePruvost, « Enquêter sur les policiers »,Terrain. Anthropologie & sciences humaines, no 48, 2007.
8 Nikolas Rose, « Government and Control », The British Journal of Criminology, vol. 40, no 2, 2000, p. 329.
9 Nikolas Rose, op. cit., p. 329.
10 Kristian Williams, Our Enemies in Blue: Police and Power in America, AK Press, 2015.
11 Rachel Herzing, « Big dreams and bold steps toward a police free future », truthout.org ; Mariame Kaba, We do this ’til we free us, Haymarket Books, 2021 ; Derecka Purnell, Becoming Abolitionists, Verso, 2021.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don