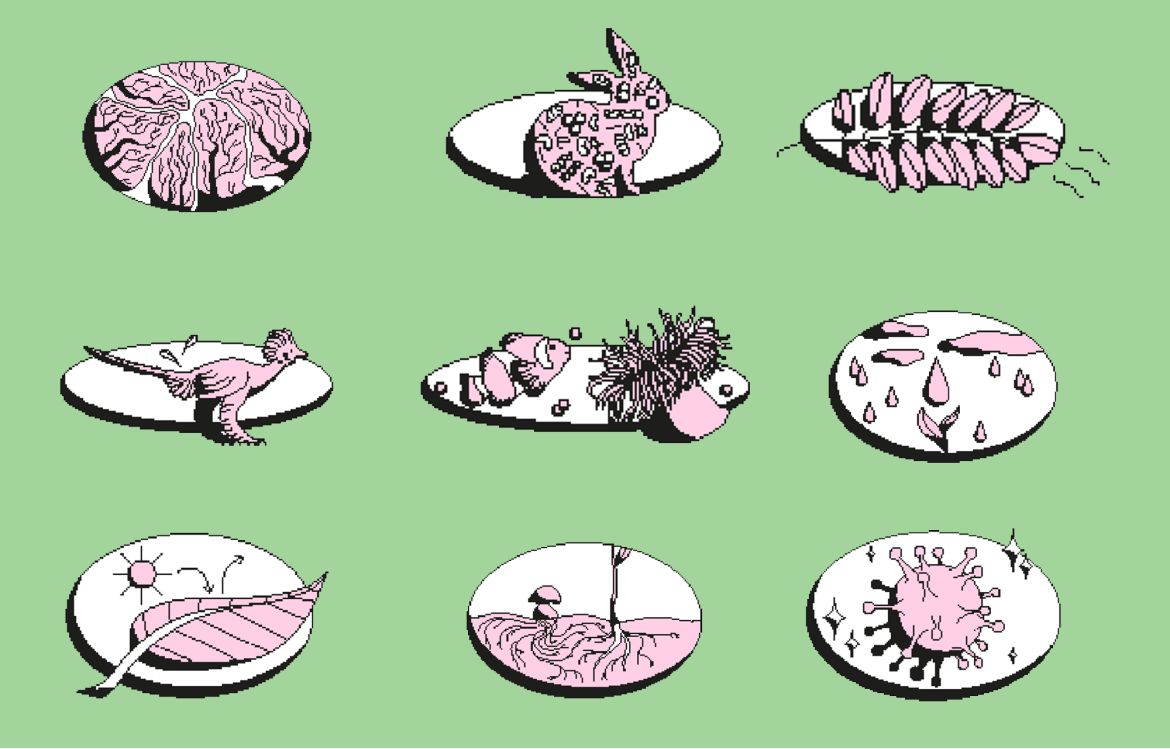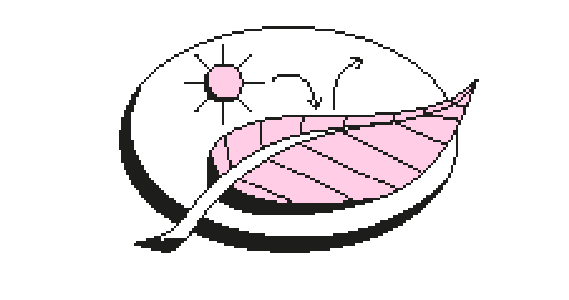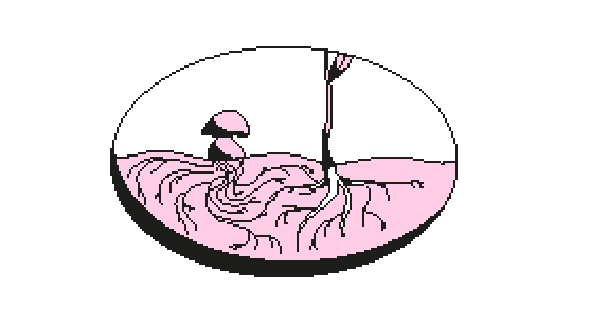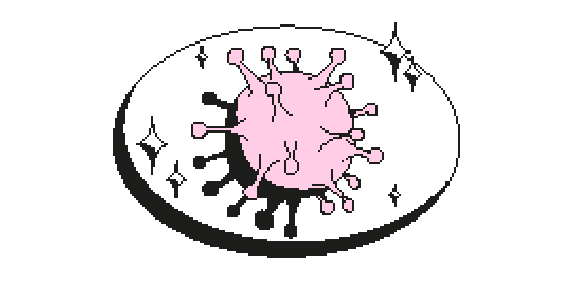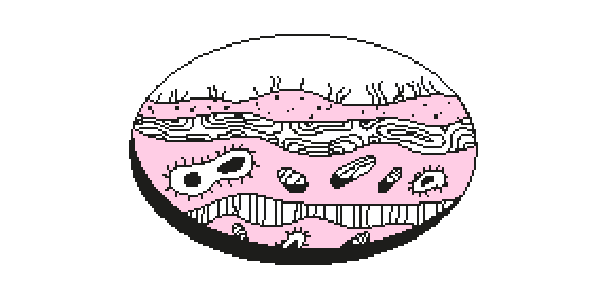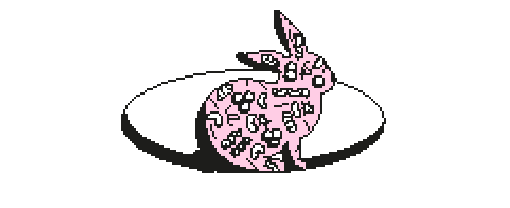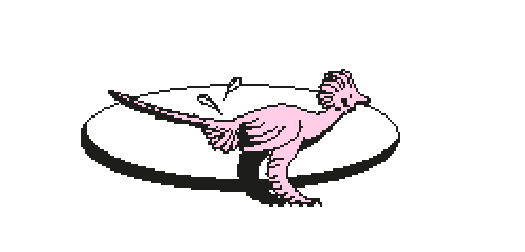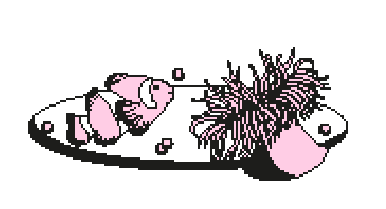Les bactéries glaçogènes : le pouvoir de faire pleuvoir
Durant des millénaires, les humains ont sans cesse cherché des moyens de combattre les épisodes de sécheresse en invoquant les nuages et leur divine pluie. Malheureusement, aucune danse, prière ou incantation n’est en mesure de provoquer des précipitations. Ce pouvoir magique existe pourtant bel et bien sur terre : il est entre les mains d’une bactérie que l’on appelle pseudomonas syringae. Il n’est pas rare de croiser ces micro-organismes – présents à l’origine sur les plantes – en suspension dans l’atmosphère, à plusieurs milliers de mètres au-dessus de nos têtes. Ces bactéries sont en fait arrachées à la surface de la Terre par la puissance des vents et sont ensuite trimbalées sur de longues distances par les courants aériens.
Entre les rayons UV et les basses températures, la vie dans les nuages n’est pas de tout repos. Alors, à défaut de subir les lois de la gravité, pseudomonas syringae revient sur terre grâce à la pluie et à la neige. Ces micro-organismes ont en effet la particularité de favoriser la formation de cristaux de glace, sur lesquels les gouttes d’eau vont s’accumuler jusqu’à se transformer en nuage. C’est ce que l’on appelle la « bioprécipitation » : des chutes de pluie d’origine bactérienne. Une fois entraînées par la pluie, les bactéries retombent parfois sur des plantes, et le cycle peut continuer. Au-delà de pseudomonas syringae, les scientifiques se posent donc la question de savoir si l’existence de bactéries dites « glaçogènes » n’est pas le résultat de la sélection naturelle – et si fabriquer des nuages n’est finalement pas le meilleur moyen de rester confortablement sur terre.
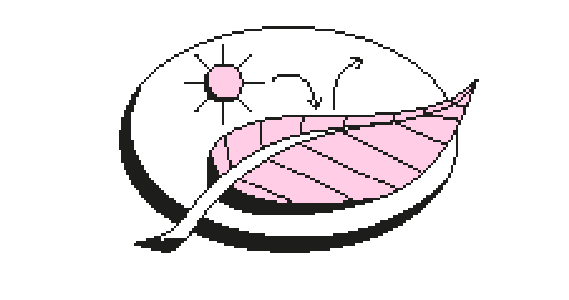
Les feuilles, plus divines que le soleil ?
Lointain souvenir de nos cours de biologie, la photosynthèse est le mécanisme de base par lequel les plantes – algues y compris – transforment le dioxyde carbone (CO2) en oxygène. Plus précisément, il s’agit pour les végétaux de créer de l’énergie sous forme de sucres, à partir de la lumière émise par le soleil, de l’eau puisée dans le sol et du carbone capté dans l’atmosphère. Jusque-là, rien de bien nouveau. Mais vous êtes-vous déjà interrogé sur ce qu’il y a de prodigieux là-dedans ? En premier lieu, ce mécanisme rend possible l’existence d’organismes « autotrophes ». Tandis que les hétérotrophes ont besoin de dévorer d’autres êtres vivants (végétaux ou animaux) pour survivre, les plantes, elles, se contentent de manger du soleil, de l’eau et de l’air.
Ce qui permet au philosophe Emanuele Coccia de remarquer dans La Vie des plantes, une métaphysique du mélange (Rivages, 2016) : « La vie se présuppose elle-même, ne produit qu’elle-même. Les plantes, elles, représentent la seule brèche dans l’autoréférentialité du vivant. » Le végétal n’a besoin de rien d’autre que du cosmos pour vivre. De la photosynthèse, Coccia en déduit donc une philosophie pleine de poésie et de mysticisme. Car, après tout, c’est bien ce mécanisme qui rend la terre habitable : ce sont les plantes qui produisent l’oxygène que nous respirons à chaque instant. Sans photosynthèse, plus d’inspiration possible, plus de souffle, la vie animale telle que nous la connaissons disparaîtrait. Le philosophe conclut alors : « L’origine de notre monde n’est pas quelque chose de stable ou d’ancestral, un astre aux dimensions démesurées, un dieu, un titan. L’origine de notre monde ce sont les feuilles : fragiles, vulnérables et pourtant capables de revenir et revivre après avoir traversé la mauvaise saison. »
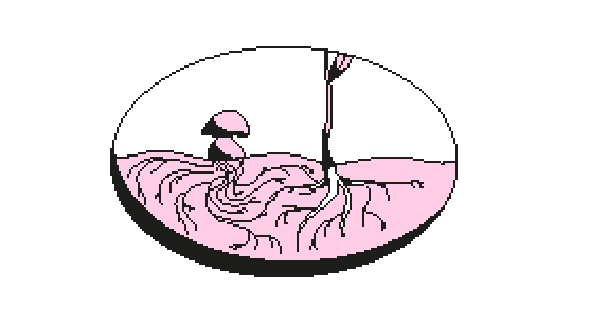
Les mycorhizes, le réseau que cache la forêt
Les arbres sont devenus depuis une dizaine d’années de véritables stars dans les médias et les librairies. La raison de ce succès tient en partie dans une étrange relation de symbiose entre champignons et plantes : les mycorhizes. Pourquoi une telle fascination ? Parce que les mycorhizes confèrent aux arbres des pouvoirs remarquables, à commencer par celui d’améliorer grandement leur capacité à absorber de l’eau et des minéraux. Le principe est assez simple : un champignon du sol colonise les racines de l’arbre et se fixe dessus, il « fusionne » en quelque sorte avec, jusqu’à créer des extensions racinaires. Armé de ces racines « augmentées » qui décuplent sa surface de contact avec le sol, l’arbre améliore sa nutrition et ses capacités d’absorption d’eau.
Mais là où la symbiose champignon/racine devient réellement fascinante, c’est qu’elle permet aux plantes de « communiquer » entre elles. Depuis plusieurs années, la recherche en biologie s’intéresse de très près à ces réseaux mycorhiziens, que l’on surnomme parfois le Wood Wide Web (l’Internet des arbres, en référence au World Wide Web). Ce réseau offre aux arbres la possibilité d’échanger des nutriments entre eux, mais il leur permettrait également de se transmettre des signaux d’alerte en cas d’attaque. Lorsqu’un arbre est agressé par un parasite, il pourrait prévenir ses congénères auxquels il est relié grâce aux mycorhizes, et les inciter par exemple à produire des toxines pour se protéger de l’assaillant. La Vie secrète des arbres, best-seller du forestier allemand Peter Wohlleben (parfois critiqué pour avoir un peu enjolivé et romancé les travaux scientifiques), aura eu le mérite de révéler qu’un lieu aussi insignifiant que le sous-bois à côté de chez nous demeure une terra incognita pour la connaissance humaine.
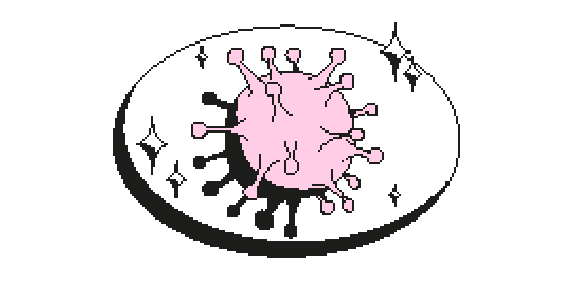
Ce que le placenta doit aux virus
En période de pandémie, il est bon de le rappeler : les virus ne sont pas exclusivement néfastes pour l’humain (lire notre article p. 42). On leur devrait même une faculté indispensable à notre reproduction : la formation du placenta. Cette « poche » qui garantit la formation du fœtus doit en effet, selon certaines conclusions de scientifiques, son apparition à une infection virale chez nos ancêtres, il y a des dizaines de millions d’années. L’infection par un rétrovirus, plus précisément, qui a la capacité de faire fusionner son enveloppe avec la membrane de la cellule à infecter, et d’intégrer son matériel génétique dans les chromosomes de l’hôte. Un de ces « piratages » aurait ainsi permis la fabrication de protéines (les syncytines) indispensables à la formation du placenta.
Ce phénomène, qui s’est répété au cours du temps, se serait transmis aux générations suivantes et aurait donc rendu possible l’existence des mammifères placentaires que nous sommes. Des chercheurs suggèrent même que les syncytines auraient conservé une propriété de leur ancêtre infectieux qui leur permet de « désactiver » temporairement le système immunitaire. Une activité immunosuppressive qui permettrait d’éclairer un des grands mystères de la biologie : le non-rejet du fœtus. Car porter un enfant dans son ventre n’a rien d’évident, compte tenu du fait que le génome du fœtus est en partie hérité du père et n’a donc aucune raison d’être reconnu par le système immunitaire de la mère. Paralyser temporairement et localement ce système immunitaire, comme sont capables de le faire les rétrovirus, laisserait ainsi le champ libre au placenta pour remplir à bien sa mission. La fonction des virus dans l’évolution ne se limiterait donc pas à sélectionner les individus en les tuant ou en les épargnant : ceux-ci compteraient aussi parmi les « architectes » du vivant.
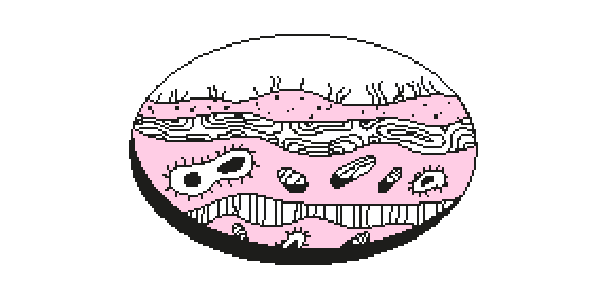
Intraterrestres : dans la nuit des zombies
Et si les véritables aliens tant fantasmés par les chasseurs d’ovnis se dissimulaient en fait sous nos pieds ? À quelques mètres de profondeur se cachent ceux que l’on appelle les « intraterrestres » : des tonnes de micro-organismes qui grouillent dans un environnement particulièrement extrême. Jusqu’à au moins cinq kilomètres sous la surface de la Terre, et dix kilomètres sous celle des océans, des formes de vie prospèrent dans cette « biosphère profonde » qui peut atteindre des pressions 400 fois supérieures à celle que nous connaissons à l'air libre. Sans lumière, sans oxygène, avec très peu de nutriments et subissant des températures qui avoisinent parfois les 120° C, ces organismes sont capables de vivre des milliers d’années.
Certains sont même qualifiés de « zombies » par les scientifiques : leur cycle de vie évolue à des échelles quasi géologiques, et ces créatures sont capables de survivre des dizaines de millions d’années en se nourrissant de l’énergie provenant des roches. Ce voyage au centre de la Terre, qui fascinait déjà Jules Verne en 1864, n’en est encore qu’à ses premières découvertes. En 2018, les scientifiques du Deep Carbon Observatory ont révélé les résultats d’une étude menée sur pas moins de dix ans, le temps nécessaire pour creuser et analyser des centaines de sites de forage. Selon leurs estimations, on y apprend que cette « matière noire microbienne » représente 70 % de tous les microbes présents sur Terre, soit entre 15 et 23 milliards de tonnes de carbone : 300 fois plus que la masse de carbone de tous les êtres humains vivant à la surface du globe. Bactéries, archées et organismes eucaryotes existent donc par millions sous nos pieds... et la plupart reste à découvrir.

Timidité des cimes : un mystérieux rhizome de ciel
La science est pleine de surprises : au détour d’un article particulièrement aride, il est parfois possible de tomber sur des formules qui font l’effet d’éclairs de poésie. Le concept de « timidité des cimes » en est un bon exemple. Les scientifiques parlent de timidité pour qualifier la relation qu’entretiennent entre eux certains arbres. On dit qu’une canopée est traversée par des « fentes de timidité », lorsque les arbres font en sorte de laisser un léger espace entre leurs hautes branches. Vu d’en bas, on peut donc deviner la couleur du ciel à travers ces branchages qui évitent soigneusement d’empiéter les uns sur les autres. Le spectacle ne cesse d’émerveiller les scientifiques, d’autant plus que, discutée depuis des dizaines d’années, l’explication de ce phénomène continue de nous échapper.
Interrogé sur le sujet en 2016, Francis Hallé, botaniste célèbre et contemplateur professionnel de la beauté des cimes, s’amusait de la situation : « On ne sait pas à quoi ça sert et on ne sait pas comment ça marche. Donc, ne grattez pas trop mes connaissances parce que vous allez vite toucher le fond… » Les biologistes ont d’abord pensé que cet espace servait à éviter l’abrasion des branches en raison du frottement. Hypothèse démentie, selon Francis Hallé. Deux autres possibilités sont donc évoquées : les fentes de timidité, qui laissent passer la lumière, seraient bénéfiques à la survie du sous-bois ; elles permettraient également de se protéger de certaines contagions de maladies ou d’insectes. Autre question et autre enjeu de taille : comment les arbres communiquent-ils entre eux pour éviter de se toucher ? Les scientifiques pensent que l’échange d’informations pourrait se faire par le biais de substances chimiques (les phytohormones) libérées entre les feuilles des arbres.
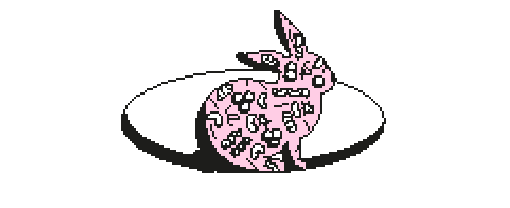
L’« holobionte » : there is only society
Notre intestin est rempli de plus d’un millier d’espèces de bactéries et de levures. Cela fait de nous des sortes de « superorganismes », et nous engage dans une relation avec des êtres vivants dont nous ignorons l’existence. On parle plus précisément d’holobionte (du grec holo, le « tout », et bios, la « vie »), pour désigner cette unité biologique composée d’un hôte et des micro-organismes qui l’habitent. Cet hôte peut être un humain donc, mais également un animal ou un végétal.
Ces interactions sont si importantes qu’il devient difficile de séparer strictement l’hôte de ses micro-organismes : l’holobionte forme un tout, qui rebat notre conception de l’individu. Chez l’humain, on dénombre ainsi plusieurs microbiotes : cutané, vaginal, buccal, intestinal, hérités d’une colonisation qui a lieu au moment de la naissance. Et un déséquilibre de ces microbiotes (on parle de dysbiose), s’il n’est pas nécessairement pathogène, ne laissera généralement pas l’hôte indifférent. La présence microbienne influence, de façon encore très méconnue, le développement du système nerveux chez l’humain. Certains organismes dans notre intestin favoriseraient des états dépressifs, d’autres réduiraient l’anxiété et le stress.
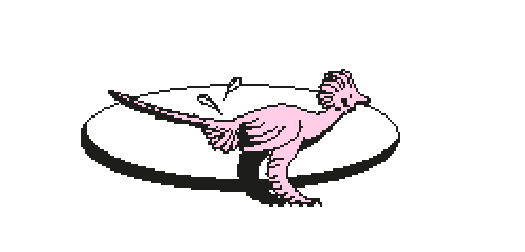
Quand les dinosaures recyclent leurs plumes
Et si les plumes d’oiseaux n’avaient pas été « inventées » pour voler ? C’est ce que l’on appelle l’exaptation : une adaptation sélective ne remplissant pas les fonctions qui lui sont attribuées à l’origine. Les premières plumes, apparues chez les dinosaures théropodes, auraient initialement été sélectionnées pour la thermorégulation (c’est-à-dire le maintien de l’organisme à une température idéale). D’autres scientifiques estiment même que le plumage coloré servait, à l’origine, aux parades sexuelles. Ce n’est que plus tard dans l’évolution que les ailes auraient été « détournées » pour voler. Comme si les espèces utilisaient ce qu’elles avaient sous la main à un instant donné pour créer, s’ouvrir de nouveaux horizons évolutifs. Le même caractère peut ainsi acquérir une fonction nouvelle qui se superpose à l’ancienne ou la remplace, ce qui remet en question notre conception classique de l’adaptation : les organes n’existent pas pour une seule et unique fonction définitivement établie par la sélection naturelle. Ils répondent certes à un entrelacs d’évolutions et de sélections successives, mais aussi de l’usage créatif qu’en font les espèces.

Végétaux stratèges : overdose et SOS
On imagine les plantes comme des organismes sans défense, car immobiles et vouées à subir les attaques de parasites en tout genre. Mais ce serait sous-estimer l’étendue des stratégies ingénieuses dont elles disposent, à commencer par la production d’armes chimiques. L’un des exemples les plus célèbres est celui de l’acacia et des antilopes. Dans les années 1980, le biologiste Wouter Van Hoven étudie la surmortalité des antilopes koudous dans un ranch d’Afrique du Sud. Il découvre que leur ventre est rempli de feuilles d’acacia, et que ces dernières sont bourrées de tanins. Van Hoven avance donc l’hypothèse que la concentration de cette substance dans les feuilles est un mécanisme défensif qui permet d’intoxiquer les koudous trop gourmands.
Il suffit que l’herbivore commence à s’en prendre à l’acacia pour que l’arbre libère ses toxines qui provoqueront l’overdose. Mais quand l’intoxication ne suffit pas, les plantes peuvent aussi demander de l’aide : en cas d’attaque de chenilles, une espèce proche du tabac (nicotiana attenuata) émet un signal chimique qui, en réagissant avec la salive de l’insecte, va attirer des punaises, alliées de circonstance dont le régime alimentaire inclut volontiers des larves de chenilles.
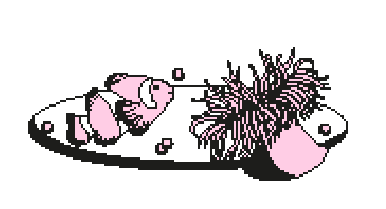
Mutualisme : l’union plutôt que la compétition
Contrairement à ce que l’on croit souvent naïvement, le principe sauvage de la « survie de l’espèce » ne conduit pas une guerre généralisée de tous contre tous. Le vivant regorge en réalité d’exemples de coopérations interspécifiques. On parle de « mutualisme » quand les deux espèces profitent de la relation qui les unit. Le poisson-clown et l’anémone de mer en sont l’illustration : les tentacules de cette dernière sont pleins de cellules urticantes qui lui permettent de se protéger des prédateurs, mais dans lesquelles le poisson-clown vient trouver refuge grâce à un mucus qui recouvre son corps et le rend insensible. En échange de cette protection à plein temps, l’anémone se nourrit des déjections de son hôte et profiterait même, selon certaines recherches, d’une meilleure oxygénation de l’eau la nuit, grâce aux battements de nageoires du poisson-clown. Un autre type de symbiose existe : le commensalisme, qui désigne une interaction entre deux espèces dont seule l’une des deux tire profit sans nuire à l’autre. Lorsqu’une espèce prospère au contact des activités humaines, on parle même de synanthropisme : c’est l’exemple bien connu des mouettes, rats, pigeons… liste à laquelle on se demande parfois s’il ne faudrait pas ajouter les chats !
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don