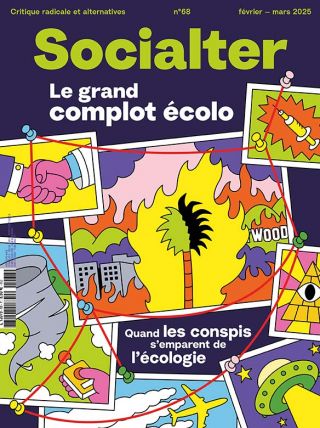50 kilomètres au nord de Nantes, la ferme de Derval, avec ses 85 vaches, ses 75 génisses et ses 105 hectares de cultures fourragères n’est pas une banale exploitation laitière : c’est une « digiferme ». Elle fait partie d’un réseau français de quinze sites expérimentaux dédiés à l’« agriculture connectée ». L’Institut de l’élevage, organisme de recherche appliquée, y mène des évaluations grandeur nature en collaboration avec des PME et des start-up du numérique.
Article issu de notre hors-série « Ces terres qui se défendent » avec le collectif Reprise de terres, disponible sur notre boutique.

L’ingénieure Amélie Fischer y pilote le test d’un système de « clôtures virtuelles ». « C’est le même principe qu’une clôture physique, mais tout est dématérialisé. Grâce à un collier muni d’un capteur GPS, l’animal est prévenu quand il s’approche de la clôture virtuelle, qu’il ne voit pas, par un son. Et si jamais il traverse et s’éloigne, il reçoit un stimulus électrique. »L’avantage est double, selon elle, pour l’éleveur : moins d’entretien et moins de déplacements. « Il a une application sur son smartphone, et comme les animaux sont tous géolocalisés, il sait en permanence où ils se trouvent. » À la ferme de Derval, Amélie Fischer supervise également le développement de capteurs reliés au réseau 4G pour la détection du « stress thermique » des bovins au pâturage. Une solution d’avenir, selon l’ingénieure, pour faire face à la multiplication des épisodes caniculaires. Le suivi à distance des animaux, souvent rebaptisé monitoring, a le vent en poupe. Parmi les nombreuses innovations connectées primées au salon international de l’élevage de Rennes en septembre 2022, on trouve même AIHerd, « L’intelligence artificielle qui surveille vos animaux ». Cette IA analyse 24 h/24 le comportement des bêtes grâce à des caméras placées dans l’étable. Et en cas de problème, AIHerd envoie des alertes sur le téléphone de l’éleveur.
La pompe à cash de l’AgriTech
Comme la plupart des entrepreneurs de l’« AgriTech », les créateurs d’AIHerd, sont membres de La Ferme digitale, une association créée en 2016 pour porter auprès des pouvoirs publics la voix des start-up qui associent « le vivant, le numérique et le savoir-faire industriel ». À la tête de ce lobby, on trouve un ancien de Decathlon, Jérôme Le Roy, créateur de l’application de météo agricole Weenat. Son vice-président, l’ingénieur Antoine Hubert, ancien d’AgroParisTech, a lui fondé Ynsect, une entreprisequi élève des scarabées dans des fermes verticales pour les transformer « en ingrédients premium à haute valeur ajoutée ». Plus ou moins « disruptives », les start-up de la « French AgriTech » ont levé de 2015 à 2021 plus de 2,5 milliards d’euros de financements, selon un rapport de La Ferme digitale présenté au Salon de l’agriculture 2022. Et elles promettent, d’ici à 2030, de faire sortir de leurs rangs dix licornes, des entreprises dont la valeur boursière dépasserait le milliard de dollars.
« Pour séduire les pouvoirs publics, les entrepreneurs de l’AgriTech ont recours à un argument imparable : l’urgence écologique. »
Conquis, l’ex-ministre de l’Agriculture Julien Denormandie se félicitait en octobre 2021 de cette « troisième révolution agricole » qui succéderait selon lui à la mécanisation puis à l’agrochimie du XXe siècle. L’État a ainsi mis 2,8 milliards d’euros sur la table 1 pour soutenir ces innovations combinant numérique, robotique et génétique, présentées comme indispensables pour faire face aux défis climatiques et environnementaux. À titre de comparaison, l’ensemble des aides à la conversion et au maintien en agriculture biologique engagées en France entre 2015 et 2020 représente 1,8 milliard d’euros, selon un rapport de la Cour des comptes de juin 2022.
« La Ferme digitale fait un lobbying actif, mais elle a peu d’efforts à faire, car l’imaginaire du progrès technologiqueest tellement répandu... », soupire Thomas Borrell, chargé de mission scientifique au sein de L’Atelier paysan, une coopérative qui défend l’autonomie technique des agriculteurs. Finançant en amont la recherche et développement des start-up et stimulant, en aval, les achats des agriculteurs par des plans de subventions, les appels à projets du ministère de l’Agriculture constituent selon Thomas Borrell « une véritable pompe à cash » pour les entrepreneurs de l’AgriTech. Star des salons agricoles, la start-up Naïo Technologies a ainsi obtenu en 2016 une subvention de 2 millions d’euros pour optimiser son robot désherbeur autonome Oz, puis un nouveau coup de pouce en 2020, pour boucler sa levée de fonds de 14 millions d’euros. Les automates siglés Naïo devraient bientôt se multiplier dans les champs grâce à une aide à l’investissement ouverte en mai 2022 aux exploitants agricoles : l’acquisition de robots désherbeurs figure en effet dans la liste des achats les plus généreusement aidés (40 % de la facture avec un plafond à 40 000 euros)...
Cette logique industrielle co-pilotée par l’État n’est pas neuve, rappelle l’ouvrage collectif Reprendre la terre aux machines(Seuil, 2021), écrit par des membres de L’Atelier paysan :« Depuis 1945, en France comme dans l’ensemble des pays “avancés” l’agriculture a été la fonction-support du développement industriel. Sa modernisation a servi à développer les marchés d’un certain nombre d’industries en amont et en aval de sa production. » Cette « escalade technologique permanente » est d’ailleurs stimulée par des dispositions comptables et fiscales qui permettent « de substantielles réductions d’impôts » et constituent pour les agriculteurs « une incitation pressante, qui peut aboutir à un turn-over accéléré et irrationnel du matériel ».
L’arnaque écologique de l’« agriculture de précision »
Pour séduire les pouvoirs publics, les entrepreneurs de l’AgriTech ont abondamment recours à un argument imparable : l’urgence écologique. Se réclamant de l’« agriculture de précision », ils prétendent en effet contribuer à la préservation du climat et de la biodiversité en permettant, par la collecte tous azimuts de données, de moduler le recours aux pesticides et aux engrais, et d’optimiser l’usage des ressources rares telles que l’eau. Comme le souligne l’économiste Hélène Tordjman dans La croissance verte contre la nature (La Découverte, 2021), le nouveau régime de capitalisme qui se met en place sous le nom de « croissance verte » ou de « bioéconomie » compte ainsi « répondre aux destructions provoquées par l’extension des marchés et le déferlement technique, par encore plus de marché et de technique ». Mais les chiffres avancés par les industriels, qui prétendent par exemple « réduire jusqu’à 80 % la dose de pesticides grâce à du dosage millimétrique », ne sont pas contre-expertisés par la puissance publique, dénonce Thomas Borrell. « On se fie aux données constructeur, exactement sur le modèle du scandale Volkswagen pour les voitures ! » Et comme les scientifiques travaillent main dans la main avec les industriels, dans le cadre par exemple de l’institut DigitAg, basé à Montpellier, « il n’y a aucun cordon sanitaire entre les intérêts privés et la recherche publique ».
Par ailleurs, l’extraction des métaux nécessaires à la fabrication de cette avalanche d’équipements connectés constitue un angle mort, tout comme leur consommation électrique ou leur probable obsolescence rapide. « On a cherché des travaux existants sur l’analyse en cycle de vie des équipements de l’agriculture de précision et de la robotique, explique le chargé de mission scientifique au sein de L’Atelier paysan. À notre grande stupeur, on a constaté qu’il n’y avait rien. Les chercheurs de l’Inrae qu’on a consultés ne pouvaient me renvoyer vers aucune étude. »
Surtout, cette écologisation de façade conforte la logique d’hyperspécialisation du modèle agricole conventionnel. « La robotisation, ça induit des systèmes simplifiés à l’extrême, dans lesquels il n’y a plus qu’une culture », commente le secrétaire national de la Confédération paysanne, Vincent Delmas, maraîcher et éleveur d’ovins dans la Drôme. « Or, si on veut bien utiliser les ressources, le mieux c’est de mêler les cultures et l’élevage. Les robots ne sont pas faits pour les systèmes complexes. »
Suppression du travail humain
Chez les agriculteurs, les trouvailles de l’AgriTech ne font pas forcément l’unanimité. « Quand on discute avec des jeunes issus des classes historiques paysannes, qui sont en enseignement agricole en ce moment, ils n’ont pas un attrait béat, mais plutôt une méfiance, et le réflexe de bon sens de se demander si le jeu en vaut la chandelle », relate Hugo Persillet, formateur de la coopérative L’Atelier paysan, et co-auteur de Reprendre la terre aux machines (Seuil, 2021).
Pour convaincre, les industriels promettent un meilleur confort de vie aux exploitants agricoles, souvent au bord du burn-out. « Plus de lait avec moins d’effort », c’est le slogan de la firme néerlandaise qui produit le robot de traite automatisé Lely Astronaut. Vincent Delmas, ne cache pas son scepticisme : « Il n’y a plus l’astreinte de la traite pour le paysan, mais il a toujours son téléphone à côté de lui pour lui dire que telle ou telle vache a un souci de température, ça peut sonner la nuit. Et il y a des pannes… » Parmi les témoignages compilés dans le rapport « Observations sur les technologies » 2, certains pointent les coûts cachés, de maintenance notamment. D’ailleurs, 5 % des éleveurs choisissent de revenir à une salle de traite classique. Et beaucoup se retrouvent « piégés par leur investissement et le remboursement qu’il impose », souligne le rapport, car un automate de traite coûte au minimum 150 000 euros. Pour David Millet, éleveur de chevaux de trait et membre de la Confédération paysanne, le technosolutionnisme est un leurre. « La demande des paysans, ce n’est pas d’avoir des machines qui facilitent le travail. Ce que veulent les paysans, c’est pouvoir travailler dans de bonnes conditions et être rémunérés pour leur travail. »
Il n’existe pas pour l’instant de chiffres précis sur le taux de pénétration des dernières technologies numériques dans l’agriculture française. Mais discrètement, dans certaines filières comme le lait, l’automatisation est bel et bien en marche. Selon des chiffres de l’Institut de l’élevage 3, en 2018, 5 573 fermes étaient déjà équipées de robots assurant ainsi la traite de 17 % du cheptel de vaches laitières. Le succès du dispositif tient surtout du gigantisme des fermes : avec des robots de traite automatisés et un réseau de capteurs connectés, une personne seule est en mesure de gérer des centaines de bêtes. Ainsi, comme l’explique l’ouvrage Reprendre la terre aux machines, « l’escalade technologique permanente, rarement perçue comme un facteur décisif, assure la poursuite du mouvement de dépossession et d’élimination des agriculteurs ». Réservé aux plus grosses exploitations, ce surcroît de capitalisation risque en effet d’alimenter le puissant phénomène de concentration déjà à l’œuvre dans les campagnes françaises. Depuis 2010, 100 000 fermes ont encore disparu et la taille des exploitations a augmenté de 25 %, selon un rapport de Terre de liens de 2022. « C’est encore balbutiant, mais ça peut aller très vite, craint Vincent Delmas, de la Confédération paysanne. À terme,on voit venir une agriculture sans paysans. »
1 Dans le cadre du plan d’investissement France 2030 (30 milliards d’euros au total) et du quatrième Programme d’investissement d’avenir.
2 Publication de L’Atelier paysan, 2021. Disponible sur commande sur le site de la librairie Quilombo.
3 Cités par le rapport « Observations sur les technologies ».
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don