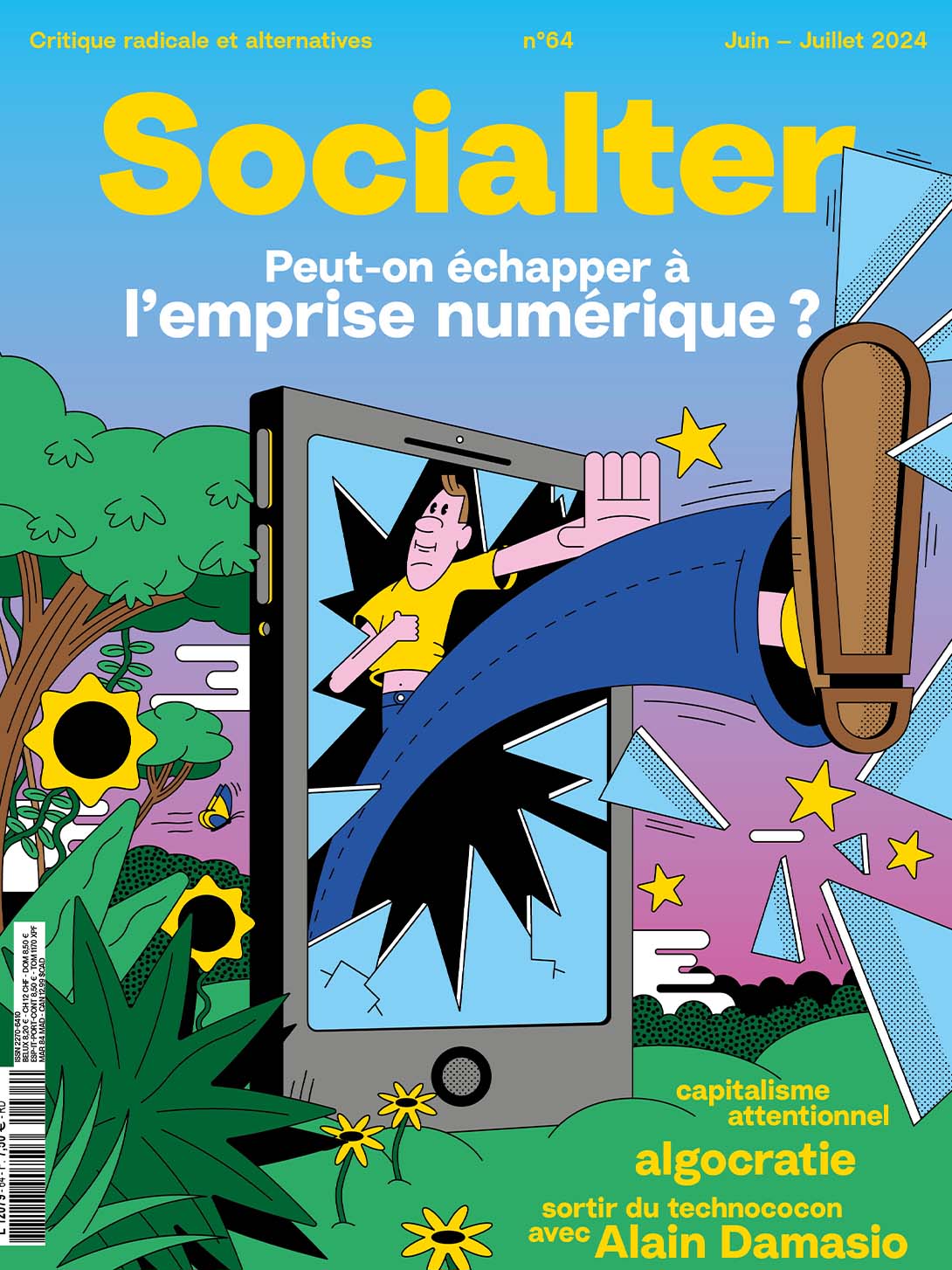Vous avez passé plusieurs mois dans la Silicon Valley, quelles ont été vos premières impressions en arrivant là-bas ?
À vrai dire, j’ai surtout été saisi par son côté extraordinairement banal et sa froideur. Cela m’a fait penser aux films de David Lynch, ces banlieues pavillonnaires, ce côté extrêmement quadrillé, dépourvu de centre. Tout est fake, tout est récent. C’est de l’industrie, ce sont des bureaux. Il y a bien les sièges des entreprises mais tu ne peux pas y entrer. Le Ring d’Apple c’est fascinant, on se rend compte que c’est totalement fictionné, pensé pour être vu du ciel, une vue de Dieu. Quand tu es dans le réel du Ring, c’est tellement vaste, tellement grand, que tu ne vois que des petits bouts de l’arc et c’est tout. C’est de l’architecture pour faire image. Ça ne veut rien dire, ce n’est pas à taille humaine.
Entretien issu de notre numéro 64 « Peut-on échapper à l'emprise numérique ? ». En kiosque, librairie et sur notre boutique. Abonnez-vous à partir de 3€/mois.
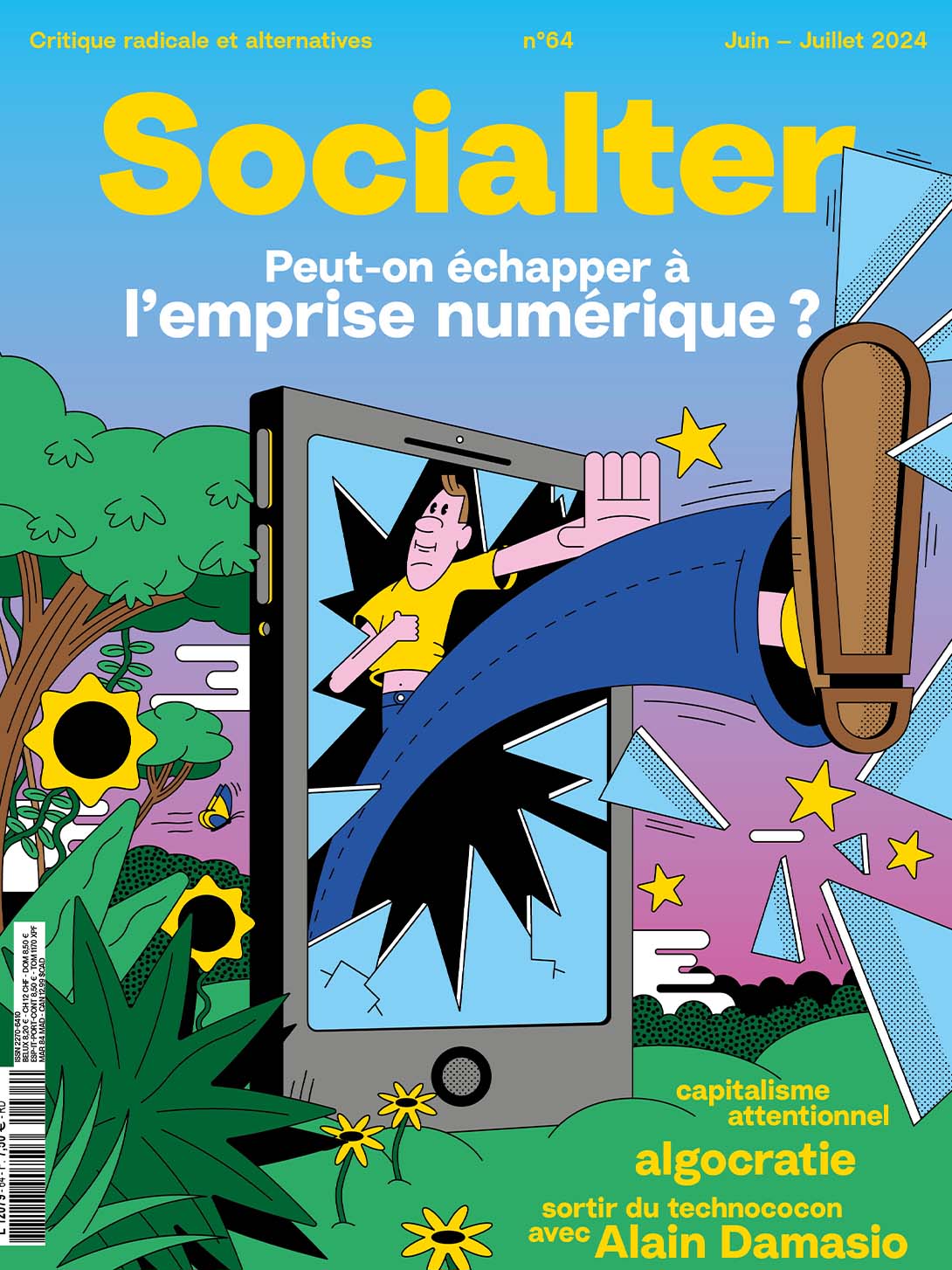
Métaphoriquement, dans la Silicon Valley, tu as l’impression de circuler sur un circuit imprimé, sur une carte mère. Tu es une forme d’électricité lente sur cette carte mère, un électron sur la Highway 101. Là-bas, j’ai aussi ressenti une forme d’individualisme bien plus déployée que chez nous. Ici, on se plaint de la perte des liens mais les liens sont encore là, il y a une convivialité, il y a un jeu social, comme l’écrivait Jean Baudrillard. Là-bas, on sent des monades qui circulent dans l’espace, on sent que le lien n’est pas naturel. Tu as l’impression que tout est une affaire de « dates », de rendez-vous, que tout est professionnalisé, inclus dans des sphères d’intérêt réciproques.
Une société moléculaire où rien n’est soudé, rien n’est lié. Pour moi, il y a là une analogie évidente avec le modèle promu par la Silicon Valley. Je suis convaincu que le biotope dans lequel tu vis au quotidien influence ta vision de l’avenir, ta vision anthropologique. Les entrepreneurs de la Silicon Valley pensent une technologie pour leur monde : être des monades professionnalisées, des travailleurs indépendants de niveau supérieur. Ils universalisent une expérience qui est très anglo-saxonne, très WASP. Et nous, nous vivons à travers ce monde-là. Leur froideur, ils nous l’envoient. Je suis fasciné par cette idée que la technologie, telle qu’ils la pensent, est toujours là pour faire le travail de lien que la société, les gens, ne font plus entre eux.
Votre ouvrage a une forte dimension anthropologique, pourquoi ce choix ?
C’est peut-être un peu prétentieux mais j’ai cette approche nietzschéenne qui consiste à penser le monde sans passer par aucun filtre, aucune aide et en faisant confiance à sa vision directe. J’avais toutefois avec moi le livre Amérique de Jean Baudrillard, publié en 1986. Amérique c’est 120 pages, mais c’est un nombre incroyable d’intuitions totalement prophétiques. Quand Baudrillard parle des joggers par exemple, ces gens qui font des allers-retours sur la plage jusqu’à l’exhaustion de leur corps avec leur casque sur la tête, il sent déjà que le corps est désincarné, qu’il n’est plus habité, qu’il n’est plus ressenti et que la compensation à ça c’est le fitness, c’est de soulever de la fonte, c’est de courir sur des tapis roulants…

Aujourd’hui, avec la tech, nous en sommes bien là. Body is meat. Pour les entrepreneurs de la tech, le corps n’est que de la viande, de la chair, ce n’est pas de l’information. Leur fascination ontologique c’est l’information, le système nerveux central, comme dans Ghost in the shell, tout le reste est balayé. Le corps, quand il reste, est un corps-machine où les données de monitoring sont là pour certifier qu’il existe encore. Quand tu en es à compter tes pas et tes kilomètres, c’est que tu ne comprends plus rien au corps, que tu es sorti du corps. Ce n’est plus le corps sensuel, sensitif, ce que j’appelle le « quatrième corps », celui des actes manqués, qui te rend amoureux, qui te rend fou.
Jean Baudrillard, dans Amérique, évoque aussi déjà notre rapport aux machines…
Il parle des gens qui se branchent sur la machine et créent une boucle entre la machine et eux-mêmes. Au lieu de vivre les expériences directement, il faut les filmer et les regarder pour qu’elles aient une existence. Il appelle ça le « stade vidéo ». Jean Baudrillard explique que ce n’est pas une affaire de narcissisme, c’est un problème de branchement à soi-même. En lisant ça, j’ai compris quelque chose. Tous ces gens qui prennent des selfies, qui se filment en soirée, qui partent en voyage et postent sur Instagram…
« Avec le numérique, on te vend du pouvoir, ce pouvoir de faire faire à la machine ce que tu pourrais faire directement. Pour moi, c’est un outillage de la paresse. »
En fait, il y a une telle désincarnation des corps, un tel sentiment de flottement dans nos existences, dans cette société liquide où nous circulons dans l’immatériel, dans les réseaux, que les liens ne sont pas vraiment ancrés, et la boucle vidéo, la boucle photo, le fait de passer par la machine, est une façon de re-territorialiser son identité, de ré-ancrer son identité, de tenter de se faire exister à travers la machine, la photo, le post qu’on envoie à l’autre. Comme si en faisant cela, l’autre allait pouvoir certifier qu’on existait bien, que le voyage était vraiment désirable. C’est comme si nous vivions dans une moindre existence et c’est l’aboutissement d’une société atomisée.
Quand tu vis dans des communautés où tu as une place définie, dans un village, quand tu travailles dans une boîte, tu es inscrit dans une trame très resserrée et tu n’as pas de problème pour savoir qui tu es. Et même si ça peut parfois être douloureux, tu as une existence.
À San Francisco, vous croisez des voitures autonomes, sans chauffeur, partout dans les rues. Vous écrivez qu’elles sont l’illustration parfaite du modèle techno-capitaliste, cette « poussée anthropologique » qui remplace la puissance par le pouvoir…
Avec la voiture autonome, nous n’aurons plus à conduire, nous pourrons déléguer ça à la machine. Avec le numérique, on te vend ça en permanence, on te vend du pouvoir, ce pouvoir de faire faire à la machine ce que tu pourrais faire directement, que tu faisais directement, et ce pouvoir doit être un soulagement. Pour moi, c’est un outillage de la paresse. On ne se pose pas assez la question de ce que cela nous fait en termes de puissance, de ce qu’on anesthésie. Il suffit de regarder le GPS, c’est une catastrophe cognitive. Tu vois tous ces gens qui ne sont plus capables de regarder une carte, de se dire « je tourne à droite puis à gauche »… Le dégât mental, cognitif, est bien plus grand que l’on ne le pense.

Ce sont des problèmes de spatialisation, des problèmes d’orientation, une capacité à comprendre le monde que tu n’as plus… En perdant tout ça, on perd beaucoup de capacités à penser. On nous vend aussi la voiture autonome en nous disant que cela libèrera du temps mais on a passé un siècle à libérer du temps et personne n’a plus le temps pour rien. Tout ce temps libéré a été ultra saturé par le numérique. Le numérique est une machine à accaparer le temps. Le néo--libéralisme numérique promettait de nous débarrasser de la bureaucratie mais c’est l’arnaque du siècle. C’est le contraire qui s’est produit. Répondre à des mails, remplir des formulaires, poster sur les réseaux... on passe son temps à travailler pour la machine.
Je pense aussi que nous sommes une espèce vraiment auto--aliénante et auto-addictive. Parmi les épiphanies que j’ai eues récemment, il y a la néoténie, cette idée, en biologie, que tu conserves à l’âge adulte des dispositions d’enfance. Dans les phases les plus structurantes de ta vie, dans ta jeunesse, tu te construis sur la dépendance à tes parents, à une communauté, tu n’es absolument pas autonome. Je n’avais jamais pensé de cette manière-là et cela peut expliquer beaucoup de choses politiquement. On prône l’émancipation, la liberté, mais on est ontologiquement construit autour de la dépendance. Donc le boulot à faire pour y parvenir est colossal.
C’est une façon d’expliquer pourquoi le techno-capitalisme parvient si bien à exercer son emprise…
La grande force du techno-capitalisme c’est d’avoir renoncé au régime disciplinaire et à la contrainte pour tout fonder sur le nudge, le coup de pouce, l’accompagnement des paresses et de la dépendance. Les entreprises technologiques ont maximisé toutes les structures de dépendance.
« On a passé un siècle à libérer du temps et personne n’a plus le temps pour rien. »
Elles ont mis des tonnes de psychiatres, de psychologues, de behavioristes et de comportementalistes pour façonner leurs modèles et c’est dix mille fois plus fort que les contraintes. Tu n’as plus besoin de personne, plus besoin de verticalité, tu peux oublier le régime féodal dont parlait Michel Foucault, le régime disciplinaire et la société contrôle. Il suffit de mettre en place des outils maximisés en termes de dépendance.
En écho à ces idées d’outillage des paresses et de dépendance, vous résumez la tech comme une « économie de désirs humaine », expliquez-nous.
Avec le techno-capitalisme, on joue sur la dépendance et les désirs. Il faut bien comprendre l’économie de désirs qui est derrière, chercher l’économie libidinale et saisir à quel point elle est puissante. Pour moi, il y a quatre grandes dynamiques. En premier lieu, il y a l’outillage de la paresse, la loi du moindre effort. Confort, paresse et fainéantise : 90 % des applications qu’on nous vend reposent là-dessus. Après, il y a le pouvoir, le pouvoir de faire faire à la machine. Il y a ce discours qui consiste à dire que la technologie c’est donner du pouvoir à l’espèce humaine pour agir sur le monde. Plus tu as d’applis, plus tu as de prise, et c’est un désir fantastique, d’autant plus pervers qu’on évolue dans des sociétés où on a de moins en moins de pouvoir. Le vote ne sert plus à grand-chose. Il n’y a plus d’alternance politique. Tu n’as plus la main. Ton pouvoir réel n’a jamais été aussi faible.
J’ai toujours été étonné de la vitesse à laquelle les milieux populaires se sont approprié les outils numériques. Mais dans les milieux populaires, précisément, tu subis ton patron, tu subis à l’école, tu subis les contrôles au faciès, tu subis une architecture de merde, tu es en cité, tu es dans un monde où tu n’as plus la main sur rien… Le seul moment où tu as la main, c’est quand tu as ton smartphone. Ce pouvoir-là, cette régie de contrôle, de maîtrise du monde, est extraordinaire. Après, dans ce mouvement général, il y a tout ce qui est de l’ordre de la conjuration, dans l’idée de se protéger. Pensons à tous les filtres qu’on peut mobiliser pour ne pas prendre un appel, y répondre plus tard, le mail et les messages qui sont asynchrones.

On réclame un techno-cocon toujours plus fort, plus épais, plus hermétique. On conjure tout ce qui est différent, toute forme d’altérité. Enfin, il y a cet antique désir d’être Dieu, ce projet transhumaniste de dépassement de la condition humaine, cela s’exprime en particulier dans le champ de la santé. Nous sommes sans doute la seule espèce à vouloir dépasser notre condition. On touche ici à la dimension grandiloquente, mégalo, de la tech. C’est une économie de désirs, et le cœur du storytelling et des récits de la Silicon Valley, ce que j’appelle la mythopoïèse, la fabrication de mythes.
Comment résister à ces technologies et à ces récits qui viennent puiser si profondément dans notre nature humaine ?
C’est hyper puissant, ce qui explique pourquoi ces trente dernières années nous avons été complètement broyés alors que les gens sont pourtant conscients de l’aliénation qui en découle. Pour battre le techno-capitalisme, il faut le battre sur le terrain du désir et c’est ce que j’essaie de faire, modestement, avec L’École des vivants. Travailler sur le lien, retisser des liens humains suffisamment riches, denses, pour qu’une soirée passée ici, où tu manges super bien, tu bois des bons vins, tu parles avec des gens qui sont créatifs, intéressants, ouverts parce qu’ils ont le temps et sont disponibles, il se passe un truc, tu reformes une étoffe où les liens qui sont créés sont des liens qui libèrent, des liens qui t’ouvrent, qui te rendent plus grand.
Car le néo-libéralisme a toujours vendu le contraire : les liens sont des chaînes, ils t’aliènent, la liberté ne peut être conçue que d’une seule manière et c’est la liberté individuelle, donc on te vend des services, des produits pour que tu accomplisses cette liberté individuelle. Il faut donc du lien humain, intense, incarné, retrouvé, avec cette dimension corporelle qui aujourd’hui est complètement dématérialisée. C’est une première réponse. La deuxième, pour moi, c’est le lien au vivant. On vit toujours avec le dualisme nature-culture. Je vois des gens qui arrivent ici, ils n’ont jamais cueilli un champignon, ils ne savent pas reconnaître un chant d’oiseaux ou trois arbres... le lien a été complètement coupé. Si tous ces liens sont retissés, re-tramés, tu retrouves de la puissance et c’est plus fort que le techno-capitalisme.
Il y a ce terrain du désir, du lien, mais vous évoquez aussi d’autres pistes, plus frontales si je puis dire : le sabotage et l’action directe face à l’hydre techno-capitaliste...
Je crois en l’action directe. La non-violence ne marche pas. Elle peut marcher si tu as 90 % de la population qui est impliquée. Ça a fonctionné avec les luttes d’indépendance, et même dans ces cas-là, tu avais une frange qui versait dans l’action directe. Aujourd’hui, on a une masse non violente qui correspond à 3 ou 4 % de la population. Il suffit de regarder les manifestations. On est sur des pourcentages infinitésimaux, même sur des sujets où 80 % des gens sont censés être d’accord, comme face à la réforme des retraites.
Donc ces méthodes-là, pour moi, c’est mort. La manifestation on la méprise, on roule dessus et Macron, s’il a accompli quelque chose en 10 ans, c’est bien d’avoir réduit à néant l’écoute de la manifestation comme principe d’expression populaire. Quand je parle d’action directe, on me répond que c’est radical mais ce n’est pas radical du tout. Avec les Gilets jaunes, il y a eu un peu d’action directe et les lignes ont bougé. Avec les Soulèvements de la Terre, c’est la même chose. Mais tout cela suppose d’avoir des gens hyper formés, qui ne communiquent pas numériquement, des groupes d’affinités très forts, qui se connaissent. Mais qui peut faire ça aujourd’hui ? Je crois qu’on ne sait plus faire. En tout cas, pour moi, un des premiers objectifs serait d’empêcher le fonctionnement de tous les entrepôts Amazon. Tous !

Amazon, c’est l’empire du mal dans toute son extension. Les droits sociaux bafoués dans l’entreprise, l’exploitation des travailleurs, l’évasion fiscale. Écologiquement, c’est une horreur. Tout le modèle est à jeter, il n’y a rien à sauver. Donc pourquoi ne pas bloquer les entrepôts et faire en sorte que le cours de l’entreprise en bourse s’effondre… Si on n’en passe pas par l’action directe, on va continuer à se faire enfoncer. Le réchauffement va être catastrophique, on va mettre des murs partout, on va flinguer les migrants climatiques, et on va avoir droit à des pouvoirs d’extrême droite partout.
Vous l’évoquiez précédemment, la Silicon Valley et les entrepreneurs de la tech continuent de jouer et de déployer le récit d’une technologie libératrice. Vous faites le lien avec le cyberpunk, ce genre littéraire né dans les années 1980, qui a porté – entre autres – le mythe de la libération. Dans le champ de la littérature, de la mythopoétique, quel récit peut-on lui opposer ?
La promesse d’accomplissement et d’épanouissement grâce à la technologie, portée par le cyberpunk, a été très puissante et c’est encore ce discours que porte la Silicon Valley. L’Apple Vision Pro (le casque de réalité augmentée d’Apple, ndlr) c’est toujours cette promesse d’émancipation, d’ouverture, de facilité. Mais cette promesse est morte, le couplage de l’individu avec la technologie n’a pas donné l’émancipation promise. Elle doit venir d’ailleurs, d’où l’idée du « biopunk », l’articulation de l’homme avec les forces du vivant, avec les biotopes végétaux, animaux, avec les rivières, la forêt, le maquis, le maraîchage. En somme, la capacité à retisser ces liens perdus, en mobilisant les connaissances éthologiques, biologiques et végétales nouvelles, dont on ne disposait pas il y a 15 ou 20 ans.
« Quand tu en es à compter tes pas et tes kilomètres, c’est que tu ne comprends plus rien au corps, que tu es sorti du corps. »
On comprend seulement aujourd’hui tout ce que le végétal peut faire, comment les arbres fonctionnent. Cette conscience laisse entrevoir de nouveaux liens possibles avec les espèces, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus fins. Les Furtifs est typiquement un roman biopunk. Baptiste Morizot, pour son prochain livre, travaille sur l’alliance avec les peuples castors et reprend cette idée géniale que les castors sont l’espèce ingénieure la plus apte à retenir et ralentir l’eau, à la faire circuler dans les nappes d’accompagnement, à éviter les inondations et les incendies. En découle l’idée de s’inspirer de ça et de faire des barrages castor-mimétiques. Cette alliance avec une force vivante qui sait gérer l’eau, c’est aussi du biopunk. Pour moi, renouer avec le vivant c’est la priorité, la clé, notre combat prioritaire.
La tonalité d’ensemble de votre livre est très technocritique mais on sent aussi chez vous une forme de fascination pour la technologie, en particulier pour ceux qui la font, les programmeurs notamment. Comment pourriez-vous qualifier votre critique de la technologie ?
Je suis auteur de SF donc bien sûr, la technologie me fascine. Je trouve ça délirant, je suis de près les développements de l’IA. C’est époustouflant, mais évidemment tu ne peux pas en rester là, dans une posture geek. Celles et ceux qui conçoivent les technologies sont passionnants, car ils sont souvent éclairés, capables d’utiliser la technologie dans toutes ces dimensions et de s’émanciper grâce à elle. Ils ne subissent pas. C’est pourquoi je parle de forger « un art de vivre avec les machines », d’être capable d’être un artisan face à ces technologies, dans une approche low tech, de pouvoir réparer, recycler, manipuler, recoder soi-même, d’apprendre aux gamins à comprendre tous les cycles de dépendance, à utiliser l’Open Source, à devenir des hackers.

C’est un vrai espoir, même si nous en sommes bien loin. Car ce que l’on voit poindre avec les IA est terrifiant. Je me rends bien compte que les IA vont totalement dévorer notre premier rapport au monde. Des IA personnalisées, bienveillantes, qui vont nous choyer, s’adapter à nous, à toutes nos perversions, nos paresses, ne jamais nous contredire, nous entretenir dans nos certitudes… Nous allons interagir avec elles en langage naturel, en leur parlant. Nous serons constamment là-dedans.
Et comme l’IA nous connaîtra parfaitement, s’adaptera à nos moindres désirs, tout le reste va nous emmerder. Discuter avec ses parents ou sa copine nous paraîtra fade. C’est terrifiant. Et je parle de choses qui vont arriver dans trois ou quatre ans, c’est très proche.
Alain Damasio
Né à Lyon en 1969, Alain Damasio est devenu l’un des écrivains français de science-fiction les plus influents. Paru en 1999, son premier roman, La Zone du dehors (éditions Cylibris), s’est vendu à plus de 150 000 exemplaires. En 2006, il remporte le Grand Prix de l’Imaginaire avec La Horde du Contrevent (La Volte, 2004), puis une nouvelle fois en 2020 avec Les Furtifs (La Volte, 2019). En 2021, il s’installe dans les Alpes-de-Haute-Provence et fonde l’École des vivants. Son dernier ouvrage Vallée du silicium (Seuil, avril 2024), est le fruit de ses réflexions lors d’un séjour dans la Silicon Valley.
L’École des vivants
Le lieu, fondé en 2021 par un collectif réuni autour d’Alain Damasio, se veut une zone d’expérimentations. Élevage, maraîchage, stages de théâtre, de clown, d’écriture ou de « polytique », résidence d’artistes et d’écrivains, cette école buissonnière entend retisser des liens intenses, entre humains et avec le vivant. Un lieu pour se transformer, individuellement et collectivement, et sortir du « techno-cocon ».
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don