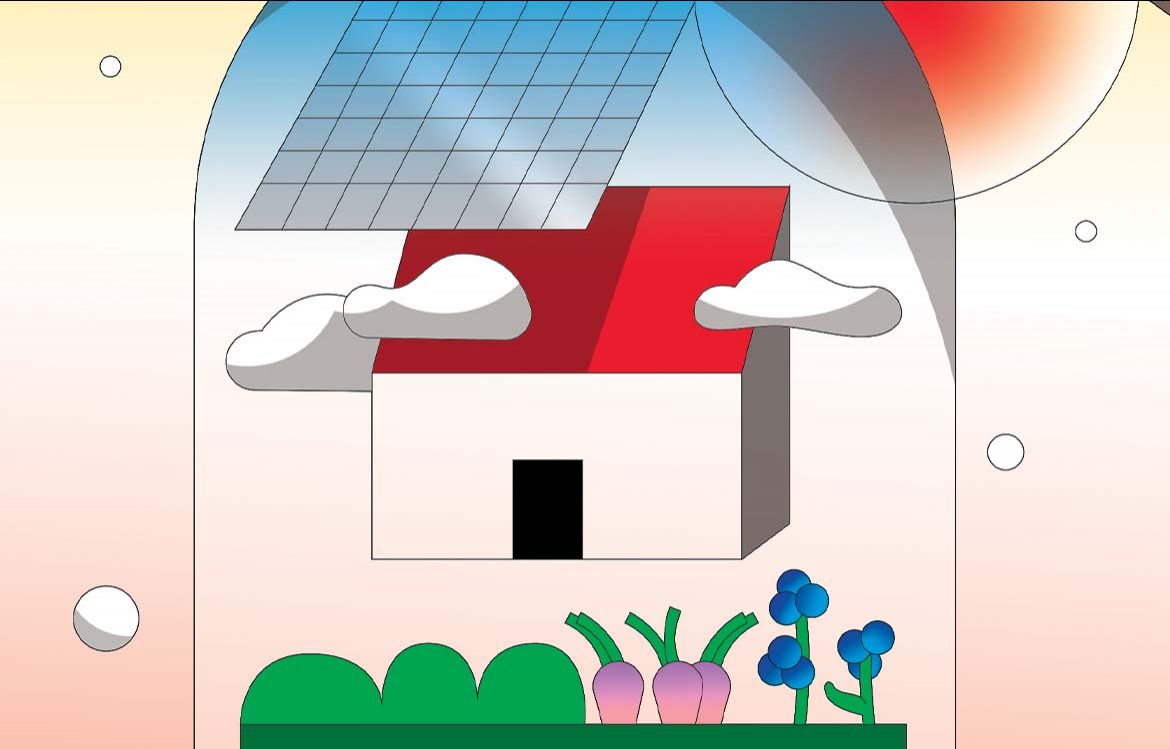Le 10 mai 2022 aurait dû être une cérémonie de remise de diplômes comme tant d’autres pour les élèves d’AgroParisTech, c’est-à-dire un moment convenu d’autocélébration et de fête. Mais, dans l’ambiance feutrée de la salle Gaveau, à Paris, huit élèves ont ce soir-là décidé de subvertir l’exercice en profitant de la tribune pour annoncer qu’ils n’accompliront pas les « jobs destructeurs » d’ingénieurs agronomes pour lesquels ils ont été formés : mécaniser, robotiser, industrialiser l’agriculture, trafiquer le vivant et éradiquer ce qui reste de pratiques paysannes. Ce n’est pas la première fois que des membres de l’élite, en l’occurrence des jeunes appelés à intégrer la technocratie, décident de « faire un pas de côté », de « bifurquer », de « déserter ».
Texte à retrouver dans Bascules #2 - Pour un tournant radical. Disponible sur notre boutique.

En réalité, c’est un geste de plus en plus fréquent, notamment dans le monde des ingénieurs et des diplômés, rongés par la mauvaise conscience de servir le capitalisme, un « monstre à bout de souffle » 1. Mais bien souvent, il s’agit d’un acte individuel présenté comme un « choix de vie » qui ne tient pas tant à des raisons politiques qu’à des préférences personnelles : avoir un métier qui a du sens, plus de temps à consacrer à ses enfants ou à ses hobbies, vivre dans un meilleur cadre de vie, etc. Là, il s’agit d’un acte collectif et public, appuyé sur de solides raisons éthiques, politiques et écologiques. Mais ce qui a fait événement, lors de ce mois de mai marqué par une vague de chaleur très précoce, c’est l’audience que le discours du collectif Des agros qui bifurquent a rencontrée. La vidéo de leur intervention a été visionnée des centaines de milliers de fois, révélant (à qui en doutait) que la désertion est désormais une tentation largement partagée, un spectre qui hante le monde industriel et progresse au même rythme que le désastre. Surtout, c’est que cet appel à déserter, c’est-à-dire à ne plus travailler pour un système en guerre ouverte contre la nature, va bien plus loin qu’un simple refus de collaborer : c’est un appel à combattre le capitalisme, et notamment à rejoindre les luttes en cours contre l’industrialisation de l’agriculture (le mouvement des Soulèvements de la Terre) et l’enfouissement des déchets nucléaires (le projet Cigéo à Bure).
Cet appel fait écho à mon propre parcours de vie et à mon essai Terre et Liberté qui en est le fruit. Né à Paris, je me suis lancé dans des études de sciences humaines, et plus spécialement de philosophie, qui m’ont fait passer par l’École normale supérieure et m’ont conduit à obtenir une thèse de doctorat, puis une habilitation à diriger les recherches. Pourtant, à la fin de mon doctorat, je ne me suis pas lancé dans la chasse aux postes : je me suis installé dans un village du Tarn, pour changer de vie. Car mes réflexions sur le capitalisme et le consumérisme m’avaient conduit à penser qu’il y avait quelque chose de pourri dans le mode de vie de « salarié-consommateur-électeur » que je menais, comme la plupart de mes concitoyens, à mille lieues des chasseurs-cueilleurs d’autrefois et même des paysans-artisans qu’avaient pu être nos grands-parents. Or, ce mode de vie pose problème sur tous les plans.
Mon engagement dans la mouvance altermondialiste m’avait fait comprendre qu’il repose en fait sur l’exploitation éhontée de la nature et des humains, même quand on ne participe pas directement à cette exploitation : tout ce que je consommais, de la nourriture aux vêtements en passant par les gadgets high-tech, était produit dans des conditions effroyables que je ne voudrais pour rien au monde endurer. Et même pour celles et ceux qui, comme moi, profitent plus de cette exploitation qu’ils n’en sont victimes, ce mode de vie suppose une bonne dose de domination comme salarié, d’aliénation en tant que consommateur et de dépossession comme électeur – tout cela masqué derrière la façade libérale de la « liberté de choisir ». Comme de plus en plus de gens désormais, j’aspirais alors à un mode de vie plus autonome, au sens matériel que ce terme a pris de nos jours.
Quand on parle d’autonomie alimentaire ou énergétique, il ne s’agit pas d’abord de « se donner nos propres lois » en tant qu’ensemble de citoyens, comme le veut l’étymologie, mais de « subvenir à nos propres besoins » en tant qu’êtres vivants. L’autonomie ne se limite donc pas aux règles de la coexistence juridico-politique, elle se joue aussi sur le plan de la subsistance et consiste à prendre en charge, au moins en partie, nos conditions de vie. Pour développer cette autonomie matérielle, je me suis lancé, comme y invitent les Agros qui bifurquent, à la rencontre de « personnes qui expérimentent d’autres modes de vie, qui se réapproprient des savoirs et des savoir-faire pour ne plus dépendre des monopoles d’industries polluantes ». Et c’est ainsi que je me suis retrouvé à la campagne, à faire des cultures vivrières et à me chauffer au bois, à découvrir le glanage et l’autoconstruction, à pratiquer l’entraide et le bricolage.
« Tout ce que je consommais, de la nourriture aux vêtements en passant par les gadgets high-tech, était produit dans des conditions effroyables. »
Plus j’avançais dans cette voie, plus je me posais de questions quant au sens de cette quête d’autonomie, qui est désormais dans l’air du temps. Car elle ne va pas de soi. Qui dit autonomie dit liberté : la plupart des dictionnaires posent les deux termes comme synonymes. Mais si la liberté est à l’origine liée aux luttes révolutionnaires contre les formes autocratiques ou oligarchiques de pouvoir, elle est aussi au cœur du libéralisme qui est la principale idéologie permettant de justifier le système capitaliste, profondément oligarchique et technocratique. Aujourd’hui, la confusion est totale. Le « capitalisme de surveillance », qui s’est développé sur la base des technologies numériques, sape la conception libérale de la liberté, « l’inviolabilité de la vie privée » 2.
Et dès lors que les élites dites libérales bafouent les principes de base du libéralisme, faut-il s’étonner de voir les forces illibérales de l’extrême droite autoritaire, en France et ailleurs, faire campagne sur la « défense des libertés » ? Le pire, à mes yeux, est que cette OPA sur la liberté par ses ennemis historiques est désormais acceptée par une bonne partie de la gauche, visiblement convaincue par Emmanuel Macron que la liberté est une valeur de droite, voire une invention du capitalisme, comme on a pu l’entendre depuis la mise en place du passe sanitaire en juillet 2021 de la part des partisans d’une gestion encore plus autoritaire de la crise liée au Covid-19. Car cela signifie que l’on s’est fait voler un mot essentiel de notre lexique politique, et que l’on vit désormais dans un monde orwellien qui n’hésite pas à claironner, comme dans 1984, que « la liberté, c’est l’esclavage ».
En ce qui me concerne, je pense qu’il est impératif de résister à ce rapt sémantique. Car les mots sont ce qui nous permet de penser, et dominer les pensées fait partie des moyens pour assujettir les populations, comme l’avait très bien compris Orwell. Pour résister à ce rapt, il faut toutefois repenser la liberté. En effet, comme divers auteurs l’ont montré, l’idée moderne de liberté, pensée comme arrachement à la nature, a contribué à nous mener dans l’impasse socio-écologique actuelle. On ne peut donc pas se contenter de défendre cette conception. Mais il ne faut pas croire non plus que, pour freiner le désastre, il faudrait restreindre les libertés et renforcer les prérogatives étatiques, par exemple en décrétant un « état d’urgence climatique ». Car les États ont toujours alimenté le développement économique et le désastre écologique, et les États autoritaires autant que les autres. Je me situe plutôt dans la tradition libertaire de l’écologie politique, qui s’est toujours définie, contre l’environnementalisme, par l’idée que la défense de la nature était étroitement liée à celle de la liberté – sans quoi l’on perdrait l’une et l’autre. Mais alors, comment penser cette liberté-autonomie ? En quoi se distingue-t-elle de la conception dominante de la liberté, au double sens de la conception la plus répandue à l’époque moderne et de la conception propre aux classes dominantes ? Et quel est le sens politique de cette aspiration à l’autonomie matérielle ? Est-ce seulement une lubie d’intellectuels en mal de tâches manuelles ?
La liberté comme délivrance
Pour répondre à ces questions, je me suis lancé dans une longue enquête sur le sens de la liberté, en me nourrissant de lectures très diverses, philosophiques bien sûr, mais aussi historiques, sociologiques, anthropologiques ou économiques. Et, peu à peu, je me suis rendu compte que la liberté ne se jouait pas seulement sur le plan des institutions juridico-politiques, comme on me l’avait enseigné, mais aussi de la vie quotidienne. Quand on cherche à définir la liberté, c’est en général d’abord son versant institutionnel qui est mis en avant : la liberté s’identifie à la démocratie (c’est la conception classique, héritée de l’Antiquité) et/ou au fait de jouir d’un certain nombre de droits (liberté de mouvement, de conscience, d’expression, etc.) qui définissent la sphère privée comme inviolable (c’est la conception moderne et libérale). C’est sur ce versant institutionnel que se focalisent la plupart des théories et des discours sur la liberté.
Mais si l’on y réfléchit de près, la liberté a aussi un versant matériel qui est rarement thématisé. Sur ce plan, elle se définit par le désir d’être délivré des nécessités de la vie quotidienne, c’est-à-dire des activités liées à la subsistance, jugées en général pénibles et ennuyeuses : produire sa nourriture, se procurer de quoi se chauffer, faire le ménage et la lessive, s’occuper de personnes dépendantes, construire et entretenir son habitat, etc. On n’est vraiment libre que lorsqu’on est libéré de ces « nécessités », au sens relatif de « choses à faire » tellement constitutives de notre mode de vie qu’on ne voit pas comment s’en passer. Au fur et à mesure de mon enquête, je me suis rendu compte que cette idée était au cœur de la plupart des conceptions de la liberté, que ce soit implicitement, comme dans les théories libérales focalisées sur les conditions institutionnelles de la liberté (la séparation des pouvoirs, les droits inaliénables, etc.), ou explicitement, comme chez les marxistes qui estimaient que la liberté supposait le dépassement du « règne de la nécessité » – raison pour laquelle ils convergeaient avec les libéraux dans la fascination pour le développement économique, scientifique et technologique censé libérer l’humanité des contraintes et des limites imposées par son inscription dans une nature qu’elle n’a pas faite.
En réalité, ce fantasme de délivrance nous traverse tous. Pourtant, cette aspiration si commune pose de nombreux problèmes. Car pour être délivré des nécessités du quotidien, il n’y a pas 36 solutions : soit on fait faire les tâches correspondantes à d’autres personnes, soit on les fait faire par des machines ou des robots. Or, ces deux options ont de lourdes implications socio-politiques et écologiques. Si l’on se décharge des nécessités de la vie quotidienne sur les épaules d’autrui, pour pouvoir se consacrer à des activités que l’on juge plus intéressantes ou réjouissantes, alors notre liberté repose en fait sur la domination. Car il faut alors faire faire à d’autres ces tâches dont on ne peut pas se passer, mais qu’on ne veut pas assumer soi-même. Or, « faire faire » est la formule même de la domination sociale, qui repose toujours sur la séparation entre les exécutants qui font et les dirigeants qui disent aux premiers ce qu’ils doivent faire, c’est-à-dire qui leur donnent l’ordre de faire des choses pour eux. De fait, l’histoire montre que les minorités dominantes se sont toujours débarrassées d’un certain nombre de tâches liées à la subsistance sur les groupes qu’ils dominaient, qu’il s’agisse des femmes, des esclaves, des serfs ou des ouvriers. Pour les Grecs anciens, qui n’estimaient pas que tous les humains étaient par nature libres et égaux, cela ne posait pas de problème : l’esclavage était la condition de la liberté. Mais dans l’Occident moderne, cette aspiration à la délivrance vient contredire la promesse de liberté universelle.
« La liberté ne se joue pas seulement sur le plan des institutions juridico--politiques, mais aussi de la vie quotidienne. »
C’est à partir de cette contradiction qu’il faut comprendre les efforts faits par la bourgeoisie moderne pour masquer sa domination sociale derrière l’apparence de liberté et d’égalité dans les rapports marchands, quand bien même le dispositif du marché permet effectivement aux riches de faire faire aux pauvres ce qu’ils ne veulent pas faire eux-mêmes, tout en estimant qu’il faut bien que quelqu’un (d’autre) s’en charge. Mais elle permet surtout de comprendre la fascination qu’a exercé le progrès technoscientifique moderne. Car la domination des forces de la nature a fait miroiter la possibilité de résoudre la contradiction entre la vieille aspiration à la délivrance et l’exigence moderne de respecter la liberté de tous les humains. Si les esclaves permettant notre délivrance sont les forces de la nature et les machines qu’elles actionnent, alors la domination technoscientifique de la nature ouvre la perspective fantasmatique d’une délivrance intégrale et universelle, compatible avec la promesse moderne de liberté pour toutes et tous. D’où l’idée de se rendre « comme maître et possesseur de la nature » pour faire faire à des « artifices » (engins, machines, robots) ce que les Grecs faisaient faire à leurs esclaves, et les nobles à leurs serfs, et ainsi procurer le « bien général de tous les hommes ». Belle promesse théorique. Mais en pratique, elle pose divers problèmes.
« Nous sommes devenus vitalement dépendants d’un système qui sape les conditions de vie de la plupart des êtres vivants. »
D’une part, l’exploitation technoscientifique de la nature butte sur des limites écologiques (en termes de ressources et de capacité d’absorption des écosystèmes) qui font que la délivrance qu’elle promet n’est en fait pas universalisable, à moins de ravager la Terre encore plus vite que ce n’est le cas actuellement. D’autre part, il n’y a pas d’exploitation de la nature sans exploitation des humains, car il y a toujours des tâches, d’une pénibilité parfois abyssale, qu’on ne peut faire faire à des machines – et voilà pourquoi la délivrance par l’industrie est toujours restée le privilège d’une minorité. Enfin, quand ce privilège a été massifié dans les pays riches au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la délivrance a changé de sens politique. Si elle était autrefois la marque de la domination sociale, elle est devenue le verrou de l’impuissance politique des masses de consommateurs. Car pourquoi, et comment, se révolter contre un système dont on dépend pour assurer notre subsistance ? Ce qui nous permet de comprendre deux choses.
D’abord, pourquoi nous sommes tellement impuissants à modifier notre trajectoire socio-écologique suicidaire, quand bien même nous savons pertinemment que nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis : nous sommes devenus vitalement dépendants d’un système qui sape les conditions de vie de la plupart des êtres vivants. Ensuite, pourquoi la question sociale et la question écologique sont si étroitement imbriquées : ce sont les deux expressions du même problème fondamental, une conception de la liberté qui repose sur l’exploitation des humains et de la planète, et constitue une impasse mortelle. Voilà ce qui pousse, je crois, tant d’ingénieurs à vouloir déserter : à l’heure actuelle, il n’est plus possible de croire aux promesses fondatrices qui donnaient un sens à leur métier.
« Pour être délivrés des nécessités du quotidien, il n’y a pas 36 solutions : soit on fait faire les tâches correspondantes à d’autres personnes, soit on les fait faire par des machines ou des robots. »
La liberté comme autonomie
Si cette conception de la liberté comme délivrance est devenue hégémonique dans le monde occidental moderne, elle n’est pourtant pas la seule conception de la liberté, même dans l’Occident moderne. En fait, cette conception de privilégiés s’est imposée contre les aspirations des classes populaires. En général, ces dernières ne se battaient pas pour être déchargées des nécessités de la vie, mais pour accéder aux ressources, en premier lieu la terre, permettant de les prendre en charge elles-mêmes. Or, telle est justement la visée de celles et ceux qui sont en quête d’autonomie aujourd’hui : subvenir à leurs besoins, notamment alimentaires et énergétiques. Ce qui signifie que l’aspiration à l’autonomie matérielle qui se diffuse aujourd’hui, et traverse manifestement le collectif Des Agros qui bifurquent, n’est pas nouvelle. En réalité, elle renoue avec la conception populaire et paysanne de la liberté selon laquelle l’accès à la terre est la condition de la liberté – sans quoi on se retrouve matériellement dépendants des classes possédantes et contraints à terme de faire ce que celles-ci ont, dans leur propre intérêt, envie et besoin de nous faire faire. Car si la domination sociale repose toujours en dernière instance sur la violence, le meilleur moyen de la stabiliser est de rendre matériellement dépendants les dominés, en les privant des ressources indispensables à leur subsistance.
« S’émanciper ne signifie pas être exonéré des nécessités du quotidien, mais les assumer pour abolir les rapports de domination qui reposent sur la dépendance matérielle. »
Dès lors, ils n’ont d’autre choix que d’obéir ou de crever de faim. Les luttes populaires pour l’accès aux ressources et la défense des biens communs signifient donc quelque chose d’important, sur le plan philosophique et politique : s’émanciper ne signifie pas être exonéré des nécessités du quotidien, mais les assumer pour abolir les rapports de domination qui reposent sur la dépendance matérielle. Contre l’idéal de délivrance, les classes populaires exigeaient l’autonomie par l’autosuffisance et l’accès aux ressources locales qui en est la condition. C’est avec cette conception de la liberté que renouent, au moins en partie, celles et ceux qui aspirent à plus d’autonomie matérielle aujourd’hui. Toutefois, un écueil les menace : embrasser une conception individualiste ou trop étroitement communautaire de l’autonomie, qui risque d’être dépolitisante et potentiellement exténuante. Un individu ou un petit groupe ne peut subvenir seul à ses besoins qu’au risque de s’épuiser et de se couper de toute vie politique. Si être autonome, c’est assurer (au moins en partie) sa subsistance, cette liberté n’est donc pas purement individuelle, car il est impossible d’assurer sa subsistance tout seul.
L’autonomie n’est pas « l’indépendance » matérielle, puisque c’est un mythe : rien ni personne n’est indépendant à proprement parler. Sur la Terre, tout est interdépendant. L’autonomie, à quelque niveau qu’on la pense, repose en fait sur le rejet des dépendances asymétriques, celles qui mettent « à la merci » des puissants. C’est le cas des dépendances impersonnelles qui nous ligotent aux grandes organisations industrielles, publiques ou privées, sur lesquelles nous n’avons aucune prise. Pour en desserrer l’étau, il s’agit donc de reconstruire des interdépendances personnelles, mais sur un tout autre modèle que celles qui définissaient le monde préindustriel. Autrement dit, il s’agit de refaire société en réinventant la subsistance en dehors des rapports traditionnels de domination personnelle. C’est ce pari que font toutes celles et ceux qui, aujourd’hui, cultivent leur autonomie en tentant de se réapproprier leurs conditions de vie au sein de structures collectives où l’on cherche à répartir équitablement les tâches en fonction des préférences, des capacités et des situations des unes et des autres, plutôt que des stéréotypes de genre.
« Il s’agit de refaire société en réinventant la subsistance en dehors des rapports traditionnels de domination personnelle. »
En ce sens, l’autonomie se joue principalement sur les trois plans des besoins, des techniques et des ressources, et implique une réflexion critique en ce qui les concerne. Sur le premier, il est bien sûr impossible de subvenir à nos propres besoins si ceux-ci sont infinis – car nos capacités de travail ne sont pas plus infinies que le nombre d’heures dans une journée. Ce qui signifie qu’aucune autonomie n’est possible sans redéfinir nos besoins, afin de les réduire. Mais il ne s’agit pas de les redéfinir de l’extérieur, de manière autoritaire. Quand on fait les choses soi-même, et c’est cela l’autonomie, il en résulte une autolimitation des besoins puisque le premier est alors de ne pas perdre sa vie à travailler pour satisfaire des besoins illimités. À l’inverse, rien ne vient borner les besoins de celles et ceux qui font tout faire aux autres. D’où le fait que l’autonomie suppose de remettre en question la séparation de la consommation et de la production au cœur de notre mode de vie de salariés-consommateurs-électeurs qui, comme le disait André Gorz, « ne produisent rien de ce qu’ils consomment et ne consomment rien de ce qu’ils produisent ».
Sur le plan technique, être autonome suppose de faire par nos propres moyens, ce qui signifie développer l’entraide et l’assistance mutuelle au lieu de recourir systématiquement à des professionnels, mais aussi de faire le tri entre les outils qui soulagent les efforts et renforcent l’autonomie et les technologies qui prétendent nous en délivrer, tout en nous rendant dépendants des industries qui les produisent. L’autonomie dépend en effet des caractéristiques des outils qu’on utilise, notamment de leur taille et de leur complexité. Elle requiert des outils que les usagers peuvent contrôler eux-mêmes, des techniques à échelle humaine qui sont relativement simples à produire, utiliser et réparer. De ce point de vue, cultiver notre autonomie suppose de nous émanciper de la fascination pour la technologie et du mythe de la neutralité technique.
Vivre de manière autonome, enfin, c’est vivre de nos propres ressources, c’est-à-dire des ressources locales, faire avec elles et donc bricoler notre subsistance sur la base de ce que permet la région où l’on vit. Ce qui suppose qu’un large éventail de ressources soient accessibles. L’autonomie suppose donc de défendre et de reconstituer des communs, au sens large de ressources (foncières, techniques, cognitives…) partagées, mais aussi un certain ancrage local. Car pour trouver ce qu’il nous faut, encore faut-il connaître le territoire où l’on vit et les êtres avec qui on le partage. L’autonomie se traduit donc par le déploiement de manières de vivre différentes en fonction de ce que permet le territoire. Sur le plan de l’imaginaire, cela implique de rompre avec l’universalisme abstrait de l’Occident moderne. Le monde de l’autonomie, comme disent les zapatistes3, est un monde dans lequel divers mondes sont possibles. La modernité reposait sur l’aspiration à être délivré de la terre et des activités de subsistance qui y sont liées – ce qui a conduit à identifier la liberté avec la vie urbaine, l’argent, l’industrie et la technologie.
Mais la généralisation de ce modèle menace de transformer la Terre en désert, au point que ses ultimes partisans fanatisés veulent désormais aller coloniser Mars. Contre cette conception extra-terrestre de la liberté, la première bascule se joue sur le plan de l’imaginaire : renouer avec l’autre conception de la liberté comme autonomie, portée autrefois par les couches populaires et désormais par l’écologie politique, notamment par l’écoféminisme, dans le sillage de tous les mouvements politiques qui ont pris pour devise « Terre et liberté » ! La seconde bascule consiste à mettre les mains dans la terre, afin de commencer à nous réapproprier nos conditions de vie. Car comment imaginer renverser ce système destructeur sans élaborer des formes de vie qui en soient moins tributaires ? Mais à l’instar des Agros qui bifurquent, et au contraire de ce que pensent les colibris, une telle bascule ne se fera pas sans luttes sociales d’envergure contre un système capitaliste dont la dynamique expansionniste menace toutes les formes de vie sur Terre. •
1 On peut penser à la pratique anarchiste du « refus de parvenir » et aux traditions religieuses du « grand renoncement », comme refus éthique d’intégrer certaines positions de domination sociale. Plus proche sans doute du geste des Agros qui bifurquent, en raison des motifs écologiques mis en avant, il y a la démission du mathématicien Alexandre Grothendieck de son institut de recherche pour cause de financements militaires (voir sa conférence « Allons-nous continuer la recherche scientifique ? » en 1972, récemment rééditée aux éditions du Sandre). Depuis quelques années, la révolte gronde dans le monde des ingénieurs et des apprentis ingénieurs, qui sont effectivement au cœur de l’appareil de production et de destruction du capitalisme industriel.
2 C’est ce qu’a révélé l’affaire Snowden, dont je parle dans le premier chapitre de Terre et Liberté. Sur cette question, lire aussi le groupe Marcuse, La Liberté dans le Coma (La Lenteur, 2013) et, plus récemment, Shoshana Zuboff, L’Âge du capitalisme de surveillance (Zulma, 2020).
3 Créé en 1994, le zapatisme est un mouvement révolutionnaire mexicain qui défend l’autonomie des peuples autochtones et s’oppose au néolibéralisme.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don