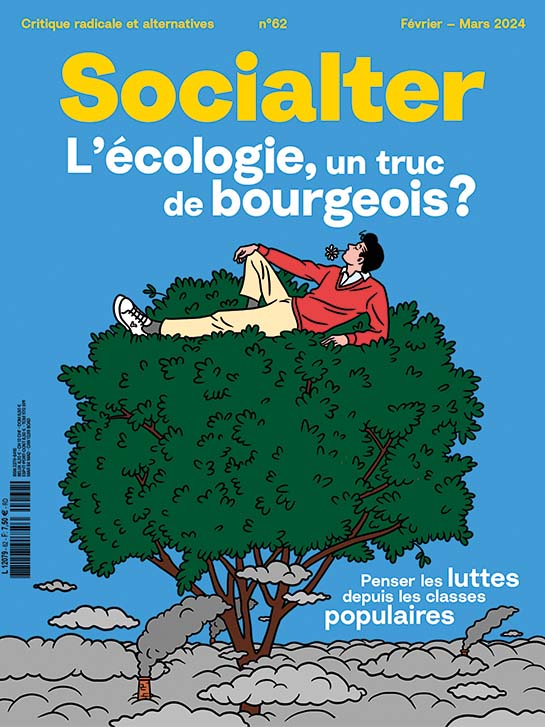En mai 2021, dans les quartiers populaires de Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, le syndicat Front de mères et l’association Alternatiba créent la première Maison de l’écologie populaire, sous le nom de Verdragon. L’objectif ? Mettre en place des projets écologiques au plus près des besoins des habitants des quartiers populaires. Dès l’ouverture, les membres du syndicat Front de mères, créé deux ans plus tôt par la politologue et militante Fatima Ouassak, sont taxés de communautarisme après la parution d’une tribune adressée au maire de Bagnolet qui les accuse de propager des idées « indigénistes et racialistes » et d’utiliser Alternatiba comme caution écologiste.
Article issu de notre numéro 62 « L'écologie, un truc de bourgeois ? », en librairie et sur notre boutique.
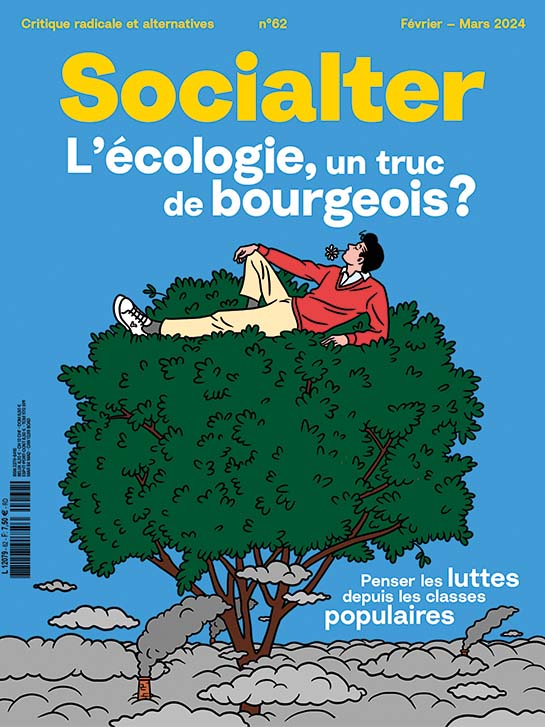
En réponse à ces attaques, Alternatiba publie un communiqué de soutien qui rappelle que « ce sont les milieux populaires et particulièrement les personnes racisées qui sont et seront les plus touchés par l’aggravation du changement climatique ». Depuis, le lieu poursuit sa vie, entre l’organisation de soirées pour discuter des rapports du GIEC, d’expositions sur les luttes paysannes, ou encore via la distribution de paniers de légumes avec l’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap). Mais les attaques qu’ont subies les co-fondatrices de Verdragon peu après l’ouverture du lieu révèlent la difficulté de faire émerger un endroit qui réunit les habitants des quartiers populaires autour de l’écologie. Comme si ces derniers, emmurés dans des grandes tours, devaient s’accommoder d’un territoire où s’entassent datacenters, usines polluantes ou échangeurs autoroutiers, sans jamais espérer s’en affranchir.
Des réalités multiples
D’abord, qu’entend-on par quartiers populaires ? Dans sa thèse, la géographe Léa Billen rappelle que cette catégorie a tendance à gommer des réalités plurielles : « Ce que j’appelle “quartiers populaires” désigne des quartiers classés en politique de la ville. Mais il s’agit d’une toute petite partie de ce qu’on appelle plus largement “quartiers populaires”, des territoires à la fois très divers d’un point de vue urbain, avec des quartiers de grands ensembles, des faubourgs ouvriers, des centres anciens plus ou moins dégradés et du point de vue de leurs habitants, avec une mixité sociale plus ou moins importante. Mais ce qui les rassemble, ce sont des inégalités sociales, urbaines et économiques très fortes. » Son travail de terrain s’est concentré sur les initiatives qui « transforment les modes de vie au quotidien », comme l’installation de composteurs de quartier ou de jardinières partagées, les groupements d’achats de produits écologiques ou encore la mise en place d’ateliers d’autoréparation.
Des initiatives qui s’inscrivent dans une diversité de modes d’action : mobilisations contre un projet d’aménagement, interpellation de la ville ou du bailleur, actions de sensibilisation… S’il n’existe pas à ce jour d’études quantitatives pour le démontrer, « ces initiatives sont beaucoup plus nombreuses qu’on ne le croit en quartiers populaires, d’après la géographe. Elles sont juste très discrètes, car les personnes qui les portent ne communiquent pas forcément sur leurs actions en dehors du territoire concerné. Parfois, même, les personnes qui font vivre ces initiatives ne se revendiquent pas de l’écologie. »
Pouvoir aux régies
Cette écologie, plus silencieuse, se retrouve par exemple dans les régies de quartier. Apparues dans les années 1980, elles viennent au départ répondre au problème de chômage des habitants des quartiers prioritaires. Elles fonctionnent sur un modèle hybride : elles cumulent le statut d’association à celui d’entreprise d’insertion et les habitants sont majoritaires aux côtés d'élus, de représentants d'associations ou d'institutions aux instances de décision. Au départ, les régies de quartier se chargent principalement de l’entretien des lieux publics ou des résidences de quartiers et de l’insertion par l’emploi. Depuis l’arrivée de l’écologiste et ancien membre d’EELV Mathieu Glaymann à la direction de la régie de quartier de Saint-Denis, la régie s’est transformée en laboratoire de la transition écologique. Récupération et valorisation de cartons et de cagettes en bois, vide-grenier toutes les trois semaines, livraison en cyclo-logistique, ateliers zéro déchet, entretien des espaces publics avec des produits éco-labellisés… Les projets fleurissent sur le territoire.
« Ces initiatives sont beaucoup plus nombreuses qu’on ne le croit en quartiers populaires. Elles sont juste très discrètes. »
Aujourd’hui, 60 % du chiffre d’affaires de la régie de Saint-Denis repose sur des projets en lien avec la transition écologique : « Les régies de quartier en Seine-Saint-Denis comptent environ 500 salariés, affirme Mathieu Glaymann. Et dans notre régie, nous recrutons dans 95 % des cas des habitants de Saint-Denis. Il ne faut pas sous-estimer cet outil. » Un puissant levier d’émancipation, donc, qui fait écho à la stratégie d’ancrage territorial que la politologue et militante Fatima Ouassak revendique dans son essai La Puissance des mères. Pour un nouveau sujet révolutionnaire (La Découverte, 2020). L’autrice fait référence à l’attachement ressenti par les habitants pour un territoire, critère indispensable selon elle, pour garantir sa protection.
La théorie de l’indifférence
Si le terme « écologie » est néanmoins toujours mis à distance par certains, « c’est parce [qu’il] est associé à un discours dominant qui exclut les habitants des quartiers populaires et qui considère que l’écologie ne les concernerait pas, voire qu’ils y seraient même hostiles, note Léa Billen. Ce discours est performatif : il produit un sentiment d’impuissance chez ces habitants qui peuvent effectivement finir par penser que ce n’est pas pour eux ». Pour en saisir les causes profondes, il faut revenir à l’histoire des politiques qui ont bâti ces quartiers. À partir des années 1960, le gouvernement décide de construire des grands ensembles pour répondre au défi du relogement des classes moyennes.
Or, « la construction des grands ensembles n’est pas accompagnée d’aménagements alentour : il manquait beaucoup d’équipements publics, sociaux et culturels. Et malgré les plaintes des habitants de la classe moyenne, l’État est resté passif, analyse Hacène Belmessous, auteur de l’ouvrage Petite histoire politique des banlieues populaires (Syllepse, 2022), pour lequel il a fouillé les archives des municipalités populaires en périphérie des villes. Ces populations ont fini par céder à l’achat de maisons individuelles, laissant place à une population immigrée extra-européenne à qui l’on avait longtemps refusé l’accès à ces logements. » Par la suite, la politique de rénovation urbaine dans les banlieues populaires qui se poursuit en 2003 après les émeutes des années 1990 est « d’abord une tentative d’éliminer un problème politique », poursuit le chercheur. L’objectif n’est pas de créer un meilleur cadre de vie pour les habitants, mais plutôt « d’ouvrir les cités pour que la police puisse intervenir ».
Des quartiers qui étouffent
Ces inégalités ont structuré les banlieues populaires. S’y ajoutent aujourd’hui des injustices environnementales. Documentées aux États-Unis depuis les années 1980, où les nuisances et pollutions frappent plus fréquemment les populations afro-américaines, elles deviennent une préoccupation en Europe à partir des années 2000. « On étouffe à l’intérieur, entre les quatre murs des appartements HLM, trois étroits, trop chauds l’été, véritables passoires thermiques l’hiver, où l’air est pollué par l’ameublement bon marché », constate aujourd’hui l’essayiste Fatima Ouassak, dans son ouvrage Pour une écologie pirate (Seuil, 2023). Mais aussi à l’extérieur, « entre les quatre murs du quartier, submergés par le bruit des voitures, les odeurs nauséabondes, l’éclairage artificiel et la pollution atmosphérique », poursuit-elle.
« Le problème n’est pas le message, mais le messager. Pour embarquer les catégories populaires, il faut créer des rapports plus horizontaux. »
En 2021, le Réseau action climat (RAC) et l’Unicef ont publié un rapport sur les liens entre la pauvreté des enfants et la pollution de l’air. Chez les enfants, « cette exposition peut entraîner des problèmes respiratoires et immunitaires, mais aussi des pathologies telles que le diabète, l’obésité ou la dépression », souligne le rapport. Si les populations les plus riches résident aussi dans les centres urbains, là où la pollution atmosphérique est la plus forte, les conséquences ne sont pas les mêmes pour les plus précaires. « Les inégalités d’accès aux soins, liées aux revenus ou à la catégorie sociale, font qu’un même degré d’exposition a un impact différent sur la santé », confirme l’Observatoire des inégalités dans une de ses analyses.
S’émanciper des clichés
Ces injustices sont de plus en plus largement dénoncées. Contre un discours écologique « déconnecté des réalités des classes populaires », Féris Barkat, né à Illkirch près de Strasbourg, a cofondé l’association Banlieues climat fin 2022, à tout juste 20 ans. Son but ? Sensibiliser les jeunes de banlieue aux enjeux écologiques et leur permettre d’être formateurs à leur tour. Selon lui, l’écologie est avant tout un moyen de mettre en lumière des inégalités sociales « peu audibles pour les politiques ». Plusieurs membres de Banlieues climat sont ainsi allés former des parlementaires. Sept au total – dont le député La France insoumise François Ruffin et l’écologiste Marie-Charlotte Garin – ont bénéficié d’une formation de trois heures donnée par Féris, Sanaa, Someïa, Aymen, Imane et Khadim, le 17 janvier à l’Assemblée nationale. L’idée de cette formation est d’interpeller les élus. Pour le cofondateur de Banlieues climat, si leur message ne passe pas auprès des jeunes de banlieue, « c’est une question de posture » : « Le problème n’est pas le message, mais le messager. Pour embarquer les catégories populaires, il faut créer des rapports plus horizontaux. »
Il y a aussi « un manque de représentativité », constate Amine Kessaci, âgé de 21 ans et originaire des quartiers nord de Marseille. En juin 2020, il a créé l’association Conscience qui mène des projets de sensibilisation et organise des campagnes de ramassage de déchets dans son quartier. L’initiative prend vite et sera bientôt déclinée localement dans d’autres quartiers populaires en France. Un succès rapide qu’il attribue au fait que « ces initiatives sont portées par d’autres jeunes de quartiers ». Aujourd’hui, s’il se présente aux élections européennes de juin, sur la liste menée par l’eurodéputée écologiste Marie Toussaint, c’est principalement pour porter la voix des quartiers populaires et déconstruire les stéréotypes qui leur sont associés. À l’affirmation que l’écologie ne parlerait pas aux habitants des quartiers, il répond : « Au contraire ! Le 2 décembre, plusieurs personnes de mon quartier sont montées à Paris avec moi au meeting de Marie Toussaint. Elles se sont retrouvées dans son discours et ont compris ce qu’elle défendait. » De son côté, Féris Barkat annonce que l’association Banlieues climat aura bientôt un lieu dédié à leur formation, depuis peu certifiée par le Ministère de l’Enseignement supérieur, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Car, conclut-il, « si les classes populaires ne sont pas outillées dès le départ à cause des inégalités d’accès à la connaissance, nous misons, au contraire, sur l’intelligence ».
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don