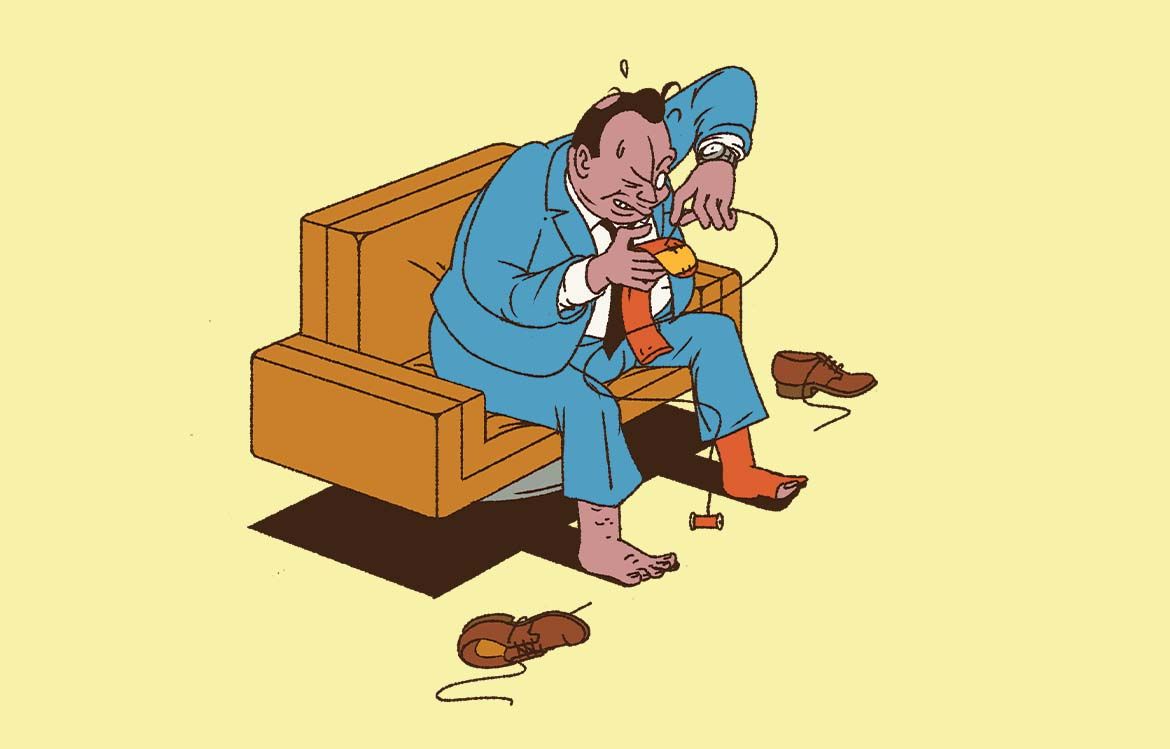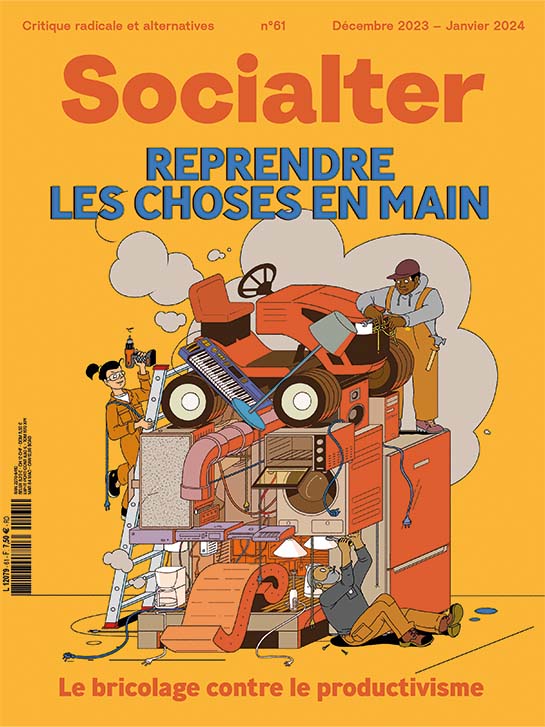Réparer plutôt que jeter. C’est le nouvel écogeste vanté en France pour lutter contre la crise écologique et l’obsolescence programmée. Rien qu’en 2022 et en 2023, le gouvernement a lancé deux « bonus réparation » pour donner une seconde chance à l’électroménager défaillant ou aux vêtements usagés. L’enjeu est de taille : en Europe, l’essor de la société de consommation dans les Trente Glorieuses a en effet bouleversé notre rapport aux objets.
Article issu de notre numéro 61, disponible en librairie et sur notre boutique.
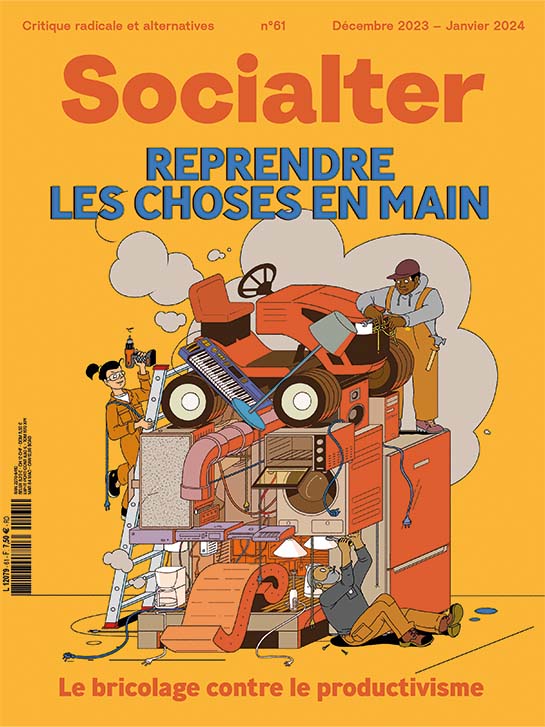
Peu à peu, le réflexe de réparer un meuble cassé ou de repriser des chaussettes trouées a quasiment disparu des mœurs. « Seuls 26 % des consommateurs réparent couramment, tandis que 38 % ne le font jamais », écrit la sociologue Julie Madon, spécialiste des modes de vie, dans sa thèse « L’art de faire durer, une pratique distinctive ». Réparer est, de fait, souvent un long et coûteux chemin de croix : « La réparation demande du temps et des efforts, [elle est] difficile d’accès et nécessite des compétences personnelles ou un entourage de gens bricoleurs », résume-t-elle. Mais depuis cinq ans, les classes moyennes et supérieures, sensibles aux discours institutionnels, commencent à modifier doucement leur comportement, explique le doctorant en sociologie Vic Sessego.
La débrouille en milieu précaire
Ce retour aux vieilles méthodes d’entretien et de réparation ne concerne cependant qu’une partie de la population française. Les classes populaires, elles, n’ont jamais arrêté de bricoler, de rafistoler, de rapiécer. Dans les bourgs et les quartiers défavorisés, les plus précaires ont toujours pris soin « des objets, des vêtements, des meubles... Parce qu’il y a des contraintes économiques, mais aussi parce que ça vient d’une certaine culture populaire », explique Fanny Hugues, doctorante en sociologie à l’École des hautes études en sciences sociales à Paris. « À la différence des classes moyennes et supérieures, il ne s’agit pas de réappropriation nostalgique des savoir-faire anciens », poursuit l’auteure d’une thèse sur la débrouille en milieu rural. Dans les classes populaires, où la moindre dépense compte, la réparation et l’entretien des objets sont une évidence : cela ne relève pas de l’écologie mais du « bons sens ». Un mode de fonctionnement que connaît bien Sylvianne, 37 ans, cofondatrice du Collectif pop, qui milite pour une organisation politique des classes populaires. Cette cadre a grandi dans une cité HLM. Les huit membres de sa famille vivaient sur le seul salaire du paternel : « Mon père bricolait et bricole encore beaucoup. Quand les chaises cassaient, il les réparait. » Les personnes aux faibles revenus « ont acquis dans leur enfance des dispositions à faire durer. [Elles] en ont fait une habitude, développe Fanny Hugues. Et de toute façon, sans ça, leur mode de vie ne tient pas. » Pour certains cependant, au-delà de la subsistance, la réparation est avancée comme un acte politique : faire par soi-même est une manière « de subvertir la possession capitaliste des savoir-faire », abonde la chercheuse.
Au cœur des campagnes, les « précaires économes » étudiés par Fanny Hugues ont un « mode de vie basé sur des ressources monétaires et, surtout, non monétaires (troc, don, partage). Il suffit qu’il y ait une ressource qui flanche pour que cela fragilise tout le système ». Au sein de ces foyers, la notion d’obsolescence est ainsi quasi inexistante. Au contraire des moyens et des hauts salaires, les précaires ruraux ne jettent un objet que si celui-ci ne peut vraiment plus servir ni à son propriétaire, ni aux amis, aux voisins ou à quelqu’un dans le besoin. « Même les choses qui sembleraient obsolescentes, ils les gardent parce qu’ils imaginent plein d’autres manières d’utiliser l’outil ou l’objet. Les gens font aussi attention à ce que les choses ne se détériorent pas trop. La question de la durabilité est centrale », assure Fanny Hugues.
Les garages, les granges, les appentis se transforment en caverne d’Ali Baba pour bricoleurs. « Ils stockent “au cas où”. C’est une expression qui est beaucoup utilisée, reprend Fanny Hugues. Par exemple, dans la cour d’une éleveuse de vaches, il y avait les restes d’un chantier de réfection d’un toit de porcherie : des ampoules, des brouettes, une barrière, une grande échelle, un tuyau jaune enroulé... Et dans sa propre porcherie, deux pièces servent à ranger les outils de bricolage. » Généralement, le tout, extrêmement bien organisé, est récupéré dans les déchetteries, les chantiers, dans la rue ou chez ses voisins.
Entraide et fierté
Parer à toute éventualité ou maîtriser l’art de fabriquer une machine à laver sont des « composantes du capital d’autochtonie qui favorisent l’entraide, le prêt de matériel, les dépannages et autres coups de main destinés à réduire les dépenses [des classes populaires], rappelle le sociologue Jean-Baptiste Comby dans l’étude « Les classes populaires et l’enjeu écologique » publiée en 2021. Dans les territoires urbains, [cela] participe d’un travail de subsistance pour les plus précarisés et structure des réseaux de sociabilité sécurisants. » Un constat qui vaut aussi pour la campagne, selon Fanny Hugues : « Chacun peut compter sur un réseau pour partager des compétences, récupérer des choses, faire des dons, des prêts... [Dans chaque village], il y a des personnes référentes, le maçon, le mécanicien, l’électricien – je parle ici volontairement au masculin car ce ne sont quasiment que des hommes –, en cas de problème », rapporte la thésarde.
Concrètement, un voisin peut venir aider à bâtir un mur en échange d’un repas, de pots de confiture ou de légumes du potager. Cette organisation informelle peut aussi donner lieu à des chantiers solidaires pour venir en aide aux personnes âgées ou malades, dont le toit se serait effondré. Ces chantiers sont alors « très différents de ceux organisés par la petite-bourgeoisie culturelle rurale » qui, elle, fait appel à des associations ou à des cercles extérieurs, pointe Fanny Hugues.
Dans les quartiers populaires urbains, le partage et l’entraide se mettent en place, notamment, à travers les mécaniciens de rue qui réparent les voitures directement sur le trottoir pour peu cher. « La mécanique de rue est l’expression d’une économie orientée vers les familles aux marges de l’emploi. Elle constitue aussi un mode d’échange sur la base de la maîtrise d’un savoir-faire technique et manuel, qui offre des perspectives professionnelles à certains jeunes des classes populaires, détaille Blandine Mortain, enseignante et chercheuse en sociologie à l’université de Lille et membre du collectif Rosa Bonheur, qui analyse ces questions depuis une dizaine d’années à Roubaix. On est dans quelque chose de plus organisé, de plus investi subjectivement que la survie. C’est pour ça qu’on n’a pas voulu parler de débrouille : il y a des vraies compétences manuelles ancrées dans une culture ouvrière et populaire ancienne. »
Des qualités développées sous contraintes économiques, mais dont les principaux concernés retirent une certaine fierté, soulignent Blandine Mortain et Fanny Hugues. Le plaisir de réparer une voiture ou de fabriquer son électroménager est réel, même si cela « reste associé à une situation très précaire », observent-elles. « La respectabilité quand on est pauvre, c’est de faire du bon travail », abonde Blandine Mortain.
L’invisibilisation du bricolage populaire
Ces modes de vie mêlant récup’, stockage et bricolage pourraient devenir un exemple à adopter pour réduire notre empreinte écologique. Pourtant, « il y a une invisibilisation complète de ces pratiques et une forme de disqualification qui est constitutive de ce que c’est d’être de milieu populaire. Il y a une forme de domination sociale dans le fait de reconnaître ou pas que les gens ont des pratiques vertueuses », poursuit l’enseignante-chercheuse Blandine Mortain.
La tentative ratée d’implantation, à partir de 2008, d’un garage solidaire associatif dans les cités de Roubaix est une parfaite illustration, selon elle : « Ça n’a pas pris parce qu’ils n’étaient pas Roubaisiens, ne connaissaient pas les gens et pratiquaient des prix supérieurs à ceux des garages de rue. Ce truc-là a été mis en place sans prendre en compte ce qui existait déjà sur le territoire et en ignorant le fait que les gens savaient déjà réparer », juge la sociologue. De fait, dans les repair cafés, lieux de réparation solidaire qui essaiment en Europe depuis une dizaine d’années, les classes populaires sont les grandes absentes, d’après une étude de Julie Madon. « Dans les milieux écologiques, il y a un discours un peu moralisateur sur le thème “nous, on est écolos, pas les autres”, dénonce Sylvianne, du Collectif pop. Les classes populaires sont pointées du doigt comme si elles étaient très pollueuses. Certes, elles achètent des petites choses, mais autrement récupèrent et réparent tout. Elles sont plus écologiques que les cadres. » Et de rappeler que les plus riches achètent « tout le temps » des outils et refont la décoration ainsi que des travaux « à chaque déménagement ». « En plus, il y a ce côté hyper léché. L’atelier, est tout nickel, tout bien décoré. Mais la pratique de réparation, ce n’est pas un truc tout beau, tout propre », s’agace-t-elle. De fait, pour les hauts revenus, ce hobby permet non seulement de valoriser de nouvelles compétences dans leur milieu professionnel, mais aussi de tracer une frontière esthétique avec les autres, relève Julie Madon. Alors que pour les plus précaires « le but n’est pas de faire de beaux objets, il faut que ça fonctionne. Et s’ils font tout pour maintenir les choses en l’état, c’est pour éviter d'avoir à gérer de grosses réparations », ajoute Blandine Mortain.
Alors qu’est-ce qui est vraiment écolo ? Les foyers vivant dans des maisons zéro émission et roulant en voiture électrique ? Ou bien ceux qui usent le moins d’énergie possible, entretiennent et réparent tout ce qu’ils peuvent ? S’il ne faut pas « romantiser le mode de vie des classes populaires », celui-ci est pourtant complètement résilient, conclut Fanny Hugues. Ce n’est pas le cas pour les classes moyennes et supérieures.
« Il faut regarder les choses en face : l’écologie en France est une écologie de classe,taclait déjà en 2020 la politologue Fatima Ouassak. Elle est généralement totalement déconnectée de la question sociale, du moins du point de vue des classes et des quartiers populaires. Elle s’organise autour des projections établies par les CSP+ dans des termes abstraits, lointains et désincarnés qui ne remettent jamais réellement en question le système capitaliste et colonial à l’origine du désastre écologique. » Ce qui expliquerait en partie pourquoi, selon Blandine Mortain, les pouvoirs publics « ont toutes les peines du monde à tenir compte du fait qu’il existe des pratiques écologiques dans les milieux précaires, et à les accompagner »
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don