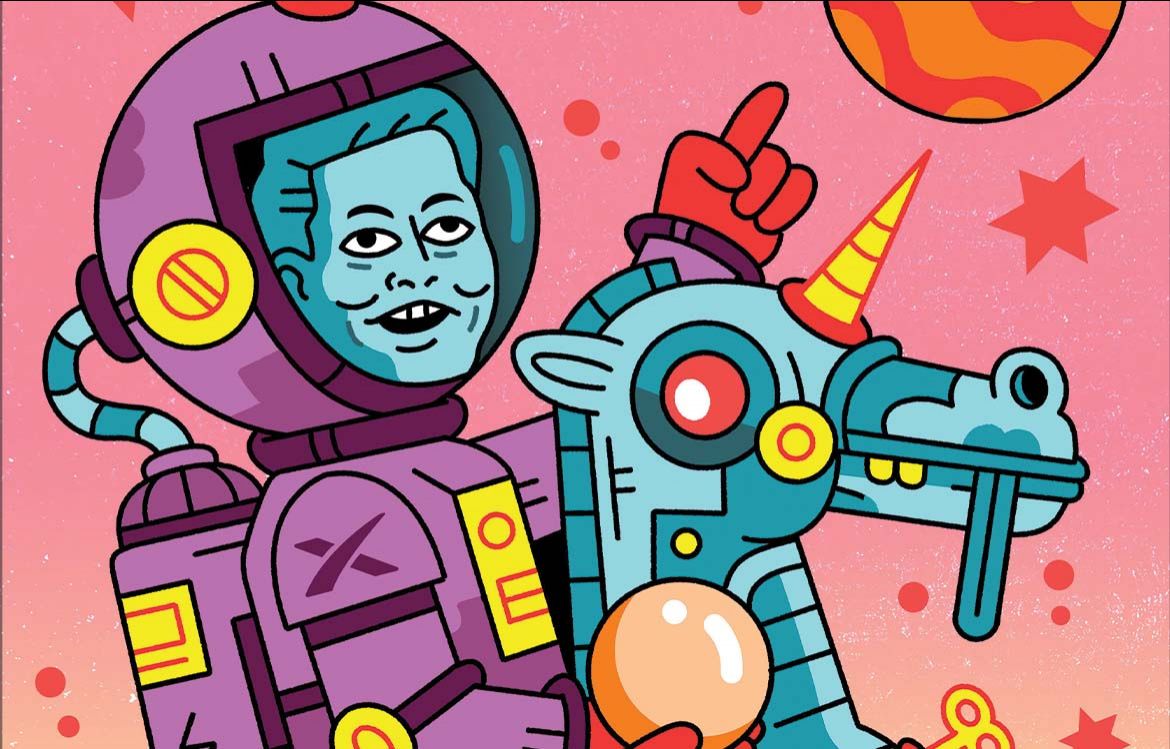C’est une simple anecdote, mais je la trouve intéressante. J’étais à la télévision pour parler d’un livre que j’ai récemment écrit sur la « zone critique », cette minuscule partie de la planète Terre que l’histoire de la vie avec un grand V a modifié depuis quatre milliards d’années et à l’intérieur de laquelle nous sommes bel et bien enveloppés, et pour ainsi dire roulés. Tout en disant son admiration pour mon livre, la journaliste m’avait donné dix minutes et le reste du plateau s’ennuyait gentiment en semblant dire par leur attitude : « Cette zone critique, quand même, ce n’est pas d’un immense intérêt. » Et puis, sans prévenir, la journaliste a enchaîné sur le trio de sondes que divers États envoyaient cette semaine-là sur la planète Mars.
Texte inédit issu du premier volume de Bascules - Pour sortir de l'impasse. Disponible sur notre boutique.

Or, c’est là le plus étonnant, ce contraste entre l’ennuyeuse Terre et la passionnante planète Mars, elle ne l’avait pas dressé pour le plus grand profit des téléspectateurs. Elle n’avait monté aucun piège pour nous ridiculiser mon ami et moi. L’évidence s’était imposée d’elle-même : Mars intéresse les humains plus que la Terre. Si Mars apparaît pour certains comme le plan B après que la Terre de notre naissance, le plan A, aura été sacrifiée, c’est parce qu’on a pris l’habitude de comparer des planètes entre elles. Or, s’il est bien vrai que Mars est une planète, ce n’est plus le cas de Terre. Comme le disait ce soir-là mon ami géochimiste sans pouvoir intriguer les journalistes de la télévision : « Mars n’a pas de zone critique ! »
En effet, la vie n’y a pas transformé les conditions initiales au point de créer un environnement durablement favorable à la continuation de son expérience multiforme. Pour le dire d’une façon brutale, Mars est juste une planète parmi d’autres alors que Terre a, ou est, une zone critique. Mars est chauve, Terre est chevelue. Ce qui rend plaisante l’anecdote par laquelle j’ai commencé, c’est que Terre a cessé depuis des milliards d’années de se comporter comme une simple planète. Et c’est probablement pourquoi Mars fascine autant : elle ressemble à l’idéal de la planète, sans vie, et révèle de façon frappante comment ceux qui rêvent d’y migrer imaginent la Terre enfin débarrassée des lenteurs, des lourdeurs, des complications que la continuelle interruption des vivants impose à tout déplacement. De même que la Lune n’a de lumière que par le Soleil, c’est depuis Terre que se projette sur Mars ce désir d’un monde invivable où tout serait plus facile parce que les vivants n’interféreraient plus avec aucun mouvement.
« Si l’histoire a un sens et qu’elle se dirige vers la “ reprise de la production ”, alors le pire semble inévitable. »
Si je suis si impressionné par l’anecdote du désir mortifère de Mars, c’est parce que je suis bien obligé de prendre en compte la situation de violence extrême où nous mène l’impréparation du XXe siècle. Le grand historien Adam Tooze, dans un film récent sur l’économie de guerre nazie, évoquait l’effrayant discours de Goebbels le 18 février 1943, offrant au peuple allemand le choix entre la capitulation et la « guerre totale » en demandant : « Voulez-vous une guerre plus totale et plus radicale que tout ce que vous avez vu jusqu’ici ? » Alors que tout le monde sentait bien qu’il s’agissait d’une folie, que la guerre était perdue, qu’ils étaient sous les bombes, on voit au contraire se dresser la foule enthousiaste applaudissant à tout rompre ce projet de Totaler Krieg. Dans le documentaire, on repère même Albert Speer, l’opérateur de cette fuite en avant, applaudir frénétiquement à ce nouveau coup de rein pour reculer de quelques mois l’inévitable faillite. Tout plutôt que la capitulation. Comme les faillis à la table de jeu qui espèrent « se refaire ».
Sommes-nous tellement sûrs aujourd’hui que les peuples apeurés par la perte de leur idéal de modernité ne se dresseraient pas avec le même enthousiasme qu’en 1943 pour la « production totale » si la question leur était posée : « Voulez-vous une destruction planétaire plus totale et plus radicale que tout ce que vous avez vu jusqu’ici ? » La suggestion me fait frémir. Surtout que, si l’on en croit les historiens de la grande accélération, n’est-ce pas exactement le choix des vainqueurs de 1945 qui se lancèrent à corps perdu dans la Totaler Produktion ?
Ceux qui croyaient avoir gagné contre le mal absolu, ne s’engagèrent-ils pas à reproduire sur un autre plan, à une tout autre échelle et aux dépens de la planète, le même mouvement de mobilisation totale, repris de décennie en décennie avec la même dénégation de l’abîme qui se creusait peu à peu sous eux ? Comment imaginer que devant une crise aussi mal préparée, le XXIe siècle, toujours animé, inspiré, transporté par le même sens de l’histoire, réagirait autrement et choisirait enfin sinon la capitulation, du moins quelque chose comme une proposition de paix,un armistice ? Si l’histoire a un sens et qu’elle se dirige vers la « reprise de la production », alors le pire semble inévitable. Applaudissements unanimes, foule fanatisée, certitudes de la catastrophe, nous voilà partis pour un dernier coup de rein, en avant vers la production totale, viva la muerte !
Pourtant, le pire n’est pas toujours sûr ; il n’est heureusement pas certain du tout que l’histoire ait un seul sens. Pour penser une autre suite à l’aventure moderne que la « reprise et l’extension de la production », il faut parvenir à desserrer l’amalgame moderne qui a lié entre elles l’abondance, la liberté et l’unidirectionalité de l’histoire universelle. Est-il possible de rouvrir ce paquet si fortement ficelé et d’en distribuer autrement les éléments ? Peut-on conserver l’aspiration à la liberté, le goût de l’abondance, sans pour autant les rattacher à la production – production dont le telos (la finalité) exige qu’elle devienne totale et qu’on prépare l’inévitable plan B d’un exil ou d’une expulsion sur Mars ? Dans un livre d’une grande importance, justement appelé Abondance et Liberté (La Découverte, 2020), Pierre Charbonnier a fait beaucoup pour rouvrir ce paquet cadeau que les Modernes prétendaient offrir au reste du monde.
Que peut vouloir dire en effet de chérir l’autonomie, si cette autonomie est obtenue en déniant la présence de tous les êtres, humains et non-humains, qui la rendent possible ? Or, il faut bien reconnaître que le « porte-à-faux », comme dit Charbonnier, est béant, et à toutes les échelles, individuelles aussi bien que collectives, entre le monde où l’on vit et le monde dont on vit. Il y a bien longtemps que l’on dénonce l’hypocrisie de ceux qui parlent de liberté parce que d’autres travaillent pour eux. Les différents mouvements socialistes, féministes, tiers-mondistes, décoloniaux, n’ont cessé de révéler l’ampleur de ce porte-à-faux. En ce sens, tout le mouvement écologiste n’a rien fait d’autre que d’accroître encore la liste déjà fort longue des êtres dont dépendent sans le reconnaître ceux qui se disaient à la recherche de l’autonomie.
Le mot de « porte-à-faux » est important car il ne souligne pas simplement la situation physique d’être suspendu au-dessus du vide, de l’abîme, mais aussi la situation cognitive de mal penser. Ceux qui parlent de liberté en niant l’existence du monde dont ils vivent, sont portés à penser faux, et en particulier à se méprendre sur le sens de leur histoire. Il n’est pas exagéré de dire à quel point l’aventure moderne a été poussée jusqu’ici par des amoureux de la liberté et de l’émancipation qui se sont lourdement trompés sur les conditions matérielles et sociales nécessaires à cette émancipation. Ce qui ne veut pas forcément dire que l’aventure est terminée, mais qu’il faut déplacer l’émancipation ailleurs en tentant de lui donner un autre sens.
Or, cet « ailleurs », nous commençons à en avoir une idée plus précise. Cet autre espace et cet autre temps, c’est exactement ce que j’ai pointé du doigt en introduisant la notion de zone critique ou de Gaïa. L’émancipation n’est pas sémantisée de la même façon sur la planète Terre en voie de s’échapper dans l’espace et sur la zone critique. La question des limites et du dépassement des limites ne s’y pose pas de la même façon. Comme le dit si fortement Charbonnier, il ne suffit pas de se demander si on peut être libre, mais il faut expliciter où l’on est pour exiger d’être libre. Ce que les Modernes avaient un peu oublié, c’est que la liberté dépend d’une cosmologie. Les différentes notions de la liberté, négatives et positives, partageaient une certaine cosmologie, bien sûr, mais sans avoir besoin de le dire, tellement elle était évidente : c’était celle de la res extensa, inventée au xviie siècle pour servir de scène au déplacement sans contrainte des corps pesants. Ils prenaient la Terre pour une autre Mars. Comme l’espace-temps, aujourd’hui, sur Terre, n’est plus le même, les valeurs changent de direction et d’intensité.
Reposer la question de la quête de l’autonomie, c’est, assez curieusement, se redonner aussitôt quelque chose comme un sens de l’Histoire, en tout cas, un projet politique clairement orienté. Sauf que cette orientation, si vous me passez ce mauvais jeu de mots, n’a plus rien d’une occidentalisation. S’orienter vers l’autonomie, c’est se donner l’immense tâche de mettre fin au porte-à-faux. Posez-vous une seconde la question de ce dont vous dépendez pour subsister, imaginez de faire se superposer le monde dont on vit et le monde où l’on vit, et vous allez vous apercevoir qu’il faut agir un peu partout et à toutes les échelles pour simplement réduire un peu l’abîme du porte-à-faux. Aussitôt mille questions épineuses se présentent : celle de l’esclavage passé, mais aussi celles de la colonisation actuelle, l’énorme inégalité des échanges internationaux, l’occupation de l’espace, les hectares fantômes que les États développés ne cessent d’acquérir pour « se libérer » à l’intérieur de leurs frontières, les migrations, le droit international, jusqu’à des questions d’apparence locale comme la fabrication du pain, le sort des graines paysannes ou la permaculture.
C’est justement l’immense variété des tâches qui contraste si clairement avec l’unidirectionalité de la version précédente. Il y a bien une orientation, mais elle exige d’aller partout, dans tous les sens, pour regagner une autonomie et faire coïncider, autant qu’il est possible, les deux mondes. On ne va pas quelque part mené par une avant-garde, on s’égaille dans toutes les directions pour repérer ce qui nous empêche d’être libres. C’est bien une orientation, mais qui consiste à sortir par toutes les issues possibles de la prison de la production. Il y a bien un sens de l’histoire, on va bien d’une situation à l’autre, mais voilà, cette histoire n’a pas de direction. Ce n’est pas la flèche du temps qui la définit, mais l’attraction universelle du terrestre qui l’oblige à changer ce qu’elle appelait « avoir un but », « aller de l’avant », « être résolument moderne ». Il s’agit bien d’être progressiste, puisqu’il y a progression, mutation, métamorphose, mais sans pour autant être capté par la figure ancienne du progrès. Je mesure la difficulté de ce déplacement des affects politiques à la peine que j’ai à trouver la bonne métaphore. Le mouvement des élèves d’un collège quand sonne la fin des cours n’est peut-être pas si loin de ce que je cherche à capter… Vous avez tous connu ce mouvement, ça court partout et dans tous les sens en piaillant des cris de joyeuse délivrance.
« La bourgeoisie s’est non seulement trahie elle-même mais a trahi tous ceux qu’elle prétendait entraîner à sa suite dans le “ processus de civilisation”. »
Je l’ai souligné dès le début avec mon histoire de plateau télé : Mars excite, la Terre ennuie. On ne trouvera pas d’alternative à la production totale, au rêve de Mars, tant que l’on n’aura pas décelé quelque chose qui ait le même attrait esthétique, moral, sportif, la même excitation, le même air, la même sonorité qu’offrait la quête de la liberté et de l’émancipation. Or, on retrouve quelque chose des efforts à fournir pour s’émanciper, dès qu’on essaie de se poser la question de la reprise, sous une forme nouvelle, du conflit et du remplacement de ce que je vais appeler un « conflit de classes géosociales ». L’expression est un peu lourde, mais je la prends pour l’instant pour combiner le sens très particulier que Norbert Elias donne au mot de classe avec la mutation cosmologique dont je viens de parler – et à laquelle bien sûr il ne s’intéressait pas.
Elle a pour moi deux traits essentiels : les conflits se détectent par des variations, d’abord imperceptibles puis de plus en plus visibles, dans les manières, dans le goût et le dégoût pour certaines pratiques, certaines valeurs et attitudes ; et, surtout, le classement ne dépend pas d’abord des rapports de production, mais de l’invention ou de la captation d’un certain sens de l’histoire. Il n’y a guère de doute que les variations actuelles dans les manières offrent un répertoire d’une immense richesse sur les façons de se disputer sur l’usage du monde. Et il n’y a guère de doute non plus sur le fait que c’est bien la production qui est en question aujourd’hui et pas seulement son accroissement et la répartition de ses trésors. Deux bonnes raisons d’aborder la question des conflits de culture géosociales sous l’angle d’Elias.
Si vous avez suivi mon argument sur l’aveuglement du XXe siècle sur lui-même, on s’aperçoit que ce que Bruno Karsenti, commentant Elias, appelle la « classe pivot », celle qu’il appelait « rationnelle » parce qu’elle voyait plus loin que les autres et qu’il assimilait à la bourgeoisie dans son analyse de la société de cour, cette classe s’est non seulement trahie elle-même mais a trahi tous ceux qu’elle prétendait entraîner à sa suite dans le « processus de civilisation ». Dès que la figure de l’Anthropocène apparaît sous celle du développement et de la modernisation, on ne peut considérer cette classe que comme traître à son propre projet. C’est d’ailleurs cette traîtrise, cet abandon, cet « escapisme » qui explique le vaste processus dedécivilisation auquel on assiste partout à l’intérieur et à l’extérieur des États-nations, le désordre international, aussi bien que dans ce qu’on appelle, à un niveau plus modeste, l’abandon de toute forme de civilité – civique ou universitaire.
Cette ancienne classe « éclairée » continue sans y croire à faire croire aux autres qu’ils vont tous monter dans le train du progrès et du développement – tout en se préparant à échapper le plus vite possible à l’ampleur de la crise générale. C’est, par exemple, l’inévitable Elon Musk, fondateur de SpaceX, s’organisant pour nous emmener tous vers Mars et, pour plus de sûreté, se préparant aussi à se réfugier tout seul dans un bunker survivaliste en Nouvelle-Zélande. Mobiliser d’un côté et rejeter de l’autre, c’est cette attitude qui explique la brutalisation générale de la vie publique. On nous demande de nous développer encore un peu davantage, alors que l’on sent qu’il va falloir au contraire atterrir. De quoi rendre fou et, pour reprendre un cliché, de désespérer bien au-delà de Billancourt.
Si l’on prend le processus de décivilisation pour classer les groupes en lutte, on se met à chercher s’il n’existerait pas une nouvelle classe géosociale qui pourrait servir de classe-pivot en agrégeant à son tour, après la bourgeoisie, et contre elle, une forme supérieure de rationalité. Ce terme doit être pris au sens vague et contingent que lui donne Elias : il n’y a là rien de cognitif, rien de rationaliste à l’ancienne, il ne fait pas appel aux Lumières, rien de téléologique dans son argument, c’est une suite d’événements tout à fait contingents. Non, une classe peut juste prétendre à un peu plus de rationalité qu’une autre quand son horizon est un peu plus large, un peu plus conséquent que celui des autres, parce qu’elle se préoccupe justement du sens de l’histoire à long terme et du cadre cosmologique où elle va se dérouler.
Ceux qui se préoccupent du basculement cosmologique pour définir le cadre dans lequel vont désormais se dérouler les luttes sont en droit d’accuser les autres d’inconséquence et d’irrationalité. Et du coup, selon Elias, c’est aussi leurs manières de vivre qu’ils commencent à mettre en avant et à proposer en modèles. Ils ne sont plus à la remorque des autres classes. Ils aspirent à donner un sens. La question se pose alors de savoir si, en plein processus de décivilisation, on ne pourrait pas discerner les linéaments d’un processus de re-civilisation, mais sur une autre base qui répartirait autrement ce qu’on pourrait aussi appeler les classes géosociales selon leur différentiel de « rationalité ». La question peut paraître bizarre, mais elle permet, d’après moi, de penser autrement la suite de l’aventure moderne.
Or, il y a bien dans les mouvements dits écologistes quelque chose comme l’embryon d’un nouvel agrégat en lutte contre ceux qui ont trahi et qui tend à proposer aux autres groupements un sens de l’histoire. Vouloir superposer, à toutes les échelles, le monde dont on vit et le monde où l’on vit, c’est allonger enfin l’horizon de l’action collective, proposer un projet sinon de développement du moins d’enveloppement. L’esprit des luttes est bien toujours là, le but est bien l’autonomie et la libération, mais le sens de l’action s’est inversé. À ceci près qu’il ne s’agit pas d’une ascension continue vers la liberté à l’ancienne, mais d’une descente, d’un atterrissage, dans une forme nouvelle d’émancipation qui oblige à se battre, pied à pied, contre tout ce qui met en péril l’habitabilité de la Terre. Ce n’est pas pour mais contre la production que les fronts de lutte sont désormais organisés. L’intérêt de partir d’Elias, c’est que cette sorte de nouvelle lutte des classes dont nous apercevons les linéaments dans les conflits de monde, dans les conflits de planètes, n’est justement pas fondée sur les rapports de production. Cela peut paraître une faiblesse, et c’est bien ainsi que la tradition marxiste a considéré son entreprise.
Mais c’est aussi une force, si c’est précisément de la production elle-même comme horizon indépassable qu’il s’agit de s’extraire ! C’est parce que l’ancienne lutte des classes portait sur la seule production – se demandant comment l’étendre et comment répartir au mieux les fruits de cette richesse –, qu’elle a justement raté l’événement majeur de l’Anthropocène. Sous, avant, derrière, au-dessous, en plus, autour de la production, se pose la question fondamentale de la reproduction des êtres qui participent à cette production – et, en fait, comme on le voit bien chez Marx, s’est toujours posée cette même question. Ce que les mouvements écologiques révèlent, c’est à quel point n’a pas été pensée cette question de la reproduction à l’intérieur de laquelle tout le système de production se trouve inséré, encastré, embedded, dirait-on en anglais. Comme le montrent bien Karl Polanyi, Charbonnier et beaucoup d’autres, le monde de l’économie – libérale ou non, peu importe – restait dépendant d’un monde matériel qu’elle ne prenait pas en considération. C’était un matérialisme sans matière. En tout cas, sans matière durablement maintenue dans l’existence. Adapté à une planète ordinaire comme Mars peut-être, mais pas à la Terre si particulière.
« L’écologie doit proposer à ceux qui ont été trahis un autre destin, une autre définition de l’abondance et de l’identité. »
Et c’est là où je retrouve mon cauchemar de la « production totale ». En effet, le choix est désormais de décider si l’on doit étendre la production à tout ce qui l’entoure et la permet, ou si c’est le principe même de la production dont il faut s’extraire. On voit bien dans les discussions sur les « services écosystémiques » que « la nature » est supposée donner ; on devine la tentation d’étendre les principes du calcul économique à l’amont de la production proprement dite, alors que les paysans, les activistes, les peuples dits autochtones, cherchent, au contraire, à diminuer le rôle de la production en aval de ce qui permet la reproduction des êtres. Si la classe émergente de l’écologie a tant de peine à se repérer, c’est parce qu’il y a un conflit non seulement entre les classes, mais aussi un conflit surle type de classe, et donc de classement, de repérages, d’alliances, qu’il s’agirait d’utiliser. Dans un cas, on cherche à se placer en continuité avec les classes que les rapports de production définissaient ; dans un autre, l’écologie se définit parce qu’elle est en discontinuité avec les classes traditionnelles sur la question-clé de la production.
Dans un cas, elle reprend la grande aventure commencée avec les socialismes pour étendre la production et en répartir au mieux les biens ; elle se situe donc à l’intérieur de l’aventure moderne ; se repère entre gauche et droite ; mais a-t-elle d’autre issue que la production totale ? Dans l’autre, elle invente sa propre position ; repère ses propres manières ; se définit par les limites apportées à la production ; redistribue le vecteur gauche/droite, comme le vecteur progrès/régression, et invente la forme de rationalité qui peut servir de modèle pour organiser le déplacement des classes les unes par rapport aux autres. Elle a une chance d’échapper à la tragédie de la Totaler Produktion, mais elle doit trouver comment s’adresser à ceux qui ont été trahis en leur proposant un autre destin, une autre définition de l’abondance et de l’identité. C’est à ce prix seulement qu’elle pourrait agréger autour d’elle et ambitionner ce rôle de pivot qui enclencherait un processus de re-civilisation. Au bord du gouffre. Dans l’urgence du changement climatique. Sans le long processus de formation qu’Elias raconte dans ses livres sur « la dynamique de l’Occident ». Ah ! Si vous cherchiez des passions et des intérêts, une histoire pleine de fureur, vous l’avez là, à coup sûr, dans une dynamique de la réorientation. Encore faut-il apprendre à en discerner les camps et les mouvements.
C’est en ce point que pourrait commencer l’autre mouvement de reprise de l’aventure moderne, non plus en lui cherchant un avenir, mais en revenant sur son passé ou, plus justement, en faisant son anthropologie. Alors que le projet d’une anthropologie des Modernes paraissait bizarre quand je l’ai introduit en 1979, la mutation écologique à laquelle il a abouti le rend complètement évident : « Que s’est-il passé ? Qu’avaient-ils donc en tête ? » Cette fois-ci, ce n’est pas du tout par des opérations de classement et par le repérage des changements de manière que l’on pourrait s’y retrouver, mais en cherchant à comprendre pourquoi les Modernes ont été à ce point aveuglés sur leur propre histoire. L’hypothèse que je poursuis depuis près de quarante ans porte sur la difficulté du pluralisme. Pourquoi les Modernes, comme l’a montré si magnifiquement Eric Voegelin, ont été incapables d’entretenir, de chérir le pluralisme.
Non pas, le pluralisme au sens social ou « multiculturel » que les sociétés contemporaines se flattent un peu vite de facilement tolérer, mais le pluralisme des modes d’existence. Quand on parle de pluralisme, Isabelle Stengers l’a montré dès l’époque de ses Cosmopolitiques, on semble avoir l’esprit large parce que l’on a défini fort étroitement le monde social et le type d’êtres que l’on est prêt à y admettre. L’inventaire est vite dressé : des objets et des sujets. Comment espérer, avec un tel système de coordonnées, encaisser la diversité des modes d’existence, la nature des entités qui habitent la Terre, qui peuplent le ciel, qui agitent les esprits, qui fondent le droit, qui établissent des peuples, qui engendrent les fictions, qui forment les valeurs ? Les Modernes se sont crus dans un monde à l’ontologie extrêmement simplifiée. La mutation écologique, c’est là au fond mon argument, est l’occasion rêvée de venir compliquer leur ontologie, d’en pluraliser les modes de vérité et, par conséquent, d’en rouvrir l’histoire. L’aventure n’est pas terminée, mais elle doit repartir sur de nouvelles bases : une autre cosmologie, une autre anthropologie. •
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don