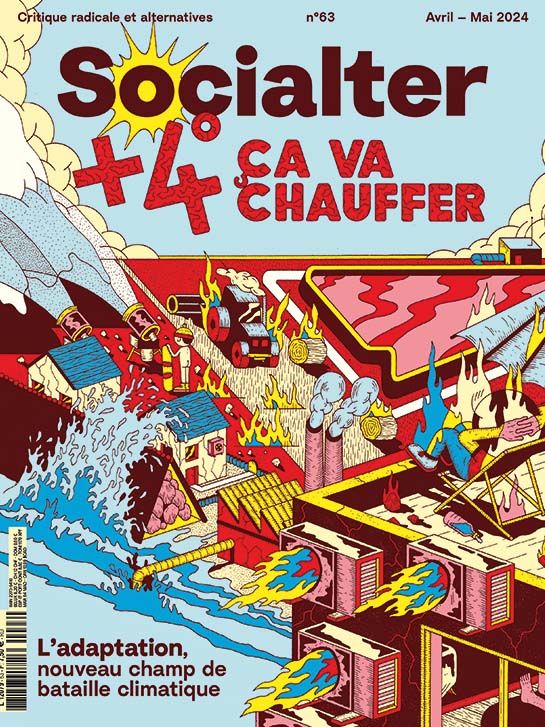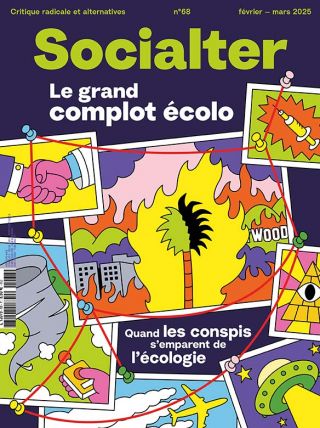Une planète fournaise, écrasée de chaleur, balayée par des tempêtes inouïes. L’eau y est si rare, que chaque goutte de sueur ou de salive, que les larmes même, sont précieuses. Tel est le décor où atterrit Paul Atréides dans Dune, saga de SF culte portée à l’écran par Denis Villeneuve, dont le deuxième volet a déjà réuni plus de 3 millions de spectateurs en France. Récit épique d’une acclimatation aux contraintes d’une planète étuve, Dune affole le box office, au moment où les températures mondiales battent record après record.
Article issu de notre numéro 63 « +4°, ça va chauffer ! », disponible sur notre boutique.
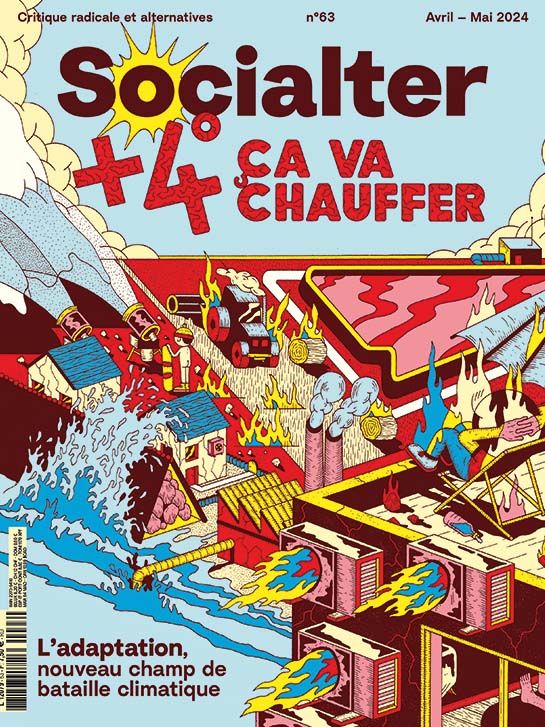
Contrairement à Paul Atréides, nous n’avons pas changé de planète. Mais, sous l’effet de la concentration continue de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, le climat de la Terre évolue désormais de façon palpable autour de nous. En France, les vagues de chaleur, la sécheresse et les feux de l’été 2022 ont précipité les projections des rapports du GIEC dans le domaine du proche et du sensible.
Des chercheurs du CNRS et de Météo-France ont estimé que le réchauffement avait déjà atteint en moyenne + 1,7°C dans l’Hexagone par rapport au début du XXe siècle. En se basant sur le scénario intermédiaire du GIEC (+ 2,7°C en moyenne mondiale en 2100) – proche de la tendance actuelle –, leur étude démontre que la France de la fin du siècle pourrait être… 4°C plus chaude que celle de 1900. Un chiffre alarmant repris depuis comme « trajectoire de référence » par le gouvernement. Alors que la réduction massive des émissions anthropiques reste le premier impératif pour maintenir l’habitabilité de la Terre, un deuxième front s’ouvre désormais dans la bataille contre le désastre climatique : celui de l’adaptation.
Sainte-Soline : première bataille de l’adaptation
Essor de la climatisation, recours à la neige artificielle, multiplication des mégabassines… Les réponses technosolutionnistes à la hausse des températures et à la raréfaction de l’eau se déploient déjà partout en France. Le plus souvent hors de tout contrôle démocratique et parfois à grand renfort d’argent public, comme l’a pointé la Cour des comptes dans son rapport dédié aux stations de ski en février 2024. Contre les formes multiples de la « maladaptation » – gaspilleuse des ressources communes, souvent contre-productive – il est grand temps de réinterroger nos choix de société.
Ce débat salutaire, les activistes de Bassines Non Merci et des Soulèvements de la Terre l’ont imposé sur la question cruciale des usages de l’eau. Sainte-Soline apparaît ainsi comme la première grande bataille écologiste de l’adaptation. En montagne, la mobilisation menée à La Clusaz (Haute-Savoie) a abouti de son côté à suspendre le chantier d’une retenue collinaire destinée à la production de neige artificielle. Et les points chauds risquent de se multiplier, à mesure que le dérèglement climatique va mettre territoires et économies locales sous tension.
Loin des odes à l’adaptabilité néolibérales, qui laissent à chacun le soin de se tirer d’affaire, le défi de l’adaptation pose en réalité de puissantes questions politiques. Sports d’hiver, agro-business irrigué, infrastructures anachroniques… Doit-on maintenir, quoiqu’il en coûte, des modèles à bout de souffle ? Comment financer, dans les pays du Sud mais aussi en France, l’acclimatation des territoires vulnérables ? Qui doit bénéficier en priorité des politiques d’accompagnement ?
Prio aux quartiers chauds
L’adaptation climatique est en premier lieu une question de justice et de solidarité à l’échelle mondiale comme nationale : 3,3 milliards de personnes vivent dans des pays classés « hautement » ou « très hautement vulnérables » par le 6e rapport du GIEC. La plupart de ces États n’ont contribué que marginalement au réchauffement climatique. Et leurs populations, pauvres et largement dépendantes de l’activité agricole, sont déjà les plus exposées aux impacts climatiques. Or les flux actuels des financements internationaux dédiés à l’adaptation restent, d’après l’ONU, 10 à 18 fois inférieurs aux besoins réels.
Cette vulnérabilité différenciée se retrouve également en France. « Aucune des politiques de l’État à ce jour ne prend en compte les inégalités sociales, alerte Quentin Ghesquière, de l’association Oxfam. Or, en fonction de votre statut social, vous n’avez pas la même capacité d’adaptation et votre vulnérabilité est différente. » Les vagues de chaleur impactent ainsi plus fortement les personnes âgées ou malades, celles travaillant en extérieur, ou le personnel soignant.
Mais aussi les résidents des logements surpeuplés ou mal isolés. Oxfam plaide ainsi pour une géographie prioritaire de l’adaptation. « Pourquoi n’y a-t-il pas dès aujourd’hui un développement massif de la végétalisation dans les quartiers populaires ? », interroge Quentin Ghesquière. La question du financement est également fondamentale dans la définition d’une adaptation juste. « Les fonds destinés à l’adaptation doivent être abondés par les responsables de la crise climatique, c’est à dire les grandes entreprises émettrices de gaz à effet de serre : BNP Paribas, TotalEnergies. » En plus de la taxation des superprofits, Oxfam réclame un « ISF climatique » dont une part des recettes serait redirigée vers l’adaptation.
S’adapter, c’est renoncer ?
Éminemment politiques, les choix d’adaptation sont aujourd’hui largement confisqués par des acteurs puissants, soucieux de préserver l’ordre économique en place. Fermant la porte au débat, le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau a ainsi promis lors du congrès de la FNSEA de lancer une centaine de chantiers de mégabassines en 2024, en réduisant les possibilités de recours juridique. À rebours de cette vision autoritaire, certaines expérimentations en cours dans les territoires les plus exposés ouvrent, selon l’urbaniste Marie-Hélène Lafage, la voie d’une adaptation démocratique. Elle s’intéresse par exemple, dans un ouvrage à paraître (Les Métamorphoses, non édité), au déplacement de la commune ultra-marine de Miquelon (600 habitants), menacée de submersion. Initialement imposé d’en haut par l’État, ce projet a finalement abouti à une discussion tripartite, confrontant les positions des scientifiques, des pouvoirs publics et des citoyens. « Ce triangle est opérant à mes yeux et en même temps il est très exigeant, au vu de la défiance actuelle à l’égard des institutions et des scientifiques », analyse-t-elle.
L’appropriation démocratique des enjeux de l’adaptation pose une autre difficulté majeure, que résume Vivian Dépoues, économiste à l’Institute for Climate Economics : « Comment faire de projections a priori abstraites des éléments de l’expérience collective ? » Jusqu’à aujourd’hui, les sociétés se sont en effet toujours adaptées à la variabilité du climat sur la base de situations vécues, alors que le dérèglement climatique nous confronte de manière accélérée à l’inédit. Un effort de vulgarisation poussé s’impose aux scientifiques, aux yeux de Marie-Hélène Lafage, qui souligne le rôle de relais que jouent déjà des associations comme Vercors Citoyen ou l’Observatoire citoyen du littoral Morbihannais, pour partager les savoirs sur l’eau ou l’évolution du trait de côte.
L’adaptation au changement climatique suppose enfin de nombreux renoncements. Mais il faut pour cela que les « communs négatifs » – du modèle du tout-ski à l’urbanisation en zone submersible – soient identifiés comme tels, souligne le philosophe Alexandre Monnin. Dans chaque cas, une enquête collective est nécessaire, indique-t-il dans Politiser le renoncement (Divergences, 2023), « pour les faire reconnaître pour ce qu’ils sont […] : des ruines ruineuses dont il convient d’hériter pour les faire atterrir et les transmuer en ruines ruinées ». À l’image des 200 installations liées aux sports d’hiver – télésièges, tire-fesses, hôtels… – déjà abandonnées, faute de neige, dans les pentes des montagnes françaises.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don