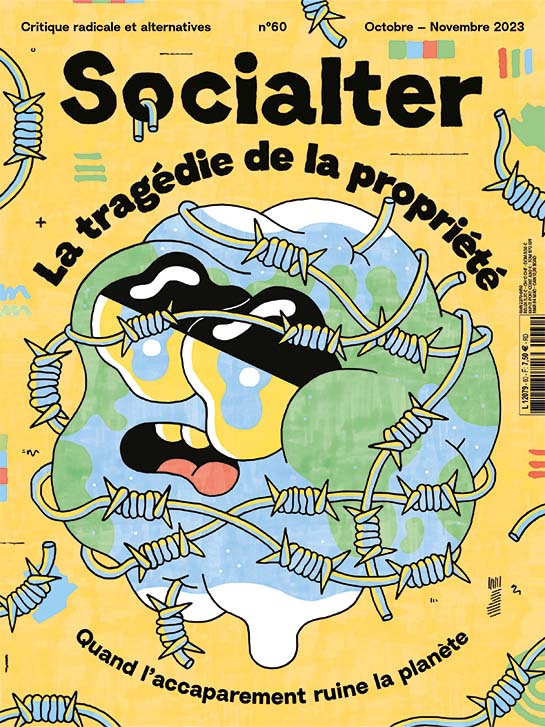Vous ne pourrez pas y saliver devant une rivière de chocolat ni croiser le moindre Oompa Loompa. Chocolate World n’en porte pas moins la promesse d’un monde que ne renierait pas Willy Wonka. L’attraction, incluant un atelier voué à la confection de votre barre de chocolat personnalisée, est entièrement dédiée à la gloire des produits Hershey’s et de son fondateur, Milton Hershey. Le capitaine d’entreprise n’a pas seulement donné son nom au groupe pesant actuellement 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. Au début du XXe siècle, il a également imprimé sa marque en Pennsylvanie, en faisant bâtir une ville entière autour de sa chocolaterie. Écoles, églises, parcs, zoo : les employés d’Hershey devaient tout à leur patron.
Article issu de notre numéro 60 « La tragédie de la propriété », en librairie et sur notre boutique.
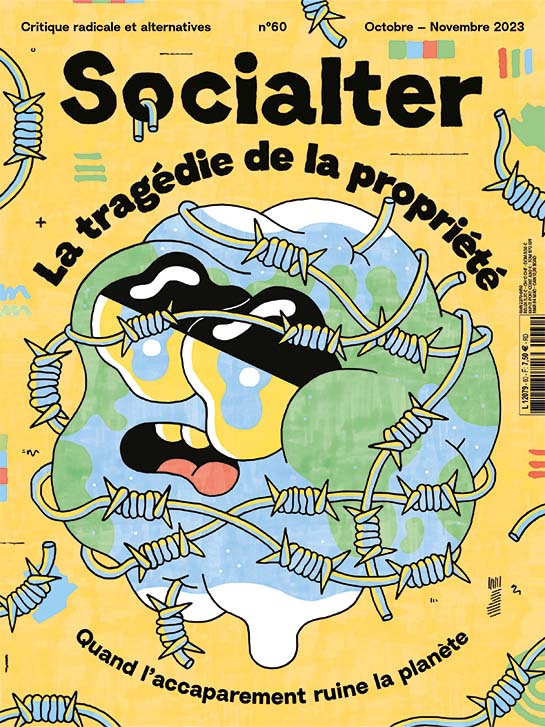
Aujourd’hui, la ville et ses 14 000 habitants ne sont plus le parangon du capitalisme paternaliste. L’ombre de l’empire du chocolat, elle, plane toujours sur chaque coin de rue. Littéralement. À Hershey, un carrefour voit se croiser Chocolate Avenue avec son ingrédient essentiel : Cocoa Avenue. Aucun chocolat, qu’il soit au lait ou noir, pur à 50, 70 ou 80 %, mangé sous forme de tablette ou bu accompagné de lait chaud, ne peut se passer des fèves du cacaoyer. De son nom scientifique Theobroma cacao (le premier mot signifie « nourriture des dieux »), cet arbre s’épanouit sous la chaleur des latitudes tropicales, là où les températures ne descendent pas sous les 18 °C, tout en prisant les places à l’ombre. « C’est une plante qui a besoin de beaucoup d’eau, au moins 1 200 millimètres de précipitations par an et une saison sèche ne durant pas plus de trois mois, précise Martijn ten Hoopen, responsable de la filière cacao au Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement). Voilà pourquoi on retrouve le cacaoyer dans les forêts tropicales humides en Afrique, en Asie et en Amérique. »
« Davantage destinée aux cochons qu’aux hommes »
C’est sur ce dernier continent que le cacaoyer a pour la première fois pointé le bout de ses branches, très probablement dans le bassin amazonien. « Mais sa culture semble bien une innovation méso-américaine, au plus tard de l’époque olmèque, un peu avant le début de notre ère, souligne le géohistorien Christian Grataloup dans son livre Le Monde dans nos tasses. Trois siècles de petit déjeuner (Armand Colin, 2017). C’est sans doute à cette civilisation que l’on doit le mot même ; kakau serait un terme de la langue mixe-toque,celle des Olmèques, qui a essaimé dans toutes les langues d’Amérique centrale, dont le nahuatl, l’idiome des Aztèques. » Signe de leur valeur tant pour ces derniers que pour les Mayas, les fèves de cacao tiennent lieu de monnaie d’échange lorsqu’elles ne sont pas séchées, torréfiées, broyées en vue de leur consommation sous la forme d’un breuvage restant alors réservé aux élites.
On pourrait imaginer les premiers Européens arrivés en Amérique prenant immédiatement goût au chocolat. En réalité, il suscite plutôt de la méfiance, voire du dégoût. Dans son Histoire du nouveau monde publiée en 1565, le Milanais Girolamo Benzoni y voit par exemple « une boisson davantage destinée aux cochons qu’aux hommes ». Comme l’expliquent Sophie et Michael D. Coe dans leur ouvrage consacré à l’histoire du chocolat, son adoption par les colons, puis sur le Vieux Continent, se fait au prix de quelques ajustements. Les Européens l’aiment chaud quand les Aztèques le boivent froid ou à température ambiante. L’incorporation de sucre contrebalançant l’amer du cacao contribue aussi à porter le chocolat aux lèvres des nobles d’Espagne, d’Italie ou de France.
Dans le monde, 12 millions d’hectares sont dévolus à la culture du cacaoyer, là où il n’y en avait que 4,4 millions en 1960.
Estimée entre 8 000 et 10 000 tonnes par an seulement à la fin du XVIIIe siècle par l’historien Nikita Harwich, la consommation de cacao en Europe, et donc de chocolat, change de forme au siècle suivant. En tablette ou en barre, il en vient à être davantage mangé que bu, sous l’impulsion d’industriels comme Francis Fry, Philippe Suchard, John Cadbury ou Antoine Brutus Menier. Dans le même temps, les quantités avalées s’envolent. « Les deux grands marchés de consommation que sont l’Union européenne et les États-Unis ont atteint des niveaux de saturation élevés. Les Européens mangent de nos jours entre 5 et 10 kilos d’équivalent cacao par habitant et par an », note Michel Arrion, directeur exécutif de l’Organisation internationale du cacao (ICCO). C’est donc sous des palais traditionnellement moins fondus de chocolat que le cacao se ménage une place grandissante, par exemple dans les pays du Sud-Est asiatique où il s’est imposé comme marqueur de statut social.
Le cacao prend de l’aire
Quarante années ont ainsi suffi pour voir tripler les volumes de fèves de cacao produites, passant de 1,5 million de tonnes en 1981-1982 à près de 5 millions en 2021-2022. Un bond qui s’explique aisément, selon Martijn ten Hoopen : « Durant cette période, il n’y a pas eu de réel gain de productivité. Cette production accrue a été en réalité le fruit d’une augmentation des surfaces. » De fait, le Cirad estime à 12 millions le nombre d’hectares dévolus dans le monde à la culture du cacaoyer, là où il n’y en avait que 4,4 millions en 1960. Une telle extension du domaine du cacao aurait été impossible sans grignoter, pour ne pas dire dévorer, de vastes zones forestières.
Ce phénomène n’est nulle part plus manifeste que dans le pays du cacao par excellence : la Côte d’Ivoire, premier producteur mondial devant son voisin ghanéen et l’Équateur. Michel Arrion plante le décor : « 15 % du PIB ivoirien est issu du cacao. Les fèves y sont cultivées par 1 million de personnes qui en font vivre 5 millions, soit plus de 20 % de la population. » Leur place éminente dans l’économie ivoirienne est l’arbre qui cache les forêts volatilisées. En l’espace de 60 ans, le pays a perdu 80 % de son couvercle forestier. Quelle part imputer à la culture du cacao ? La réponse est donnée par une étude publiée en janvier dernier. Selon ses auteurs, il était à l’origine de 45 % de la dégradation ou de la destruction des forêts entre 2000 et 2019. « Dans ces forêts qui ont des millions d’années, le sol est extrêmement riche. Il n’y a pas besoin d’engrais pour que vos cacaoyers poussent comme des champignons, ajoute Michel Arrion. Mais lorsque ce sol est épuisé au bout de vingt ans, vous devez déplacer votre plantation. »
Un règlement européen récemment adopté, et qui entrera en vigueur en 2025, est censé permettre de stopper cette avancée du front du cacao, qui menace également les forêts du bassin du Congo, au Gabon ou au Cameroun. Il interdira aux membres de l’UE d’importer les produits issus de toute déforestation ou dégradation des forêts menée après le 31 décembre 2020. « J’étais en faveur d’une date bien antérieure, surtout pour le cacao, parce que cela donne une prime importante aux pays d’Afrique de l’Ouest qui ont déjà déforesté massivement, regrette Guillaume Lescuyer, chercheur au Cirad. En Afrique centrale, cette date est difficile à avaler parce qu’elle crée une forme de concurrence déloyale au profit de la Côte d’Ivoire et du Ghana. »
Une traçabilité lacunaire
Cette nouvelle législation implique que les entreprises exportant du cacao, comme les géants Barry Callebaut ou Cargill, connaissent sa provenance exacte. Un impératif tenant de la gageure car les fèves sont souvent cultivées sur des parcelles de quelques hectares. Chercheuse à l’Earth and Life Institute de l’université de Louvain, Cécile Renier a pu le constater en travaillant sur les exportations de cacao ivoirien à partir des données publiées par les entreprises : « Notre étude montre que 43 % de ce cacao est traçable jusqu’à une coopérative, mais nous n’avons pas le dernier maillon de la chaîne menant à la plantation alors qu’une coopérative s’approvisionne en moyenne dans un rayon de 25 à 45 kilomètres. » Au-delà des difficultés techniques posées par ce besoin de traçabilité, Guillaume Lescuyer s’interroge aussi sur la répartition de son coût, un point qu’il juge « crucial » mais sur lequel les principaux acteurs de la filière font preuve d’attentisme : « Si Cargill et les autres ne se voient pas obligés d’assumer une part importante de ce coût, ils pourraient le reporter à la fois en aval et en amont. Un des risques, c’est d’avoir une diminution du prix d’achat du cacao au producteur, qui est déjà scandaleusement bas. »

Sources : Organisation internationale du cacao, 2022-2023.
La récente hausse du cours du cacao, qui a atteint les 3 400 euros la tonne mi-septembre, un niveau inédit depuis des années, ne saurait garantir un revenu suffisant pour les producteurs en dehors des marchés de niche et du haut de gamme. Selon la Banque mondiale, plus de la moitié d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté en Côte d’Ivoire. « Tout le monde gagne beaucoup d’argent dans le cacao, sauf le producteur. Lorsqu’un consommateur européen consomme pour 10 euros de chocolat, il n’y a que 50 ou 60 centimes qui reviennent au cultivateur », résume Michel Arrion. Même avec de si faibles rémunérations, le moindre coup de pouce se négocie d’arrache-pied. Fin 2019, la Côte d’Ivoire et le Ghana avaient publiquement pointé du doigt Mars et Hershey en les accusant de se soustraire à leur obligation de verser aux producteurs un « différentiel de revenu décent », fixé à 400 dollars la tonne.
Des pluies erratiques
Vivant déjà difficilement du fruit de leur travail, les producteurs doivent en plus faire face à un changement climatique rebattant les cartes des zones les plus propices à la culture du cacaoyer. L’arbre, amené à prendre racine plus au nord de l’équateur ou à des altitudes plus élevées en raison d’une hausse des températures, se retrouve soumis à un bouleversement du régime des pluies mettant sens dessus dessous le calendrier usuel. « Le problème est que les saisons sont moins régulières. Lorsqu’un agriculteur ne sait plus exactement à quel moment la saison des pluies commence, cela devient plus difficile pour lui de planifier son activité », insiste Martijn ten Hoopen. Céline Renier témoigne des inquiétudes des producteurs, rencontrés lors d’un déplacement en Côte d’Ivoire en mars 2022 : « Cette période est censée marquer le moment de la reprise des pluies. Partout, les planteurs tiraient la sonnette d’alarme et se plaignaient qu’il ne pleuvait plus. »
Cette année, les précipitations se sont révélées abondantes en juin et juillet. Trop abondantes même. Les Ivoiriens s’attendent à une mauvaise récolte après ces pluies diluviennes qui ont empêché la bonne floraison des cacaoyers et déroulé le tapis rouge à la pourriture brune, qui s’attaque aux cabosses renfermant les fèves. Au total, un tiers de la production mondiale de cacao serait perdue chaque année à cause des maladies et autres ravageurs. Le CSSV, ou swollenshoot, est à l’origine des plus gros dégâts en Côte d’Ivoire et au Ghana. Cette maladie, connue depuis des décennies mais demeurant incurable, provoque la mort des cacaoyers en se transmettant le plus souvent via les cochenilles. Tout en se montrant prudent sur l’éventuel lien entre la diffusion accrue du swollen shoot et une hausse des températures, Martijn ten Hoopen remarque que la maladie a bénéficié de l’augmentation de la production de cacao en plein soleil pour se propager.
De quoi apporter de l’eau au moulin de ceux qui défendent la nécessité de privilégier des systèmes agroforestiers, pour permettre d’entretenir la fertilité des sols et de garantir une plus grande biodiversité. L’agroforesterie offre également aux producteurs la possibilité de diversifier leurs sources de revenus, un levier qui fait figure de nécessité aux yeux de Michel Arrion : « La cacaoculture ne doit pas dépendre exclusivement du cacao. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. » Reste que l’idée n’est pas accueillie avec le même degré d’enthousiasme par l’ensemble de la filière, selon Stéphane Saj, scientifique à l’Institut de recherche en agriculture biologique (Suisse) : « C’est entendu par des petits et moyens industriels. Cela l’est beaucoup moins par des acteurs comme Mars qui ont besoin de grandes quantités de cacao pour maintenir leurs propres volumes de production. » Et pour ne pas prendre le risque de lâcher la barre.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don