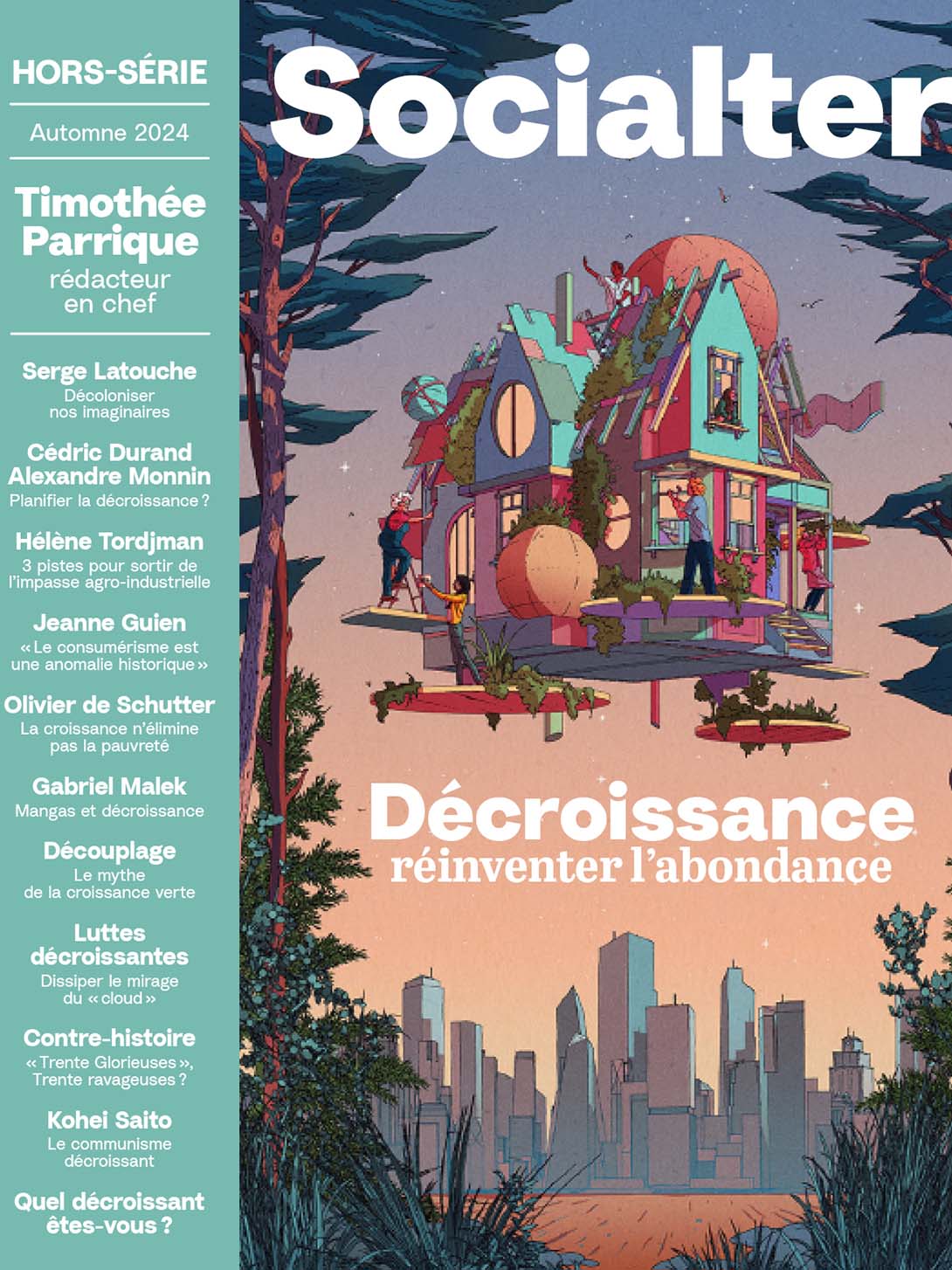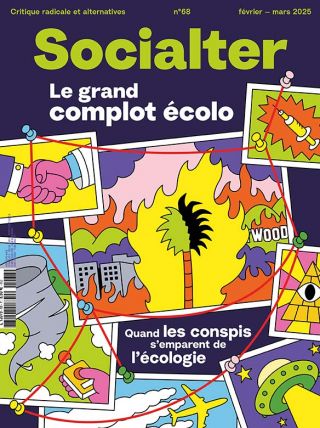Cliché : la décroissance est liberticide
Dans une interview, un ancien ministre de l’Éducation nationale devenu polémiste de droite avance que « la décroissance est invendable démocratiquement1 ». Mais ni la décroissance ni la démocratie ne sont à vendre.
Pour Luc Ferry, la décroissance c’est le catastrophisme, la démocratie c’est la démocratie représentative, la liberté c’est la liberté individuelle. C’est pourquoi quand on reproche à la décroissance d’être liberticide ou antidémocratique, nous devons nous poser trois questions : de quelle décroissance parle-t-on ? De quelle liberté ? De quelle démocratie ?
Article à retrouver dans notre hors-série « Décroissance : Réinventer l'abondance », disponible en librairie et sur notre boutique.
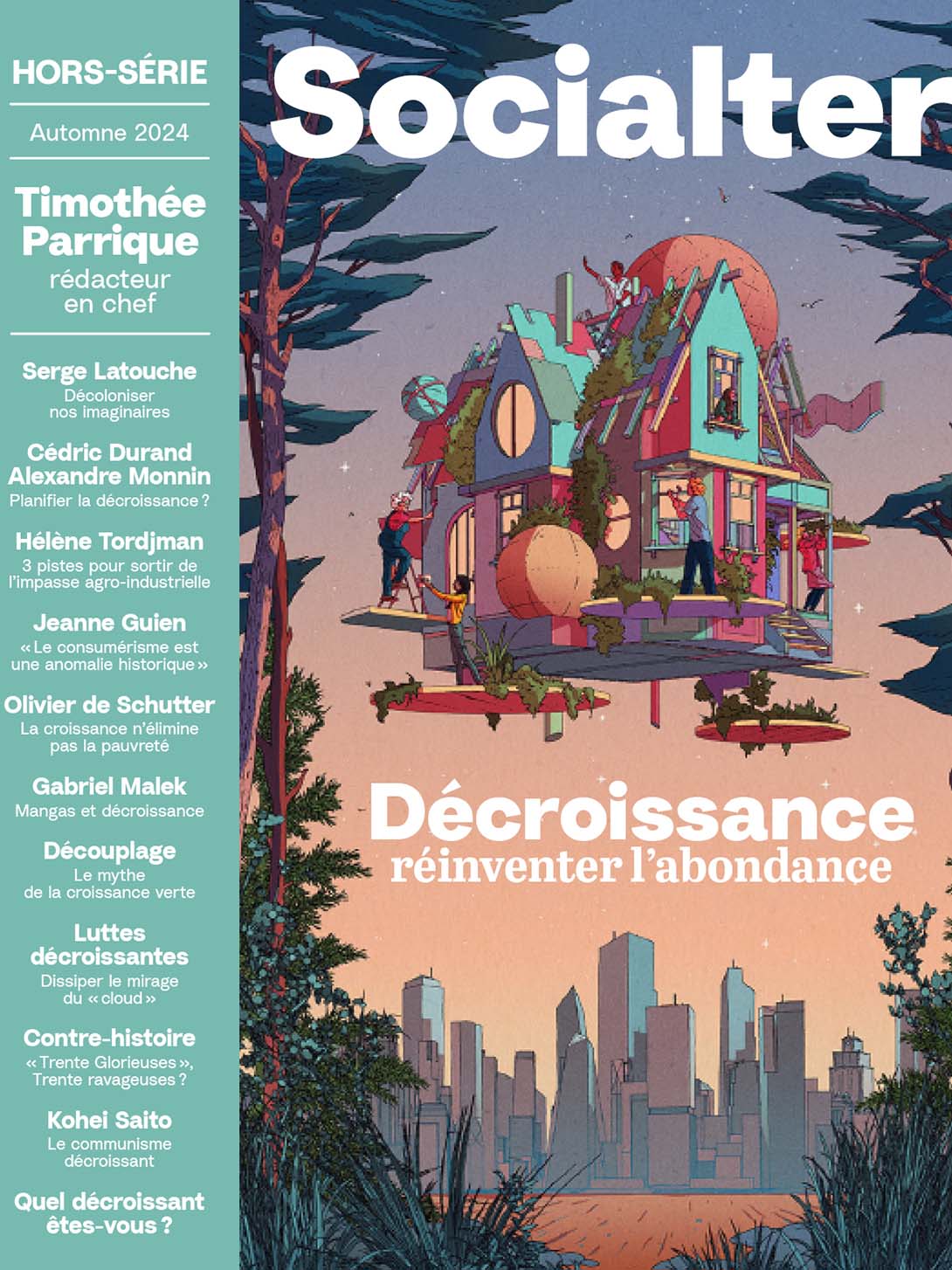
S’il ne faut absolument pas refuser l’apport conceptuel de la notion d’effondrement, les décroissants et décroissantes ne sont pas pour autant des adeptes de la catastrophe. Nous nous opposons radicalement à l’argument de la nécessité2, qui serait : l’effondrement étant inéluctable, nous n’aurions qu’à nous y résigner et nous y adapter. En plus d’être de nature à paralyser par l’angoisse qu’elle inspire, cette pensée porte surtout les germes d’une dépolitisation de l’écologie. Qui pourrait imaginer de manifester contre la loi de la chute des corps ?
La décroissance est au contraire un programme politique commun, qui ne peut être réduit au slogan « there is no alternative ». Ce n’est pas la crise écologique qui fait de nous des décroissants et décroissantes, car même si nous étions dans un monde aux ressources infinies et aux richesses illimitées, nous défendrions une société à la production plafonnée et sans « exploitation » ni de la nature ni des humains. C’est donc bien par choix idéologique que nous souhaitons un monde socialement juste, décent et écologiquement responsable.
Ce choix, c’est celui de la liberté ; mais laquelle ? Celle de prendre l’avion pour aller à Bordeaux, comme le suggère Luc Ferry ? À l’opposé d’une conception libérale de la liberté qui ne rêve que de s’affranchir des limitations, c’est bien une liberté sociale redéfinie souverainement par et avec toutes et tous que les décroissants et décroissantes défendent politiquement, liberté sociale totalement opposée tant à la liberté libérale du renard dans le poulailler qu’à la liberté profondément individualiste du survivaliste en temps d’effondrement. Et cette liberté-là n’est ni à vendre ni à acheter. Car il faut effectivement définir la liberté par rapport à la notion de limites ; car une liberté sans limites, ce serait celle du tyran.
Mais là où le libéralisme ne conçoit la limite à franchir que comme une seule ligne, pourquoi ne pas imaginer un espace conçu à partir d’une double limite ? Les décroissants s’inspirent alors du concept d’espace écologique, inventé par les Amis de la Terre, qui est défini par une limite plafond et une limite plancher. Toute politique doit garantir à chacun un plancher minimum de vie (alimentation, santé, éducation, habitat…) tout en restant sous les plafonds de la soutenabilité planétaire3.
Contre les mantras du « toujours-plus » et du « encore-mieux », la démarche simplicitaire prône le « suffisant » en questionnant ce que signifie « bien vivre » et « avoir besoin ».
L’espace situé entre plafond et plancher est celui d’une liberté sociale, vécue en commun car en dessous ou au-dessus la vie est « hors du commun » : pour les décroissants, la liberté est d’abord cette liberté socialement vécue, qu’il faut entretenir, protéger, conserver. Effectivement, elle n’a pas de prix !
Quant à la démocratie, les décroissants plaident pour son extension : non seulement là où elle y est quasi étrangère, l’économie, mais aussi là où elle devrait régner, la politique.
Quel paradoxe en effet que cette thèse selon laquelle l’économie de marché favoriserait la démocratie alors que celle-ci s’arrête au portail des usines ? Le « monde du travail » est un monde de rapports de force où les dominés subissent de plein fouet les inégalités de revenus qui les privent des moyens pécuniaires de faire durer la moindre résistance.
Il ne s’agit pas de se passer de la démocratie représentative – à moins de croire qu’il serait impossible de confier à d’autres la responsabilité de nous représenter –, mais de la combiner, dans un mix démocratique, avec de la démocratie participative et de la démocratie directe. Donner à des assemblées populaires un droit de veto temporaire, un droit de convoquer des conventions citoyennes, un droit à référendum… En s’inspirant des votations suisses mais aussi en élargissant le domaine du tirage au sort.
Vastes chantiers pour la décroissance : resocialiser la liberté au lieu de l’individualiser, étendre la démocratie au lieu de la restreindre.
Malentendu : Pour décroître, il suffit de vivre plus simplement
La simplicité volontaire est plus que légitime lorsqu’elle exprime une véritable démarche pour se défaire au quotidien de la logique consumériste dans laquelle nous baignons, et qui, en s’appuyant sur la publicité, dresse nos corps, structure nos rapports sociaux et alimente nos imaginaires. Il s’agit alors de refuser de participer autant que possible à cette société, à l’économie libérale et à la « consommation du monde », et de mettre en application un principe éthique de cohérence : vivre selon ses valeurs (sobriété, simplicité, convivialité) en les appliquant au sein des différentes dimensions de l’existence, dans la satisfaction de ses besoins essentiels – se vêtir, se nourrir, se chauffer, s’habiller, habiter, s’occuper...
Contre les mantras du « toujours-plus » et du « encore-mieux » véhiculés par le monde de la croissance, la démarche simplicitaire prône le « suffisant » en questionnant ce que signifie « bien vivre » et « avoir besoin ». Il s’agit donc bien de porter une critique politique au prisme de son mode de vie, en réinterrogeant ce qui apparaît naturel dans notre quotidien bombardé par la publicité, et l’importance symbolique et sociale accordée aux possessions matérielles.
Il ne faut donc pas confondre la démarche décroissante de simplicité volontaire avec le développement personnel, qui vise à la transformation de soi, soit pour se défaire de certains aspects pathologiques (phobie, anxiété, déprime, timidité), soit pour améliorer ses performances (mieux communiquer, gérer son temps, s’affirmer) ; toutes ces variantes du greenwashing ne font que renforcer la croyance individualiste que les « petits gestes » représentent l’alpha et l’oméga de nos puissances d’agir...
Après avoir clarifié la simplicité volontaire telle qu’il faut l’entendre dans une perspective décroissante, la deuxième étape consiste justement à la distinguer de la décroissance. Pourquoi ? Parce qu’on entend trop souvent qu’il suffirait qu’une majorité d’entre nous change de mode de vie pour que la décroissance s’installe, voire que la décroissance a commencé, puisque certains la pratiquent déjà au quotidien. Dans cette optique, il arrive même de voir rejeté tout effort de théorisation politique et historique de la décroissance sous prétexte que vivre de façon frugale, ce serait la « vraie » décroissance, et qu’il n’y a pas besoin d’aller chercher plus loin. Or, si la simplicité volontaire est importante, elle n’est pas suffisante pour faire basculer la société vers la décroissance.
« Trouver seul le sens de sa vie est une chimère, le sens de la vie est éminemment politique »
Parce que l’action individuelle ne peut pas tout, comme le calcule une étude du cabinet Carbone 4 (« spécialisé dans la stratégie bas-carbone et l’adaptation au changement climatique ») : « l’impact probable des changements de comportement individuel pourrait stagner autour de 5 à 10 % de baisse de l’empreinte carbone, guère plus4 ».
C’est pourquoi il est nécessaire au contraire d’emprunter un chemin politique pour porter la critique de la croissance et de son monde. Ce chemin, c’est celui entre autres de la critique de l’individualisme, racine enfouie du monde de la croissance, sans lequel nous ne pourrons pas espérer construire une société fondée sur un idéal de coopération et de décence. Il faut s’apercevoir que presque toutes les fables de la croissance reposent sur une fable commune quant à l’origine de ce qui fait une organisation sociale : celle selon laquelle l’individu précéderait la société, qui serait d’abord une juxtaposition d’individus.
Affirmer que le changement procède de l’addition des comportements individuels, aussi vertueux soient-ils, ou même qu’il commence par soi, c’est rester prisonnier des cadres conceptuels individualistes du monde de la croissance. Si donc les décroissants et décroissantes veulent réellement rêver d’une société fondée sur le partage, il faudrait qu’ils approfondissent davantage le « lâcher-prise de soi ». La transformation sociale et politique attendue passera par la lutte pour un idéal politique : celui de la recherche collective et commune de ce qui fait sens dans une vie humaine. Question à laquelle, en tant que décroissants, nous avons tranché en faveur de la plus belle des réalités : « Trouver seul le sens de sa vie est une chimère, le sens de la vie est éminemment politique5 », il nous est commun.
Malentendu : Pour décroître, il suffit que les alternatives essaiment
Est-ce par la mise en œuvre de milliers d’alternatives concrètes que nous « emprunterons » le chemin de la décroissance6 ?
Reconnaissons d’abord que ces alternatives qui fleurissent sont nécessaires parce qu’elles nous engagent en tant que personnes dans des relations sociales nourrissantes et dévolues à des projets porteurs de valeurs et de sens, répondant ainsi à nombre de nos besoins fondamentaux. Par ailleurs, ces alternatives sont indispensables parce que ce sont des expérimentations qui abordent tous les champs de la vie sociale (alimentation, habitat, éducation, etc.).
Or nous connaissons l’investissement que ce militantisme demande. La tête dans le guidon, pédale cette croyance qu’être dans le concret et dans l’action permettra de faire avancer et réussir le projet, qui par son exemplarité pourra alors être dupliqué, et essaimer. Chacun faisant sa part, un peu partout, la masse critique alors franchie, les oasis suffisamment nombreux, les archipels suffisamment en réseau, par effet de basculement, le changement de système adviendra.
Mais le remarquable développement des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) nous dévoile pourtant la limite de cette croyance. Le rapport de force actuel en faveur de l’agroproductivisme en est-il inversé ? Le réempaysannement structurel des territoires restera impossible tant que sera faite l’impasse sur la non-prise en compte du paysage institutionnel existant et de son histoire. Sans réflexion sur le rôle et l’articulation des institutions telles que l’État et les collectivités territoriales, les Safers, etc. Sans théoriser la gradation des politiques publiques selon ces échelons de pouvoirs, selon la faisabilité temporelle, sans réfléchir à l’acceptabilité des réformes et des ruptures. Là est notre critique du schéma historique de l’essaimage, comme l’avait d’ailleurs déjà faite les socialistes marxistes du XIXe à l’encontre des socialistes utopiques avec leurs phalanstères, coopératives et mutuelles.
Autre limite identifiée : une certaine insensibilité à l’histoire dans les milieux alternatifs, qui conduit à reproduire des expérimentations vouées à l’échec parce que trop souvent n’a pas été produit l’effort de tirer les leçons de l’histoire, comme si chaque génération devait réinventer, innover, refaire le monde à partir d’une table rase.
Ni les hippies des années 1970 ni les néoruraux ayant quitté l’hideuse et ignominieuse ville pour la bucolique campagne n’ont pris soin d’identifier et de comprendre les naturiens, ces « [p]ourfendeurs des ravages de l’industrialisation, du mythe du progrès et de l’expansion impérialiste », qui « ont milité, jusqu’à l’expérimentation concrète, pour une vie simple et frugale, fondée sur le refus des marchandises frelatées7 ». Ces anarchistes individualistes du XIXe inaugurèrent une première vague. Avec le Covid, une nouvelle vague semble quitter les métropoles et échouera probablement sur le rivage d’un nouvel archipel.
Les décroissants et décroissantes, en faisant l’effort de s’accorder le temps du recours à l’histoire, pointent l’insuffisance du « autrement » proposé dans les alternatives (se nourrir autrement, habiter autrement, etc.) ; « alternatives » à quoi ? Dans « à quoi », il faut distinguer le « contre quoi » (et dans ce cas, les alternatives restent dans l’anti) et le « vers quoi ».
En outre, trop souvent, le refus de replacer au nom du « concret », du « pratico-pratique » ces alternatives dans une perspective idéologique frise avec l’anti-intellectualisme. Or c’est d’articulation entre théorie et pratique, et d’une sensibilité à l’histoire vaccinée contre le culte anhistorique du « nouveau » et de la « première fois » dont nous avons besoin, les libéraux qui ont gagné l’hégémonie culturelle l’avaient bien compris.
En se contentant d’une perspective tronquée8, cela ne peut que renforcer le mouvement de fond dont a tant besoin le capitalisme pour continuer ses affaires. « Emprunter » le trajet de la décroissance, c’est certes reconnaître l’intérêt et la nécessité des alternatives, mais en les passant par l’analyse des pratiques tout en les inscrivant dans une perspective politique, idéologique, systémique.
Sources :
1. Dans un grand entretien paru dans L’Express le 17 avril 2021.
2. Lire l’article fondateur de cette expression : Michel Dias, « Un idéalisme politique » dans le premier numéro de la revue Entropia (automne 2006).
3. En 2017, l’économiste britannique Kate Raworth publiait Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist (traduction française : La Théorie du donut. L’économie de demain en 7 principes, Plon, 2018). Pour en savoir plus sur l’« économie du donut », voir notre lexique d’économie écologique.
4. César Dugast et Alexia Soyeux (dir.), Faire sa part ? Pouvoir et responsabilité des individus, des entreprises et de l’État face à l’urgence climatique, Carbone 4, 2019.
5. Giacomo D’Alisa, Federico Demaria, Giorgos Kallis (coord.), Décroissance. Vocabulaire pour une nouvelle ère, Le Passager clandestin, 2015.
6. Bénédicte Manier, Un million de révolutions tranquilles, Les Liens qui libèrent, 2012.
7. François Jarrige, Gravelle, Zisly et les anarchistes naturiens contre la civilisation industrielle, Le Passager clandestin, 2016. Voir : « Les précurseurs de la décroissance », p. 80.
8. Michel Lepesant, « Plaidoyer critique pour les intermédiaires », conférence du 9 octobre 2021 au Festival de l’ESS.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don