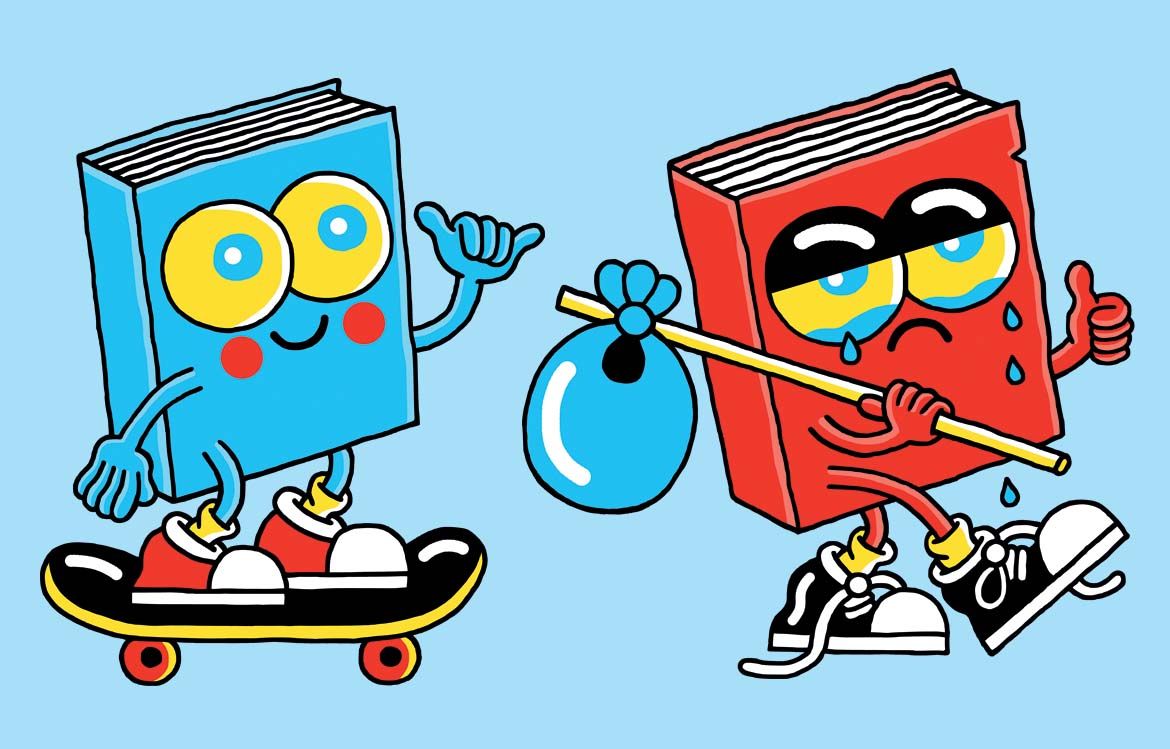Leur métier est invisible au public. Mais, à la croisée des livres et des médias, les attachées de presse de l’édition disposent du meilleur thermomètre pour juger de l’espace consacré à la production des idées. Ces temps-ci, la météo n’est pas engageante : « Il y a très peu de place pour les sciences humaines, déplore-t-on chez un grand éditeur de la recherche. Les livres qui ne collent pas à l’actualité n’intéressent généralement pas les journalistes. »
Article issu de notre hors-série « Manuel d'autodéfense intellectuelle » avec François Bégaudeau, en librairie et sur notre boutique.
Du côté de La Découverte, la responsable du service de presse Pascale Iltis égrène les formats. La presse écrite ? Heureusement, « les pages “idées” donnent généralement la parole aux chercheurs ». La radio ? « Sur France Culture, on a perdu des émissions autour des champs d’idées, comme sur l’urbanisme, les arts plastiques, la psychanalyse. » La télévision ? « Nos débouchés sont assez limités. » Il y a surtout « 28 Minutes » sur Arte, ou encore « C ce soir » et « C politique » sur France 5.
Mais ces deux derniers plateaux sont « exclusivement actu », note Pascale Iltis. Autrement dit : les invités – essayistes, politiques, journalistes, activistes – viennent pour débattre du sujet du jour. Avoir écrit un livre constitue seulement une raison d’y participer. Cette expérience, l’ironie a voulu qu’elle arrive à Rémy Rieffel pour son dernier livre justement intitulé L’emprise médiatique sur le débat d’idées. Trente années de vie intellectuelle (1989-2019) (PUF, 2022). Que son objet d’étude « s’insère dans une actu chaude » était une condition systématique de ses invitations sur les plateaux, témoigne le sociologue des médias. Comme à « C ce soir », où il a été contacté par participer à une émission « autour de Cyril Hanouna et d’“est-ce qu’on peut débattre de tout à la télé” ».
Avec son nom qui résume l’intention d’hybrider « C dans l’air » et l’emblématique « Ce soir (ou jamais !) » de Frédéric Taddeï, l’émission lancée par Karim Rissouli début 2021 promettait pourtant de signer le retour du débat d’idées sur le service public. L’ambition n’aura guère duré, à écouter Jean-Marie Durand, qui a collaboré un an à « C ce soir » avant de partir : « Le programme a très vite glissé vers l’actu, jusqu’à mettre de côté son ambition intellectuelle. » L’auteur d’Homo Intellectus. Une enquête (hexagonale) sur une espèce en voie de réinvention (La Découverte, 2019) a entre-temps pu observer comment ses rouages marginalisent la réflexion. La logique de sélection des intellectuels, tacitement conditionnée à leur « validation » préalable par les journaux de presse écrite, trahit ainsi le logiciel des programmateurs : personne ne lit vraiment de livres.
Ainsi, ces petites mains ont « une connaissance assez large des acteurs du débat public, mais pas de la vie des idées ». Quant au présentateur, Jean-Marie Durand s’étonnait de son anticipation totale : « Frédéric Taddeï laissait l’émission exister par elle-même. Karim Rissouli, lui, structure tout par écrit en amont. Comment peut-on faire un débat d’idées si tout est déjà chapitré ? »
La concurrence des idées
L’aseptisation et le repli sur les bons clients, c’est-à-dire capables de se démarquer au milieu d’un plateau surchargé de cinq ou six invités, entérinent une tendance lourde aux yeux de l’éditeur Nicolas Vieillescazes : la « perte d’autonomie de la sphère savante », et en particulier de l’université. « Désormais, la valeur d’un travail intellectuel vient de sa médiatisation. Les savants doivent se justifier d’exister par rapport à une actualité. » Le directeur des éditions Amsterdam sourit en rappelant qu’un livre aussi complexe que Les Mots et les Choses de Michel Foucault devenait un best-seller à sa sortie, en 1966. Une inversion s’est depuis opérée, sur fond de réformes néolibérales de l’université obligeant les chercheurs à « valoriser » leur recherche pour accéder à des financements, autrement dit à « prouver leur pertinence dans le monde social, réduit à la médiatisation ». Rémy Rieffel abonde : « Les universitaires doivent rendre compte de leurs activités de vulgarisation dans les médias, ce qui revient à être évalué sur sa capacité à être un bon client. »
Nicolas Vieillescazes pousse une hypothèse inspirée par Le Salaire de l’idéal. La théorie des classes et de la culture au XXe siècle (Seuil, 1997), de Jean-Claude Milner : « Cet essai démontre qu’un compromis a été trouvé entre la bourgeoisie économique et la bourgeoisie intellectuelle durant la IIIe République [1870-1940], la première acceptant que la seconde reçoive un salaire lui permettant de se distinguer du prolétariat. Les années 1990, marquées par la dégradation symbolique du statut des intellectuels et la délégitimation du savoir, ont marqué la fin de ce compromis social. » Exit les choses de l’esprit, donc. Dans son étude L’emprise médiatique sur le débat d’idées, Rémy Rieffel n’aboutit pas à une conclusion différente : la vie des idées a été « exposée à l’expansion du nouvel esprit du capitalisme, à l’essor du néolibéralisme qui privilégie avant tout la performance concurrentielle et qui s’étend à tous les secteurs de la production et de la diffusion culturelles », écrit le chercheur.
Journalisme cherche idées
Cette « intensification de la logique marchande » relevée par le sociologue touche tout autant la sphère médiatique. Joseph Confavreux, qui a passé les années 2000 à France Culture avant de rejoindre Mediapart en 2011, déplore un « appauvrissement des formes » dans le traitement des idées. Le corédacteur en chef de la Revue du Crieur cible en particulier France Culture et Arte, qui ne font « plus le boulot ». En témoigne la quasi-disparition des émissions autour des essais, telles que « L’avis critique » (2017-2020) à laquelle il participait, et qui n’a jamais été remplacée. Cette éviction de la critique, le journaliste la constate aussi dans une forme devenue dominante, en particulier sur France Culture : l’entretien, qui se traduit « au mieux par de la pédagogie, au pire par de la promo ». Ce dernier se souvient du passage à Paris de la philosophe Chantal Mouffe, à l’occasion de la sortie d’un livre. « Dix journalistes “idées” des principaux médias se succédaient pour faire la même interview, qu’on allait lire partout. »
L’inflation du genre marque selon lui la tendance du journalisme d’idées à se caler sur les travers du journalisme culturel : une couverture sans aspérité ni « travail de réception », qui se contente de donner la parole. « Pour le spectacle vivant, j’ai vu le basculement dans les années 1990, où j’ai documenté la montée en puissance des systèmes de notation, avec des cœurs ou des étoiles, se substituant à la critique argumentée », témoigne Rémy Rieffel.Mais cet aplanissement n’est pas seulement de la faute des journalistes, juge Joseph Confavreux. « Les éditeurs ont une responsabilité en surproduisant, car les coûts d’impression ont baissé ces dernières années. Ainsi, énormément de livres publiés ne méritent pas de l’être. Les éditeurs nous envoient une masse de nouveautés en attendant qu’on en parle. » Et calibrent même leur production à cette fin ?
Troquer la thèse pour le tract
L’essor du format « Tracts », créé en 2019 par Gallimard, semble taillé pour se mouler dans des médias obnubilés par l’actu : ces courts écrits engagés sont un tel succès qu’ils ont été immédiatement copiés par d’autres éditeurs (« Libelle » au Seuil, « Amorce » chez 10/18, « Les Imprimés » d’AOC…). Alban Cerisier se défend d’avoir prémédité son coup. C’est cet éditeur de Gallimard qui a eu l’idée de relancer la collection qui datait des années 1930. « Très vite, cette forme s’est intégrée dans l’univers médiatique, car elle correspond à sa temporalité dans un contexte de surpublication », analyse Alban Cerisier, qui souligne que le format est simultanément parvenu à trouver sa place et sa noblesse en librairie : « De façon assez inattendue, la collection a constitué un fonds de livres d’actualité. » Nicolas Vieillescazes, lui, voit dans cette tendance une nouvelle preuve que « l’actualité médiatique dicte l’actualité de la recherche » et se dit « préoccupé par les travaux directement taillés pour passer dans les médias ». Ceux-ci feraient de l’ombre à des productions plus ambitieuses, tacle Joseph Confavreux : « Les débats des “Tracts” auraient lieu dans les médias s’ils faisaient bien leur boulot. Ils occupent l’espace au détriment des productions ambitieuses. »
Mais vendre plus de « Tracts » et moins de volumes érudits de sa mythique « Bibliothèque des Histoires », est-ce un problème pour Gallimard ? Pour l’historien Jean-Yves Mollier, la relégation de la place du livre est inséparable du phénomène de concentration dans le milieu de l’édition. Sur le temps long, l’auteur d’une Brève histoire de la concentration dans le monde du livre (Libertalia, 2022) observe que « l’édition a de moins en moins de place pour les thèses universitaires et les grands sujets de réflexion », citant notamment Fayard, dont ce fonds est très peu réédité – ainsi de l’œuvre monumentale mais devenue inaccessible du juriste Pierre Legendre, décédé en mars 2023. À cette tendance s’ajoute le passage d’une concentration industrielle à une concentration financière, représentée par l’appétit de Vincent Bolloré (actuellement propriétaire de Hachette et Editis). Qui est aussi idéologique : « Ces propriétaires ne veulent pas seulement une rentabilité financière, mais une domestication de la pensée. »
Tyrannie de la nouveauté
Cette tendance est étayée par Thierry Discepolo, fondateur en 1990 des éditions Agone. Dans La Trahison des éditeurs (Agone, 2011), dont il vient de proposer une troisième édition actualisée, ce dernier soutient la complémentarité de deux stratégies générées par cette hyperconcentration : la surproduction et la diversification. La première « constitue l’instrument par excellence de l’occupation du terrain » par un groupe, des étals des librairies aux plateaux des médias. Cette surproduction, qui entretient « la tyrannie de la nouveauté » et « fournit le flux continuel d’amnésie et de distraction nécessaire » au maintien du consumérisme, permet en même temps d’absorber la « production pléthorique » du monde académique. S’y greffe la diversification : un même groupe possède des maisons aux lignes éditoriales différentes, et parfois opposées. C’est étonnant mais pas illogique, démontre Thierry Discepolo.
Ainsi, au sein de la galaxie Hachette (soit Vincent Bolloré), on retrouve chez Pauvert les essais Histoire de ta bêtise (2019) ou Notre joie (2021) de François Bégaudeau, comme les ouvrages néoconservateurs de Bernard-Henri Levy et Pascal Bruckner chez Grasset. Mais aussi toute une production qui, de la littérature aux livres pratiques, occupe chaque créneau. Cet ensemble permet de présenter des catalogues omnivores, et donc de « placer le plus grand nombre d’exemplaires possible » dans le plus grand nombre de points de vente. La subversion fait donc vendre comme les livres de cuisine, ce qui explique qu’un éditeur de sciences humaines critiques comme La Découverte soit aujourd’hui aux mains d’Editis, c’est-à-dire de Vincent Bolloré… « Si les régimes totalitaires brûlent les livres, la démocratie les noie », constate Thierry Discepolo. Ce dernier propose une mesure aussi simple que radicale : supprimer les services de presse envoyés « comme des lots d’échantillons » aux journalistes. Vite reçus, vite lus, vite traités, c’est ainsi que le« potentiel critique ou novateur d’un propos »se dissout dans les poncifs et dans un prêt-à-penser, où la critique du capitalisme finit même par le renforcer.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don