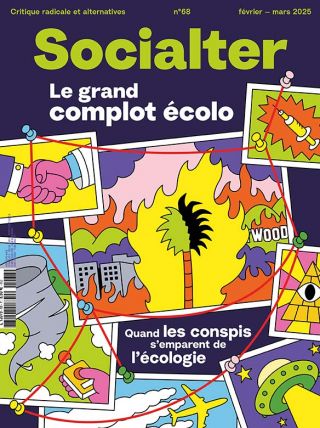[ARCHIVE] Article extrait de notre numéro 40 « Tourisme : année zéro ».
Ces dernières semaines se déverse une pluie de milliards promettant de sauver le secteur aérien du choc consécutif à la pandémie de Covid-19. Le but avoué est de restaurer au plus vite la situation « normale » de 2019, puis de renouer avec la croissance « naturelle » d'un trafic habitué à une expansion immodérée depuis des décennies (1).
Sauf que cette fois (2), c'est promis, ce sera avec comme objectif premier l'environnement (le climat en particulier), notre gouvernement s'y engage. Ainsi, le ministre de l’économie Bruno Le Maire déclarait en avril qu’« Air France [devait] devenir la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète » et promettait le 9 juin dernier de « parvenir à un avion neutre en carbone en 2035 au lieu de 2050 ». L'ambition est telle, le patient si énergivore, que l'on peut légitimement s'interroger : l’avion propre, ce nouvel oxymore, rejoindra-t-il le panthéon du greenwashing et du pouvoir des lobbies ? Examinons-en les ressorts.
Tout changer pour ne rien changer
Une première idée régulièrement avancée serait d'abord d'interdire les vols domestiques pour les trajets déjà couverts par un train régulier en moins de 2 ou 3 heures. Sauf que ces vols ne représentent qu'une proportion très mineure de l'impact des grandes compagnies (une part minoritaire de leurs court-courriers, eux-mêmes largement dépassés par l’impact des vols moyen et long-courriers). Par ailleurs, cela libèrerait des créneaux de décollage dans les aéroports, ce qui ouvrirait la piste à une augmentation de l'offre de vols internationaux (à condition que les aéroports concernés retrouvent la fréquentation qu'ils connaissaient en 2019).
Une seconde idée en vogue est de recourir à des carburants « verts » tel l'agro-kérosène ou l'hydrogène. Ces derniers souffrent cependant d’écueils rédhibitoires. Au même titre que les carburants traditionnels, leur combustion (ou oxydation) libère de la vapeur d'eau qui, à très haute altitude, se condense en traînées blanches dans le ciel dont l'effet de serre additionnel est, selon les scientifiques (3), au moins aussi important que celui du CO2 émis concomitamment. Quant à l'hydrogène, sa combustion produit 2 à 3 fois plus d'eau par unité énergétique que les carburants liquides usuels, ce qui anéanti immédiatement, en termes de l’imitation de l’effet de serre, tout intérêt comme carburant de substitution dans les conditions actuelles de vol (la plupart du temps effectués en très haut altitude). L'issue de loin la plus crédible pour éviter la formation de ces fins nuages est de voler moins haut (à environ 7 000 m au lieu de 10 500) et de ce fait moins vite (à environ 600 km/h au lieu de 900), ce qui nécessite le renouvellement de la flotte avec de nouveaux avions à turbo-propulseurs (hélices). Ces dispositions, qui modifient toute l'organisation des flux aériens, sont cependant bénéfiques du point de vue de l'emploi, particulièrement dans la recherche et développement, fournisseurs inclus.
Sans décroissance, point de salut
La volonté même de recourir à des « éco-carburants » pose question lorsqu’il s’agit clairement de soutenir le tourisme lointain, premier pourvoyeur en passagers. En effet, si tant est qu'existent un jour des carburants « verts », leur but premier, comme celui de toute énergie renouvelable, devrait être de se substituer aux ressources fossiles, non de permettre de nouveaux usages ou d’accroître ceux existants. Or les intentions mentionnées précédemment s'appuient sur le programme Corsia dont l'objectif affiché est le soutien de la croissance immodérée du secteur aérien, qui affichait sans vergogne un quadruplement du trafic d’ici 30 ans au prix d'un triplement de la consommation énergétique (4).
La lutte contre le changement climatique n'a aucune chance d'aboutir favorablement si l'on poursuit l'empilement énergétique. En outre, les carburants renouvelables actuels, tous confondus, ne représentent que quelques pourcents des consommations d'essence, de gazole et de fioul : la priorité d'usage d'hypothétiques nouveaux carburants « verts » se doit d'être celle d'usages essentiels, incompressibles, le reste (en l’occurrence le tourisme de masse à travers le monde) devant « quoi qu'il en coûte » décroître.
En cette période trouble, la volonté de sauvegarder des emplois, en particulier dans le secteur aérien, se comprend parfaitement, mais elle ne peut faire l'impasse d'une redéfinition stratégique à la baisse, tant sur le trafic de passagers, qu'en ce qui concerne la vitesse de vol ou les cadences de production, au niveau national comme international. Réguler la flotte d’avions autorisés à voler, plafonner leur altitude de croisière, limiter leur vitesse, taxer lourdement le kérosène, réorienter une partie du personnel est un passage obligé.
En attendant, l'horizon de la dépollution des transports s'éloigne et, tel un mirage dont on croit régulièrement s'approcher, s'enfuit inexorablement. Le secteur aérien est à la croisée des chemins : ou il choisit d’embrasser sérieusement la cause climatique en se réinventant, ou il continue de s'activer à sa perte.
(1) Le trafic aérien mondial a été multiplié par 100 entre 1950 et 2000, puis par 2,5 de 2000 à 2019...
(2) Le secteur aérien fait l'objet de multiples financements au travers de la mise au point du carburant aviation, de la construction et du fonctionnement d'aéroports, de marges arrières de compagnies auprès de collectivités régionales, de soutien étatique de programmes, de détaxation du kérosène (depuis 1951), etc.
(3) Voir par exemple les synthèses du GIEC. On notera un certain déni de l'aviation civile sur le sujet.
(4) Programme CORSIA pour Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don