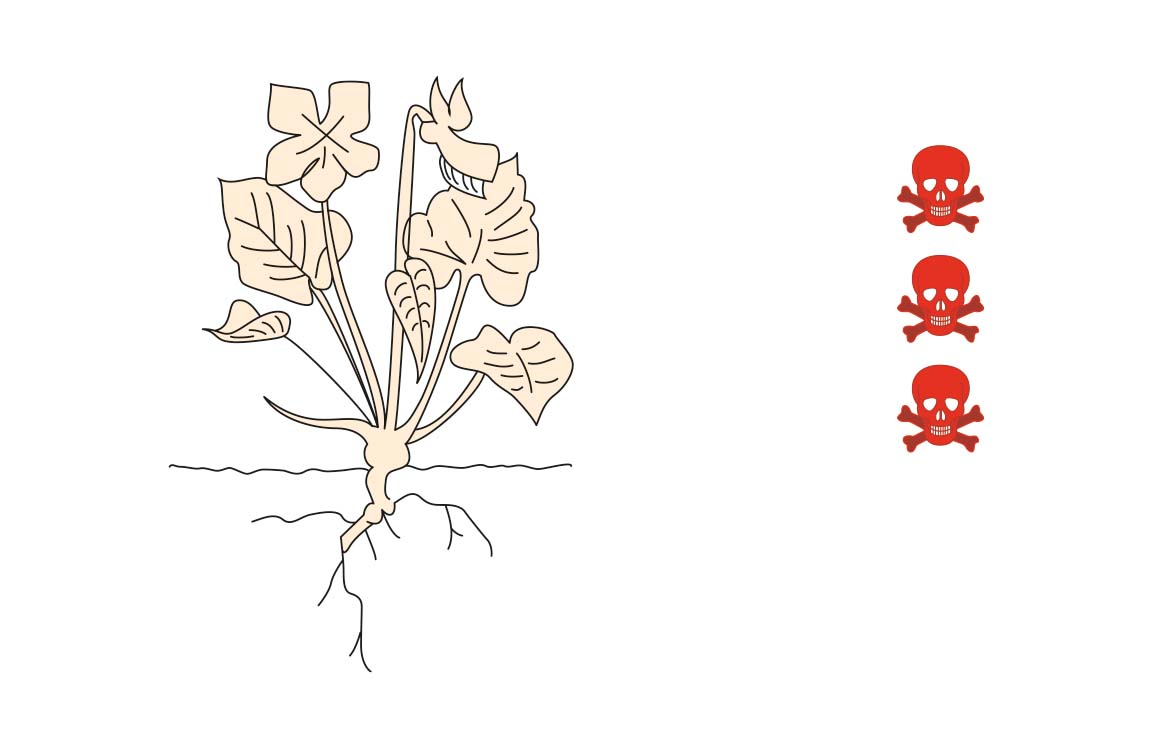Développement durable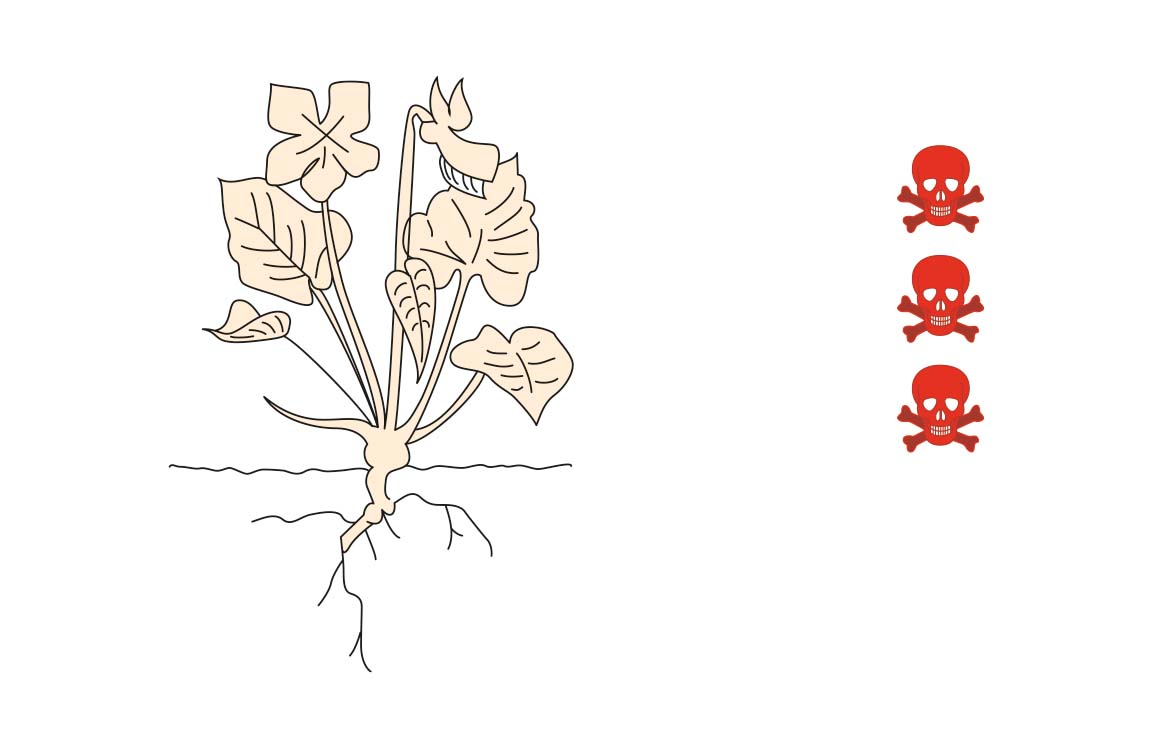
La notion de développement durable, traduction de l’anglais sustainable development, apparaît au début des années 1980 avant d’être institutionnalisée en 1987 par le rapport de la commission Brundtland, qui la définit comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Exemple canonique de la novlangue technocratique, l’expression a depuis été abondamment reprise dans les documents officiels des organisations internationales et des États. Deux critiques majeures se sont élevées contre l’emploi de cette terminologie. D’une part, le flou conceptuel qui l’entoure permet surtout de naturaliser dans l’opinion publique l’idée que l’environnement pourrait être protégé tout en développant l’économie.
Retrouvez le reste de nos articles dans notre hors-série L'écologie ou la mort, avec Camille Étienne rédactrice en chef invitée, disponible sur notre boutique.

Autrement dit, qu’une « croissance verte » est possible. Nous avons donc affaire à un bel oxymore, dont l’avantage premier est de concilier artificiellement l’idée d’une croissance infinie et la réalité d’un monde fini. La notion sous-entend également que le développement des économies occidentales reposant sur la prédation des ressources naturelles et de la main-d’œuvre des pays du Sud est un modèle à la fois universalisable et soutenable à long terme.
Ce qui renvoie à la seconde critique, portant moins sur la durabilité que sur l’idée même de développement. La diffusion de ce terme a eu pour effet (ou objectif) subsidiaire de rendre « naturelle » la mondialisation capitaliste imposée par les pays occidentaux industrialisés. Les pays dits « développés » peuvent ainsi convertir en toute sérénité les pays « en développement » à la vision idéalisée d’un modèle dont les seconds sont pourtant les premières victimes et dont la « durabilité » repose justement… sur leur exploitation.
Responsable
Consommation, tourisme, tri des déchets, économie d’eau… Bienvenue dans le quotidien du citoyen écoresponsable – pardon, de l’écocitoyen. Bref, dans un monde où les individus conscientisés et héroïques prennent à leur charge de surveiller tous leurs comportements et de s’amender en multipliant les fameux écogestes. « Réaliser un écogeste, c’est prendre en considération les valeurs qui fondent le développement durable », nous éclaire le site du ministère de l’Économie en nous incitant par ailleurs à « changer [nos] mauvaises habitudes ».
Car c’est bien là le sous-texte du discours en responsabilité : si tout part en vrille, ce n’est pas de la faute de l’organisation sociale dont nous héritons, ni du fait des classes dirigeantes qui, aujourd’hui, la maintiennent coûte que coûte ; non, c’est parce que les individus paresseux ou mal informés ne font pas les efforts nécessaires. Une belle illustration de la phrase de Tancrède, héros du Guépard : « Il faut que tout change pour que tout reste comme avant. »
Vert
L’association de la couleur verte au végétal et à l’exubérance de la vie n’apparaît franchement qu’au cours de la mutation industrielle et urbaine des deux derniers siècles, notamment sous l’influence de la bourgeoisie qui souhaitait tantôt aménager le végétal en ville, tantôt s’échapper dans la nature loin des rumeurs et humeurs citadines. Quant aux connotations politiques du vert, elles n’émergent que dans les années 1970 avec la création des mouvements écologistes, la fondation de Greenpeace étant à ce titre emblématique. De nos jours, on couvre tout de vert : « hydrogène vert », « label vert », « verre vert » et même « croissance verte ». À tel point que l’on parle de « greenwashing » (« écoblanchiment ») pour désigner les tromperies sur la marchandise, comme un retour ironique au Moyen Âge, où le vert, pigment instable, difficile à fixer, était considéré comme une couleur traîtresse.
Climatosceptique
Le terme climatosceptique a longtemps recouvert une variété de discours : il y avait ceux qui niaient l’existence du rechauffement climatique, ceux qui niaient qu’il soit d’origine humaine et même ceux qui, sans nier le phénomène, assuraient que les effets ne seraient pas catastrophiques ou qu’on s’y adapterait, voire qu’il offrirait des opportunités… Ces discours existent toujours, mais l’origine anthropique du dérèglement est, elle, désormais considérée comme incontestable par l’ensemble des études scientifiques. Peut-on dès lors encore les qualifier de « sceptiques », c’est-à-dire adoptant une posture d’incrédulité ou de réserve en attente d’un examen critique ? Non. Il est certainement temps de distinguer ces discours, discriminer la qualification qui y est associée et employer un spectre de nouveaux mots plus précis : négationnistes climatiques ou écocidaires, par exemple.
Propre 
On nous le promet : demain, nous pourrons voler dans des avions propres, rouler dans des voitures propres et même cramer du pétrole propre ! Propre ? Oui : sans émissions de gaz à effet de serre ! Si cette terminologie hygiéniste ne s’applique qu’à des moyens de transport émettant manifestement de la pollution, c’est sans doute qu’il faut faire disparaître ce qui est trop visible. Sauf que, dans la plupart des cas, les émissions sont simplement déportées. Pour une meilleure estimation, il faudrait prendre en compte les émissions « grises » : celles générées par le reste du cycle de vie de l’objet, de sa conception à sa fin de vie. Mais peu importe, car l’usage intempestif de cet adjectif sert un autre intérêt, à savoir entretenir le récit selon lequel l’innovation technologique nous permettra de « verdir » notre mode de vie – pour nous éviter d’avoir à le négocier.
Dématérialisation 
Avec la révolution numérique est venue la « dématérialisation ». Grâce aux échanges « virtuels » et au « cloud », l’informatique en nuage, nous allons pouvoir supprimer peu à peu les supports physiques, du papier aux DVD en passant par les réunions en « présentiel »... et ce sera écolo ! L’économie dématérialisée, nous dit-on, va permettre de découpler la croissance de la production matérielle de celle de l’augmentation des émissions de CO2 générées par cette production, courbes jusqu’ici fortement corrélées : la seconde augmente grosso modo proportionnellement à la première. Sauf qu’il faut des ressources et de l’énergie (rarement « verte ») pour produire les terminaux et infrastructures informatiques, d’ailleurs extrêmement gourmands – sans parler des conditions sociales et des impacts environnementaux liés à cette production, délocalisée à l’autre bout du monde. On comprend que les apôtres de la « croissance verte » adorent la dématérialisation : tout comme les modèles économiques classiques, on peut continuer de fantasmer une économie sans matérialité, et donc sans réalité.
Transition énergétique 
Le vocabulaire de la transition est séduisant : nous pourrions reconfigurer progressivement l’infrastructure énergétique de nos sociétés afin de les faire sortir du tout fossile et les orienter vers les énergies renouvelables (EnR). Il suffirait donc d’investir massivement dans le solaire, l’éolien et quelques autres sources pour tourner la page du pétrole et du charbon. N’est-ce pas là ce que nous avons toujours fait ? Les sociétés ne sont-elles pas passées du moulin au charbon, du charbon au pétrole, et donc, demain, du pétrole aux renouvelables ? Malheureusement, cette vision de l’Histoire des trois derniers siècles, outre le fait qu’elle relève d’un progressisme un peu trop rassurant, est tout bonnement fausse.
Les différentes sources d’énergie se sont en réalité progressivement additionnées, non substituées l’une à l’autre et, ce faisant, elles ont accompagné l’explosion de la consommation énergétique globale. D’ailleurs, dans de nombreux endroits, on se passait d’hydrocarbures jusqu’au début du XXe siècle. Ainsi de la Californie où la grande majorité des foyers utilisaient des chauffe-eau solaires, où les villes étaient quadrillées de réseaux de tramways et où les éoliennes et la biomasse étaient utilisées dans les zones rurales.
Si l’on prend ce terme de transition avec des pincettes, c’est moins pour critiquer l’idée de bifurquer progressivement (mais rapidement) vers d’autres systèmes énergétiques que pour mettre en garde contre l’idée largement répandue que le développement des EnR viendrait logiquement « prendre des parts » aux énergies fossiles et donc se substituer peu à peu à celles-ci. En matière énergétique, la solution n’est pas d’ordre technique mais relève bien de choix de nature socio-économique.
Service écosystémique 
Rendez-vous compte : la valeur apportée par la pollinisation à la production alimentaire serait de 153 milliards d’euros par an ! Quant aux bénéfices liés aux récifs coralliens, ils sont estimés entre 26 milliards et 148 milliards d’euros annuels. C’est ce que nous apprend le TEEB (pour The Economics of Ecosystems and Biodiversity), hébergé par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). Rassemblant des experts de l’économie et de l’environnement, le TEEB a pour objectif d’« intégrer les valeurs de la biodiversité et des services écosystémiques à la prise de décision à tous les niveaux ». Mais on aurait pu préférer les estimations de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), un groupe d’experts qui se pense comme le « Giec de la biodiversité » et qui estime dans un rapport de 2016 que « 203 à 497 milliards d’euros de la production agricole mondiale dépendent des services de pollinisation animale ».
Le « service écosystémique » est défini comme l’ensemble des conditions et processus au travers desquels les écosystèmes naturels et les espèces qui les composent soutiennent la vie humaine et lui permettent de s’épanouir pleinement. Sur son site, le TEEB le dit plus franchement : « Nous dépendons de “ services écosystémiques ” fournis gratuitement par la nature. Des services tels que l’eau douce, les sols fertiles, l’air pur, la pêche et le bois. » Or, si « fixer un prix au capital naturel peut sembler insensible [...], la nature et ses services échappent à la tarification et sont donc ignorés ou non détectés par les marchés. Dans notre système économique, cette absence d’évaluation monétaire est à l’origine du problème ». Le terme, qui a connu un succès fulgurant et une formalisation progressive au cours des trois dernières décennies, regroupe au moins trois catégories : les services d’approvisionnement (les ressources naturelles renouvelables), les services de régulation (les cycles biophysiques et les processus écologiques comme l’absorption du carbone ou la pollinisation), les services culturels (spiritualité, loisir…).
Quant à ses défenseurs, on trouve d’une part les pessimistes qui s’emparent de ce vocabulaire économiciste pour parler aux instances économiques car « il faut bien », compte tenu de l’inaction des États ; et d’autre part les convaincus qui pensent réellement que cette « internalisation » de la nature dans les processus de marché (version pudique de l’engloutissement de la vie par l’économie) est un moyen optimal de préserver la biodiversité, voire une approche « win-win » qui ouvrirait de nouveaux marchés. De nombreuses critiques se sont élevées contre ce mot et son imaginaire, à commencer par le caractère souvent absurde du raisonnement. Ainsi, on apprend du ministère de la Transition écologique que la disparition des abeilles coûterait 2,9 milliards d’euros…
Ce qui renvoie directement à la seconde critique : l’anthropocentrisme d’une telle démarche ne considère le vivant que sous le prisme de sa valeur marchande et ne s’y intéresse réellement que lorsqu’il est question de profit ou de manque à gagner. Symboliquement, les services écosystémiques reconduisent la logique d’une intégration de la nature à l’économie, là où il faudrait enfin accepter que l’économie est un sous-système de la biosphère.
Compensation 
Si le grand public connaît généralement la compensation écologique à travers la communication d’entreprises qui proposent de replanter un arbre pour contrebalancer l’impact d’un vol Paris-New York, le terme désigne initialement un mécanisme technique de marché : la « compensation carbone ». Le principe ? Tout projet qui permet d’aboutir à une réduction des émissions de gaz à effet de serre génère des crédits carbone sur un marché : les tonnes de CO2 non émises peuvent alors faire l’objet d’une transaction auprès de particuliers ou de collectifs (entreprises, collectivités, etc.) souhaitant alléger leur propre empreinte carbone. Autrement dit, un acteur qui parvient à réduire ses émissions vend ce différentiel à un autre qui n’y parvient pas ou préfère payer ces crédits plutôt que mettre en œuvre une politique de réduction.
Pour ses défenseurs, la compensation permet d’instaurer une logique incitative en frappant au porte-monnaie les mauvais joueurs et en récompensant les vertueux. Elle a pourtant fait l’objet de nombreuses critiques : comment évaluer quantitativement les émissions ? Comment fixer un prix qui rende la compensation réellement incitative ? Ou encore, peut-on réellement instaurer des rapports d’équivalence très abstraits et globaux alors que les émissions n’ont pas le même impact selon l’endroit où elles ont lieu ?
La compensation peut par ailleurs favoriser un nouveau colonialisme, puisqu’elle permet aux pays du Nord de s’épargner la charge d’une politique de réduction des émissions en s’offrant des opportunités bon marché dans les pays du Sud, où les effets pervers sont d’ailleurs déportés – typiquement, des projets de reboisement qui finissent en monoculture sur des espaces anciennement occupés par des forêts. Plus généralement, la compensation reconduit inlassablement la logique qui préside pourtant à la catastrophe : le marché est la solution à nos problèmes.
Résilience 
On ne compte plus les occurrences du mot « résilience ». Désignant initialement la capacité d’un matériau à retrouver son état initial après un choc ou une pression, il a ensuite été mobilisé par la psychologie pour renvoyer à la capacité d’un patient à surmonter un choc traumatique. Il se voit maintenant associé aux sciences de l’environnement pour qualifier la capacité d’un écosystème à encaisser une perturbation et à revenir à son état précédent. Cela peut paraître frappé au coin du bon sens.
Malheureusement, une fois dépassé ce caractère descriptif, la résilience devient une sorte d’injonction que l’on pourrait résumer en des termes prosaïques : ce qui ne tue pas rend plus fort. Le discours de la résilience finit par présenter les destructions causées par le système industriel comme des « opportunités » pour rebondir, voire tirer avantage de la situation. Pire : il incite les populations à se préparer et à prendre à leur charge les malheurs à venir sans en interroger les causes, et culpabilise celles et ceux qui pourraient éprouver des émotions négatives telles que le dégoût ou la révolte devant l’origine de leurs maux.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don