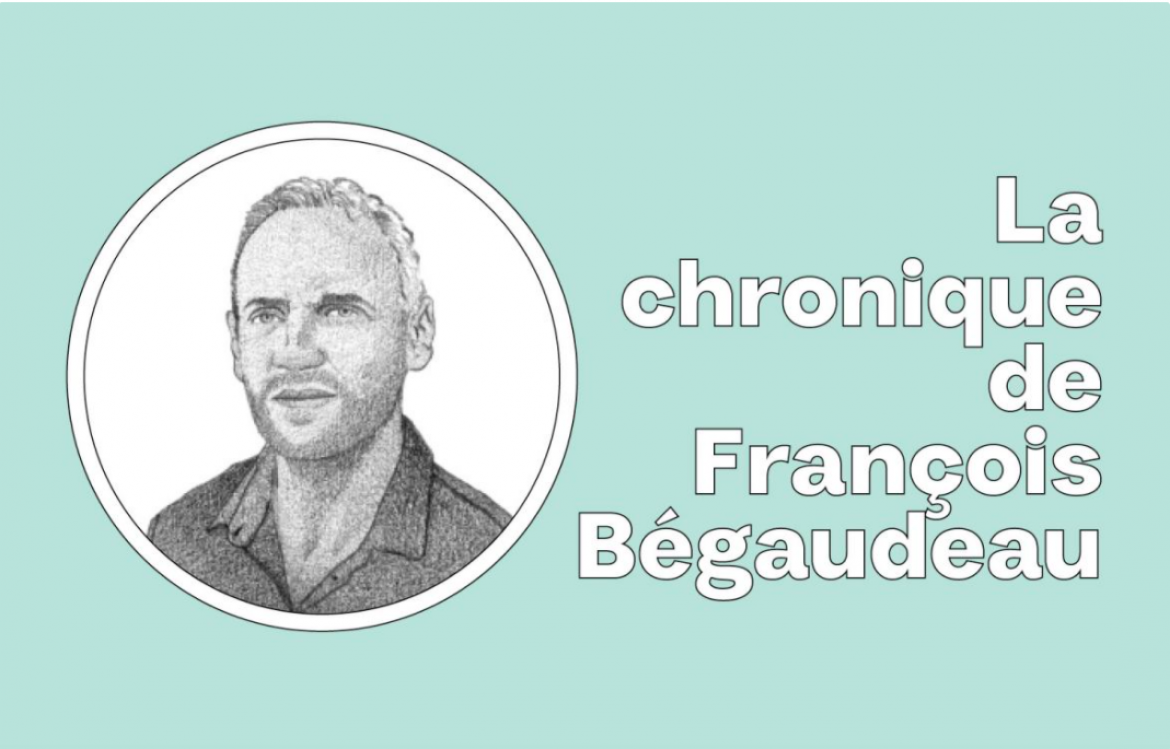Cet article est à retrouver dans notre numéro 49 - Nous n'irons pas sur Mars.
Vous aimez les dystopies. Vous en fabriquez et consommez à la chaîne. Avec gourmandise vous prononcez ce mot, dystopie, inconnu de vous il y a dix ans. De quoi jouissez-vous quand vous en jouissez ? Qu’est-ce que vous y trouvez que je n’y trouve pas ? En premier jugement, en premier méjugement, vous trouvez à la dystopie la qualité décisive d’alimenter votre lucidité sur l’avenir sombre de l’humanité. Il faudrait donc que j’admette que vous lisez 1984 ou regardez Squid Game comme vous pourriez suivre un séminaire sur les futures pénuries de matières premières. Le plaisir que vous y prenez est un plaisir mature, un plaisir civique. Vous préféreriez vous détendre devant des œuvres frivoles mais le monde que vont transmettre à vos enfants leurs prédécesseurs égoïstes vous porte vers des films qui vous alertent sur ce que vous savez. Et moi je suis un irresponsable : pendant qu’on extermine les poissons, je regarde des vieux Rohmer. Devant les tortures infligées aux femmes dans The Handmaid’s Tale, vous souffrez beaucoup, vous souffrez presque autant qu’elles, mais il le faut. La prise de conscience et la mobilisation passent par cette épreuve. Une fois les quatre saisons englouties, vous partez lutter contre la société de contrôle qui vient. D’ailleurs la mode planétaire des dystopies a déjà fait refroidir le climat d’un degré et demi.
L’idée est donc que la dystopie anticipe pour que nous anticipions. Or il se trouve que la dystopie n’anticipe rien du tout. Pour la simple raison qu’elle ne figure aucunement un monde ultérieur. Prenons Dune, que vous avez été plus de 2 millions à voir en France, suivant la suggestion soft d’un marketing planétaire – vous avez dit société de contrôle ? Dune se passe en 10191, c’est-à-dire ne se passe jamais. Cette date pastiche, cette non-date, est un sésame autorisant à configurer une non-époque qui est un mixage d’époques disparates. Ainsi la dose obligée de gadgets high-tech est ici minimale au regard des deux inspirations visuelles de cette fantasmagorie : un, l’incontournable décorum postindustriel où des « moissonneuses » croisent des hélicos voletant au-dessus de villes soviétiques qu’une ou deux apocalypses ont usées à souhait ; deux, le Moyen Âge d’opérette qui tient lieu de base de données iconographique aux imaginations étroites qui conçoivent ces non-mondes : magie noire, complots, sols dallés ou pavés, bâtisses en pierre, chevaux, armures, combats à l’épée, suffocations et grognements des épéistes... Une fois l’âge informatique, l’âge de fer et l’âge de pierre jetés dans le même shaker, on obtient ce cocktail temporel hors du temps, ce parc d’attractions sans référent. C’est alors dans le sens le plus littéral qu’on peut affilier cette dystopie à l’heroic fantasy. Elle a un rapport fantaisiste à l’histoire, histoire future comprise. Elle n’est pas sérieuse.
Un essentialisme dystopique
Pourtant, qu’est-ce qu’elle se prend au sérieux. Avec quel sérieux elle est jouée – théâtralité oraculaire, profondeur de champ, lexique ampoulé, déclamation pseudo-shakespearienne – et surtout analysée. D’éminents intellectuels décryptent le message politique de Blade Runner. D’estimables universitaires tirent de Game of Thrones des leçons d’histoire. Or la dystopie fantaisiste ne se contente pas de se situer hors de l’histoire, passée ou future : elle évacue l’historicité, la variable historique, la variabilité en général. Sa cartographie politique est d’une répétitivité infantile : un Empire englobant un archipel de peuples qu’il a subordonnés en des temps hyper lointains. L’Empire n’est pas ici un fait historique, mais un invariant. On pose l’Empire, puis on imagine le reste. L’Empire est une structure a priori de l’imaginaire dystopique, que l’Empereur s’appelle Shaddam IV ou Jean-Bernard. Non pas un empire mais l’Empire avec un grand « E », comme on note Imperium avec une majuscule. La fantaisie dystopique est un essentialisme.
Les peuples sous sa coupe sont des essences. L’invariable peuple rebelle porte son essence sur son nom, free men de naissance, hommes génétiquement libres. De même qu’il est écrit sur la gueule du réglementaire peuple collabo de l’Empire, la baronnie Harkonnen, qu’il est viscéralement mauvais. Le Fremen est un métis aux yeux bleus, son allié atréide est beau comme un Grec ; le Harkonnen est un adipeux à voix rauque et crâne rasé de néonazi polonais.
Notons au passage que dans huit mille ans, le triangle œdipien n’aura pas été détrôné comme schéma directeur de l’organisation sociale : rois grisonnants, princes éphèbes, femmes pour les enfanter. Le père initie le fils à la guerre et au froid pragmatisme des jeux de pouvoir car il est un homme ; la femme l’initie à la puissance ésotérique et mentale car elle est une femme. Le Fremen est libre, l’Atréide est bon, la femme est intérieure, l’homme est soldat. Des essences. Des essences qu’on retrouve telles qu’en elles-mêmes d’un siècle à l’autre, d’une scène à l’autre. Gurney Halleck suinte le chef de guerre par tous les pores : il parle chef de guerre, il mange chef de guerre, il pisse chef de guerre. Sauf qu’il ne pisse pas. Ici, les corps n’ont pas de vie organique. Les individus ne possèdent pas de fonction vitale, juste une fonction dans la cité ou dans l’univers. Jamais ces corps ne dévieront de leur programme génético-scénaristique. Ils sont immuables.
The Great Reset
Ici sont absents les gens dissemblables, singuliers. Les rues d’Arrakis, toujours vues de haut, ne grouillent d’aucune silhouette. Comme il arrive qu’une armée entreprenne de raser une ville, la mise en scène rase l’espace. Là où elle passe, l’herbe ne pousse plus. Grand bénéfice du désert gondolé de dunes : pas un brin qui germe. Pas une tête qui dépasse. Vous aimez les dystopies parce qu’elles réalisent la table rase dont vous rêvez. Le grand nettoyage. The Great Reset. Aussi vrai que les prétendus pourfendeurs d’un gouvernement mondial au fond le désirent. De l’écologie visionnaire du roman restent ici quelques bribes : les Fremen sont dépositaires de précieux savoirs ancestraux que l’Empire anéantira pour imposer son mode de production ; le gros ver des sables vaut pour tous les lombrics, meilleurs soldats de la biodiversité ; l’« Épice » que tous se disputent emblématise les ressources accaparées par certains au mépris de la nécessité vitale qu’en ont les autres. Soit. Le scénario promeut la vie. Mais la mise en scène l’abolit. La mise en scène déteste la diversité, bio ou non. Le scénario de Dune proclame l’indépendance et la diversité des peuples contre l’hégémonie impériale, mais sa mise en scène est du côté de l’Empire. Elle ramène tout au même, absorbe la multiplicité des voix dans son emphase monocorde, uniformise les attitudes, adore les uniformes, les armées rangées, les fascinants alignements de soldats indifférenciés. Le scénario appelle à l’insurrection ; la mise en scène cousue de plans au cordeau – géométriques, minéraux, martiaux – aime l’ordre.
L’identité signifie l’identité à soi. Ici, tout est identique à soi. La fantasy dystopique est un genre identitaire, que prisent d’ailleurs nombre d’individus zonant dans le marais extrême droitier. Faut-il croire pour autant que tout fan de fantasy dystopique est d’extrême droite ? Faut-il croire que vous êtes d’extrême droite ? Rassurez-vous : vous n’êtes identitaires, autoritaires, essentialistes que pour autant que vous prisez ce genre totalitaire. Vous ne l’êtes que le temps d’un troisième visionnage de Dune ou d’autres enfantillages visuels politiquement ineptes. Le reste du temps, vous êtes tous des chics types.
François Bégaudeau pilotera le prochain hors-série Socialter, de 180 pages Manuel d'autodéfense intellectuelle. Précommandez votre exemplaire sur Ulule !

Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don