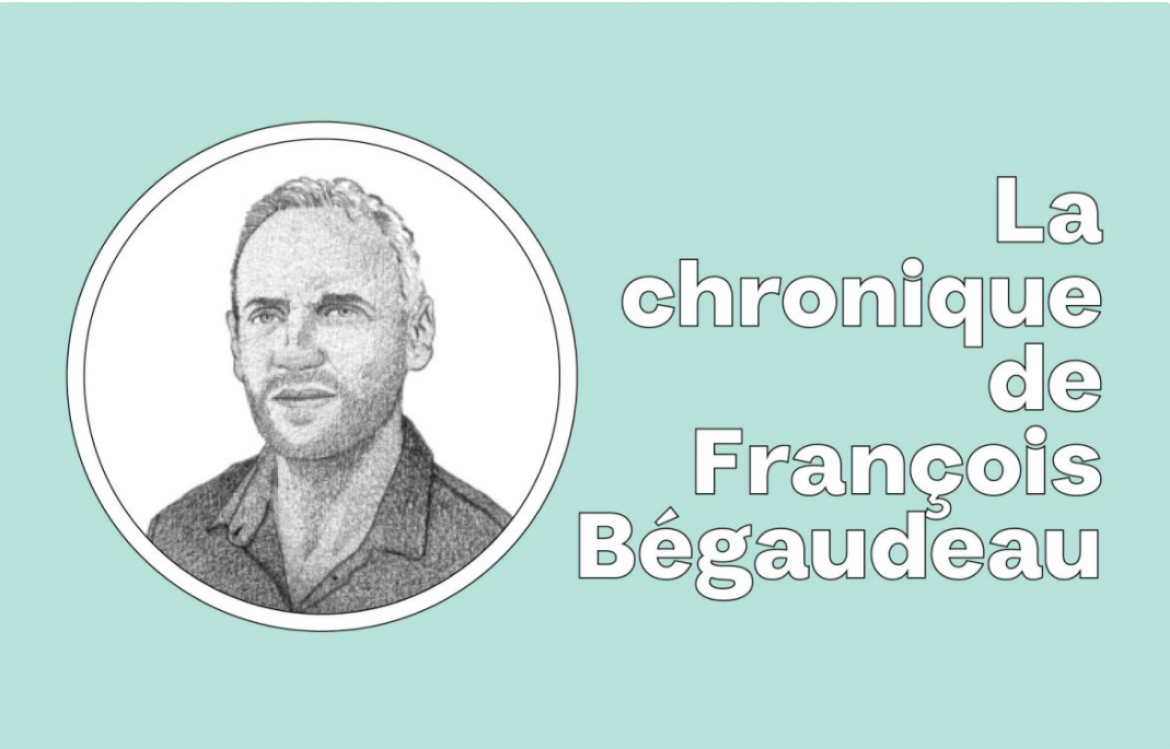On parle de sensibilité politique et on fait bien. Un positionnement politique est affaire de sensibilité. Cette sensibilité, formée à l’intersection de conditionnements sociaux, familiaux, historiques, géographiques, est une sensibilité à. Un identitaire est plutôt insensible aux noyades des migrants en Méditerranée mais sensible à la fin de l’homogénéité ethnique de son pays. Sa sensibilité est heurtée par la proportion d’usagers noirs sur un quai du RER, et peu heurtée par la proportion de travailleurs noirs parmi ceux qui assurent le nettoyage dudit quai. Cette hiérarchie affective façonne une idéologie, tissée de préconisations politiques comme la suppression du RER ; ou la suppression des allocations aux parents du RER. L’identitaire ne pèche pas par insensibilité.
Sur le sujet de la nation, je le trouve même excessivement sensible. Et moi, il me trouve froid. La France meurt et je la regarde mourir sans broncher, me sermonne-t-il. Si la France lui est un sujet sensible, c’est que la France lui est une réalité sensible. Alors que pour moi elle est une abstraction ; à ce mot je ne rapporte aucune réalité, si ce n’est Flaubert et le morbier. Moyennant quoi je suis peu patriote. Je prendrais moins diligemment les armes au nom de la France qu’au nom du rock qui comble mes sens.
La conscience écologique a considérablement crû ces derniers temps parce que des choses nous sont devenues sensibles qui ne l’étaient pas avant. Mon corps conditionné à être un viandard, et qui le fut allègrement quarante ans durant, est désormais moins sensible à l’attrait d’un bon steak qu’à l’abjection de la maltraitance animale. Il n’estime plus que manger de la viande va de soi. En mange de moins en moins. Finira par y renoncer. Une sensibilité politique majoritaire mute quand la norme commence à être perçue comme étrange.
Nous trouvions massivement normal que des gens prennent l’avion, aujourd’hui nous sommes nombreux à trouver cela incongru, déplacé. Bientôt obscène. La conscience écologique a crû d’autant plus rapidement qu’elle touche les consciences influentes, c’est-à-dire les consciences des riches. Jusqu’à une nouvelle étape de l’artificialisation de leur existence, jusqu’à leur exil sur Mars à bord de fusées conduites par Elon Musk, les riches respirent, à quelques crans de pollution près, le même air que les pauvres. Le riche influent est donc sensible aux alertes sur les particules fines.
« Je sais mais je ne sens pas »
Mais ce facteur explique tout autant le gain de conscience générale que son plafonnement. Car les riches sont concernés mais moins concernés. À ce stade, ce sont les pays du Sud – et les populations les plus misérables de ces pays – qui prennent cher. Les marques tangibles du désastre en cours sont en grande partie hors de vue des pays décideurs. Ce hiatus entre la géographie de l’urgence et la géographie de la gouvernance est une des causes de l’accablante mais donc logique lenteur de la réponse aux enjeux.
Le désastre est hors de vue, même quand il est à portée d’yeux. Souvent ses effets sont littéralement invisibles. Les particules fines ne se voient pas, je n’y suis donc pas littéralement sensible. Sur le sujet, je patauge mollement dans l’oxymore d’une sensibilité abstraite. Ce qu’on appelle précisément une conscience. Si la conscience écologique collective ne produit pas une énergie collective à la hauteur du défi, c’est parce qu’elle est davantage une conscience qu’une sensibilité.
Notre relative passivité tient à un paradoxe : l’écologie concerne le monde sensible en tant que sensible, le vivant en tant que vivant ; elle lutte pour la persistance de cette vibration sensible de la planète, contre son destin de boule de matière inerte, et la plupart des données sensibles de la détérioration de la biosphère sont insensibles. Je ressens que cette tomate n’a pas de goût, je ressens l’air vicié de Paris les jours de pics de pollution, mais je ne ressens pas la fonte des glaciers, ni la déforestation, ni même la plupart des phénomènes qui concernent mon périmètre de sensibilité – celui où s’exerce ma vue, mon ouïe, mon odorat. J’ai lu des dizaines d’articles sur les océans bourrés de plastique, mais me baignant dans la baie de Douarnenez (Finistère) je ne vois pas de plastique.
Je sais que les poissons en gobent et que j’en gobe en gobant un poisson, mais dégustant cette dorade je ne sens pas le plastique. Je sais mais je ne sens pas. Cette chose qui affecte mes organes ne m’affecte pas. Mes sens contredisent ma sensibilité écologique naissante. Mes sens ont les accents du bon sens. La preuve que le réchauffement climatique c’est du flan : l’hiver a été glacial, pérore le bon sens. La preuve que la baie de Douarnenez n’est pas polluée, c’est qu’elle n’a pas changé d’aspect – toujours aussi belle, comme Jennifer Lopez.
Le pire n’est pas spectaculaire
Le bon sens peut pérorer parce que la saisie écologique des problèmes est en grande partie contre-intuitive. On pourrait dire : contre-sensible. Même les catastrophes naturelles n’en imposent pas au bon sens. Les images des incendies californiens ou du métro de New York inondé ne contiennent pas leur corrélation avec le dérèglement climatique. Or, à l’égal des lobbys pharmaceutiques, les lobbys de l’industrie fossile procèdent surtout en semant le doute sur le lien de causalité. De même qu’on brouille le lien entre tel médicament et une vague de cancers, on brouille le lien entre tel ouragan et le dérèglement, ou entre le dérèglement et les émissions de carbone.
Reformulation du problème : la sensibilisation écologique passe par des images, mais aucune image n’incarne la causalité sur laquelle repose toute la conviction écologique. La causalité s’avère par des chiffres et des courbes qui ne font pas image. Par ailleurs, l’image édifiante de périmètres marins recouverts de déchets ne dit rien du réel moléculaire de la plastification des océans. Ces images nous renseignent autant qu’elles nous égarent. Aussi bien, la maltraitance animale constitue, dans la comptabilité écologique globale, un aspect très secondaire de la gigantesque nocivité de l’élevage industriel, dont les tenants principaux sont plus difficiles à incarner que la castration à vif des porcelets. Les images spectaculaires ne sont pas adéquates car le pire de ce qui arrive n’est pas spectaculaire. Les images douloureuses sont à moitié mensongères car le pire de ce qui arrive est, à ce stade, indolore.
Le désastre en cours, il faudrait que je le sente passer. Il faudrait que l’indolore soit rendu douloureux. Ce n’est pas une option masochiste mais vitaliste. La vie insensible n’est pas la vie. La vie, on la sent passer ou bien ce n’est plus la vie. Pour éprouver ce qui progresse à petit feu, de façon insidieuse et quasi insensible, je dois rendre sensible mon quotidien. Je suis mollement sensibilisé parce que mon quotidien est insensibilisé. Mon quotidien est abstrait. Je mange des choses dont je connais à peine le nom, rarement la provenance, jamais les conditions réelles de production, de traitement, d’emballage, d’acheminement. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas le mal que je me fais.
Au fil des années, moi, l’homme marchandisé, j’ai dévitalisé l’action vitale de manger. Dévitalisé ma vie. Ma sensibilité écologique s’affinera si je travaille à vivre ma vie. À la vivre véritablement. Ma sensibilité écologique requiert une vie écologique. C’est une sorte de boucle. Un chien qui se mord la queue. Une route en cercle. Mais c’est la seule.
François Bégaudeau pilotera le prochain hors-série Socialter, de 180 pages Manuel d'autodéfense intellectuelle. Précommandez votre exemplaire sur Ulule !

Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don