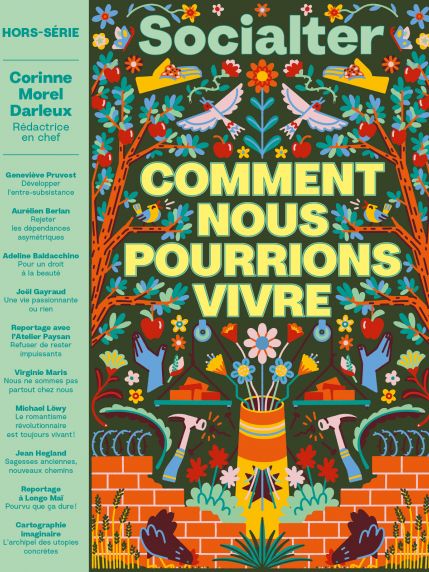Pourquoi partir de la quotidienneté pour repenser toutes les dimensions politiques de la crise écologique ?
Ce qui m’a intéressée avec cette notion de quotidienneté, c’est que ce n’est pas une sphère à part dans nos existences. Personne ne peut y échapper : il faut bien manger, se laver, dormir, etc. – tout ce registre d’activités que l’on répète chaque jour, inévitablement. C’est un substrat dont il est impossible de se détacher. Plus qu’un espace-temps, la quotidienneté se caractérise comme un régime d’attention assez particulier, dans lequel on suspend son jugement. C’est cette idée qu’on n’est pas en hyper vigilance permanente : on ne va pas se poser à chaque fois cinquante mille questions sur la façon de traverser au feu rouge, ou sur notre manière de cuisiner. Pour autant, on aurait tort de considérer ces habitudes incorporées comme une simple routine.
Retrouvez notre grand entretien avec Geneviève Pruvost dans notre hors-série « Comment nous pourrions vivre », disponible sur notre boutique.
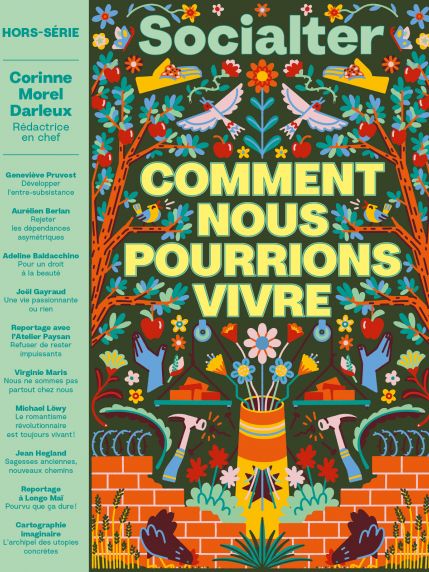
Parce qu’elles ont souvent lieu dans un espace familier, elles sont aussi l’occasion de véritables expérimentations, on peut y tester et y éprouver de nouvelles idées ou de nouvelles manières de faire, que l’on va ensuite digérer, sédimenter, intégrer. C’est cette capacité de métamorphose en terrain connu qui confère sa dimension profondément politique, voire révolutionnaire, à la quotidienneté : les alternatives à la norme peuvent se voir de plus en plus partagées, de proche en proche, cela devient routinier. Le quotidien est un lieu de diffusion majeure de pratiques nouvelles, avec un vrai potentiel de transformation.
C’est ce que vous avez pu observer au contact de ces dizaines de lieux de vie alternatifs que vous avez étudiés et qui vous ont inspiré ce concept de « politique du moindre geste ».
Aujourd’hui encore, on a tendance à distinguer, d’un côté, l’écologie politique, celle qui chercherait à conquérir des postes électifs afin de transformer le monde, et de l’autre, l’écologie dite « pratique », qui nous apprend à faire des buttes de permaculture, des conserves lactofermentées ou des chantiers participatifs en écoconstruction. Cela apparaît comme des sphères qui ne communiqueraient pas beaucoup et on parle souvent de la deuxième en des termes assez disqualifiants, comme si le fait de travailler sur ces formes d’action quotidienne ne pouvait pas constituer un répertoire politique en soi. Pourtant, sur le terrain, ceux qui réalisent cette « écologie pratique » politisent tous leurs gestes.
Ils en font une affaire de responsabilité, c’est une façon pour eux de relier la moindre de leur activité au « capitalisme-monde ». Ils ont de fait une vision très globale, puisqu’ils ont parfaitement conscience qu’une société où ces gestes seraient intégrés par chacun nécessiterait une réorganisation sociale complète. Il y a aussi l’idée que ces gestes ne sont pas le fruit de révélations individuelles miraculeuses, ils sont le résultat d’organisations collectives et de luttes. Cela permet de resémantiser la notion de politique, en requalifiant les hiérarchies : aux discours de changement, est opposée la fabrique in media res du monde qui change.
En quoi cette « fabrique du monde » constitue-t-elle, justement, à vos yeux, un enjeu fondamental ?
Nos quotidiens sont de plus en plus oublieux des ressources et des rouages du système socio-technique qui nous font vivre au jour le jour. La norme occidentale d’existence est d’avoir le minimum d’interactions avec les matières premières, comme avec les mains qui les transforment en biens de consommation courante. On ne sait plus de qui on dépend véritablement pour manger, dormir, se soigner, ou tout ce qui assure les conditions même de notre confort. Pourtant, il y a bien toujours un travail sur la matière : il faut l’extraire, la transformer, la régénérer, la faire circuler. Mais ce travail n’est plus localisable. Tout cela se passe à l’autre bout du monde, puis nous arrive par containers, tout cuit tout prêt, dans un sachet. Conséquence : toutes les petites mains de la fabrique du monde en bout de chaîne – le soudeur sur la chaîne électronique ou les ouvrières agricoles des champs de canne à sucre – ont disparu, elles sont complètement invisibilisées.
Au quotidien, cela devient extrêmement compliqué de maintenir une attention à la provenance des choses, au point qu’on en arrive désormais à faire des applications de « traçabilité » : c’est devenu tellement abstrait qu’on a besoin de rematérialiser la réalité des parcours effectués par les produits, en mettant des chiffres pour traduire ça en bilan carbone… On est entrés dans un régime de dé-territorialisation, qui est aussi un régime d’anonymisation : il est désormais normal de ne pas connaître les gens qui fabriquent notre monde au quotidien. Au mieux, on connaît son épicier ou son boulanger, mais on ne sait plus d’où vient la farine, qui la travaille, comment, etc. L’amnésie environnementale se double donc d’un effacement des gestes de base, c’est tout le drame de notre quotidienneté moderne : on ne perçoit plus tout ce dont on dépend profondément. On est hors-sol.
Vous opposez les quotidiennetés « moderne » et « paysanne » : pourquoi cette terminologie ?
Je la tire du travail du philosophe marxiste Henri Lefebvre, qui a beaucoup étudié la façon dont le capitalisme a justement imprimé ses codes – et ce faisant, sa domination – au corps social à travers les expressions de la quotidienneté. Selon lui, le moindre geste, la moindre activité, le moindre objet, qui pourrait sembler « infrapolitique » ou sans conséquence, doit être inscrit et compris dans une sorte de travail « total » de l’industrie capitaliste. Or, Henri Lefebvre a fait sa thèse sur des communautés paysannes dans les Pyrénées, dans un contexte où la société de consommation s’imposait progressivement.
Henri Lefebvre (1901-1991) est un penseur marxiste hétérodoxe, « suspendu » du Parti communiste en 1958. Son œuvre la plus connue, la trilogie Critique de la vie quotidienne (1947, 1961, 1981), s’intéresse aux modes de vie paysans et rappelle la nécessité de désaliéner le quotidien, façonné par la consommation dirigée, l’industrie et le capitalisme.
C’est un marxiste très particulier, qui n’a jamais considéré les sociétés paysannes comme des sociétés arriérées, archaïques ou nécessairement conservatrices. Au contraire, il y a toujours vu des formes d’autogouvernement assez poussées, avec un fort potentiel de mise en commun du travail de subsistance et de redistribution entre les membres de la communauté. En 1950, il y avait encore des sociétés paysannes en France, tout particulièrement dans les montagnes. Il a donc pu témoigner de la bascule d’un mode de vie, de cette vie quotidienne de plus en plus appareillée par la consommation dirigée. Il lit cette transformation dans le paysage, dans sa géographie, qu’il interprète comme une sédimentation millénaire de travaux humains pour rendre les terres arables, les forêts ainsi structurées, etc.
Autrement dit, il ne regarde pas un « paysage », mais un travail d’organisation communautaire par les paysans pour gérer tous les « communaux » sur plusieurs générations. À cette époque, se balader en plein air, cela signifiait forcément rencontrer des gens en train de couper du bois pour l’hiver, de faire du foin dans les champs ou d’entretenir les bordures des ruisseaux. C’était un espace extrêmement habité par des gens affairés par la régénération, le stockage, la circulation de matières vitales. Cela crée un tout autre rapport au monde.
« En régime industrialisé, l’appréhension sensible – en face-à-face – du monde n’est plus nécessaire pour lareproduction de la vie », écrivez-vous.
Quand le milieu de vie est cassé, bétonné, artificialisé, quand on n’entend plus tous les êtres vivants qui peuplent un territoire, alors nos sens ne sont plus éveillés de la même manière. On n’est plus qu’au contact de choses fabriquées par l’être humain, sans égard pour l’ensemble de l’écosystème et de toutes ces interrelations qui nous sont absolument nécessaires. On a une écoute du monde qui devient très pauvre. Il nous faut alors des voix comme Rachel Carson [biologiste américaine, autrice de Printemps silencieux publié en 1962, ndlr] pour nous dire « Attention, il n’y a plus d’oiseaux ! ».
Cette atrophie sensorielle, c’est ce que Henri Lefebvre appelle « la perte du rythme du monde », qui correspond à cette idée que les sociétés paysannes ont un certain sens des mouvements de la vie et des fenêtres d’opportunité, où il convient d’engager tel geste, d’employer telle méthode. C’est tout cela qu’on perd alors même que cette écoute du monde est absolument décisive pour s’adapter à son milieu de vie. Au fond, il s’agit de re-rendre vital ce qui nous apparaît désormais accessoire.
Cette réflexion a des proximités évidentes avec les philosophes qui pensent nos interdépendances avec le monde vivant, tels Baptiste Morizot et Vinciane Despret, comme avec ceux qui interrogent « l’habitabilité du monde » et notre rapport aux ressources, à la façon de Bruno Latour. Mais plus qu’« atterrir »comme le propose ce dernier, vous appelez de votre côté à renouer directement avec la matière, à y enfouir concrètement nos mains, pour lutter contre « l’oubli de la matérialité qui nous fait vivre », en puisant inspiration également du côté de plusieurs théoriciennes écoféministes. Qu’apporte, selon elles, le fait de se reconfronter ainsi à la « matérialité » des choses ?
Outre la réflexion globale sur le renouvellement des matières, cela permet aussi de sortir d’une distinction très puissante qui organise notre société : celle qui est faite entre le travail intellectuel – le logos – d’un côté et le travail manuel de l’autre. C’est une division, souvent genrée, que les féministes et écoféministes ont toujours combattu de façon ardente, en expliquant qu’il n’y avait pas de petites « tâches » : toutes les personnes sont habilitées à faire ce fameux travail au contact de la matière, personne ne devrait en être détaché.
Autrement dit, se remettre les mains dans la matérialité du monde, c’est donc d’emblée avoir une démarche féministe puisqu’on ne hiérarchise pas parmi ces enjeux : il n’y a pas d’un côté la matérialité, sous-entendue « noble », du peintre et de l’autre la matérialité, bien plus laborieuse, du balai. Le peintre doit passer le balai et le balayeur doit s’emparer du pinceau. L’écoféminisme m’apparaît là-dedans comme quelque chose qui permet de tout relier : à la fois l’épuisement des ressources naturelles et la disparition des écosystèmes, mais aussi l’exploitation d’une certaine partie de la population – en l’occurrence, les femmes, mais aussi les colonisés, que l’on cantonne à certains métiers et que l’on invisibilise. C’est une intersectionnalité en actes, qui croise différentes oppressions.
Il y a par ailleurs un parti pris sémantique très fort pour désigner ce travail manuel de la matière : vous parlez d’un travail de la « subsistance ».
C’est un terme que j’emprunte notamment à deux écoféministes allemandes, Maria Mies et Veronika Bennholdt-Thomsen, qui ont publié en 1997 un livre important, La Perspective de la subsistance. Avec Claudia Von Werlhof, elles incarnent un courant particulier : l’école de Bielefeld. C’est aussi un groupe de recherche et d’activisme qui a renouvelé en profondeur la critique de l’économie marchande à partir de cette double dimension, à la fois écologiste et féministe. Pendant vingt ans, elles ont ainsi entrepris un long travail de réflexion et d’enquêtes en sciences sociales autour de terrains non européens : Maria Mies en Inde – où elle rencontra notamment Vandana Shiva –, Veronika Bennholdt-Thomsen au Mexique et Claudia Von Werlhof au Venezuela. Elles y étudient la façon dont la place des femmes est dégradée par l’introduction du capitalisme, la « Révolution verte » – qui n’a d’écologiste que le nom : les pesticides, l’agro-industrie, le travail sur les semences désarticulent les sociétés paysannes, en signant leur conversion accélérée à la société marchande.
La répartition du sale boulot est une question de justice.
La production industrielle de biens de consommation massive remplace la production locale des biens de subsistance. Les effets sont désastreux sur la condition des femmes paysannes, qui étaient traditionnel-lement dotées de pouvoir d’action. Certes, selon une stricte division du travail, mais ce n’est pas rien que d’avoir le pouvoir de mettre au monde, de préserver les semences, le tissage, le petit élevage, d’aller le vendre au marché, de tenir les cordons de la bourse. Cela couvre les besoins de base des sociétés ! En bref, leur rôle majeur dans la subsistance commune leur conférait une autonomie, qu’elles perdent complètement en allant à la ville et en devenant des consommatrices, femmes d’ouvriers et d’employés. Les écoféministes allemandes ont un regard décolonial sur cette évolution du travail de femmes qui se joue entre les villes et les campagnes du Nord, puis entre les campagnes et les villes du Sud global.
Cette perspective était absente chez la plupart des féministes blanches des années 1970, qui n’interrogeaient pas nécessairement la mondialisation de la consommation et pour qui l’émancipation passait justement par le fait de se détacher du travail manuel et de la terre. La priorité, c’était que les femmes intègrent le marché du travail – au sens salarié du terme – puis y fassent carrière. Dans ce paysage, Françoise d’Eaubonne fait exception en France, en dénonçant cette illusion et en la couplant avec l’exploitation des ressources naturelles. Mais à ma connaissance, elle n’a pas établi de liens intellectuels ou militants avec les écoféminisme de l’école de Bielefeld. Cela explique en grande partie pourquoi ce terme de « subsistance » ne s’est pas imposé en France et pourquoi ces théories féministes restent ici largement méconnues.
Françoise d’Eaubonne (1920-2005) est une écrivaine et militante marxiste française, à qui l’on doit le néologisme « écoféminisme ». Redécouverte depuis une dizaine d’années en France, elle est l’une des premières à établir un lien entre patriarcat et capitalisme, ce « Système mâle » par lequel les hommes ensemencent la terre comme le corps des femmes, en les surexploitant l’une et l’autre.
Autrement dit, le problème, c’est la division internationale du travail qui semble désormais s’imposer à toutes les sociétés ?
Le régime moderne de notre quotidienneté se fonde sur le discrédit et l’invisibilisation du labeur agricole, qui se mécanise progressivement au fur et mesure que la population agricole diminue, et devient très spécialisé – et non plus partagé, en termes de savoirs, mais aussi de rythmes de vie avec le reste de la population. Se met en place une division très nette des espaces et des temporalités sociales : il y a la sphère du travail salarié, la sphère domestique et l’espace public. Ces espaces ne communiquent pas forcé-ment entre eux, ils sont surtout hiérarchisés et très genrés. Pour contrer ce processus, Maria Mies et Veronika Bennholdt-Thomsen développent le concept de « sweat equity » – l’« équité dans la sueur », littéralement – qui va beaucoup plus loin que la redistribution de la charge domestique aux hommes.
Maria Mies, née en 1930, est une écoféministe allemande de tradition marxiste, militante pacifiste, altermondialiste et spécialiste de l’Inde. Elle fait la connaissance de Vandana Shiva en 1988, qui milite à l’époque contre la violence et les ravages de la révolution verte en Inde. Elles cosigneront un livre ensemble, Ecofeminism (1993).
C’est l’idée qu’il n’y a pas d’égalité possible s’il n’y a pas de partage des tâches de transformation des matières et services vitaux – tâches qui peuvent être pénibles. Cela vaut aussi pour les métiers du soin par exemple, ou tous ces boulots en « première ligne » dont on a redécouvert la crucialité pendant le confinement. Ce travail-là est souvent très répétitif et revient aux femmes, alors qu’il est absolument partageable ! C’est ce qui m’a beaucoup intéressée dans le fonctionnement des chantiers participatifs en écoconstruction, par exemple : hors de question de spécialiser quelqu’un dans le fait d’aller chercher des bottes de paille, de faire le béton ou de taper avec le marteau pendant des heures ! Il y a une rotation des tâches car c’est justement pénible et répétitif.
La répartition du sale boulot est une question de justice. Et plus largement, c’est une critique de la logique des spécialisations professionnelles, qui sont elles-mêmes les principales vectrices des inégalités salariales, et donc elles-mêmes vectrices des inégalités sociales. Or, cela reste aujourd’hui l’un des fondements de notre organisation sociale. La redistribution est pensée au mieux en termes de compensation monétaire mais en bout de chaîne, il faut bien quelqu’un ou quelqu’une pour mettre les mains dans la terre, dans le liquide, dans les déchets.
Nous aurions tout simplement perdu le sens du « métier de vivre », comme vous le qualifiez ?
Oui, vivre est un métier ! Et plus précisément, toute une chaîne de petits métiers qui nous permettent de nous alimenter, nous vêtir, nous chauffer, etc. Il ne suffit pas de naître pour savoir se débrouiller immédiatement dans l’existence, ça se saurait !
Votre choix de convoquer et de réhabiliter le terme de « subsistance » ne participe-t-il pas d’une bataille lexicale et donc culturelle plus large ? Car historiquement, toutes les grandes idéologies politiques se sont construites sur cette idée d’émancipation vis-à-vis de tout ce qui fonde la « trivialité de notre condition terrestre »…
C’est parfaitement assumé. C’est d’ailleurs pour cette raison que je nomme « triviales-locales » toutes ces femmes qui n’ont pas perdu le lien avec la subsistance. Pour elles, l’arrachement à la matérialité du monde prive d’autonomie. L’asservissement, c’est de ne plus avoir de prise sur nos propres moyens d’existence, d’être pieds et mains liés au capitalisme industriel et à tous ces gens qui nous vendent de quoi nous nourrir, nous vêtir, etc. La question se pose toujours sous un angle qui lie le Nord au Sud global : au prix de quel peuple et de quelles ressources l’émancipation des femmes du Nord se fait-elle ? Cela revient à s’intéresser aux coûts cachés de cette prétendue « émancipation » : qui doit donc, en bout de chaîne, assurer les moyens de notre subsistance ? Dès lors, l’émancipation apparaît surtout comme une histoire de récit politique, destinée à éclipser d’autres conceptions de l’autonomie.
Au fond, cela revient toujours à poser la grande question politique de l’autonomie, et on pourrait tout aussi bien parler d’autosuffisance ou de résilience. Mais ce faisant, la notion de subsistance est aussi une façon pour vous de poser ces perspectives différemment de ce que peut faire la collapsologie, par exemple.
Effectivement, il ne s’agit pas de se réapproprier ses moyens d’existence pour faire face à la catastrophe, mais parce que c’est un principe élémentaire du vivre-ensemble pour toute communauté humaine ! L’autosuffisance pourrait désigner la même chose, mais il y a quelque chose de l’ordre de la bataille conceptuelle qui se joue dans la terminologie. Parler de subsistance, c’est une façon d’inviter politiquement à penser les choses différemment. Je suis toujours gênée par le mot « auto » dans « autosuffisance », « autoproduction », « autoconsommation » : comme si ce n’était fait que par soi-même, pour soi-même ! Or, le cadre de subsistance est forcément relié à une organisation sociale, cela permet d’échapper au préjugé individualiste qui prévaut parfois pour envisager les solutions.
Cela permet aussi de sortir de ce vocabulaire « capitalo-centrique » comme l’appelle Gibson-Graham : le fait même de parler d’« autoproduction », c’est continuer à considérer que la production industrielle reste le paradigme à partir duquel on doit penser notre alternative, c’est faire de notre système de consommation une sorte de grille écrasante pour expliquer l’intégralité des sociétés humaines, y compris contemporaines. C’est pourquoi je défends ce concept, historiquement et géographiquement marqué, de « subsistance ». Et même plus encore, je parle d’« entre--subsistance », pour éviter de laisser penser que la subsistance peut s’accomplir à l’échelle d’une seule petite famille nucléaire. Ce n’est pas possible, c’est forcément quelque chose qui se joue à une échelle plus collective : aujourd’hui, tout n’est pas trouvable dans votre jardin, il faut bien se connecter à d’autre types de matières premières, d’autres gens qui les travaillent et d’autres formes de savoir-faire.
A fortiori aujourd’hui où plus personne ne peut prétendre connaître toute cette variété de métiers que les paysans avaient intégrés depuis longtemps, eux qui savaient être sabotier, jardinier, éleveur, etc. Quand je parle de la nécessité d’une « poly-activité relocalisée », c’est une façon de renouer avec cette figure paysanne bien connue qui pratiquait la polyculture-élevage et qui est, comme son nom l’indique, polyvalente en matière de savoir-faire. C’est, à mon sens, l’une des raisons du grand succès de la permaculture – qui invite à un savoir généraliste : on s’y forme à la fois au glanage, à la connaissance des plantes sauvages, au maraîchage, à la récupération d’eau de source et à tout un tas d’arts du bricolage… cela brasse plein de savoir-faire différents qu’il faut apprendre à combiner et à distribuer. Faire un stage de permaculture, c’est une manière de s’initier en un temps record à un apprentissage qui s’incorporait autrement depuis l’enfance. La connaissance fine de son milieu de vie et des cycles de subsistance, c’est un travail d’observation de très longue haleine, avec des transmissions collectives importantes, nécessaires, qu’il est urgent de diffuser le plus largement possible.
Pour décrire ce cadre collectif et son échelle d’action, vous utilisez l’image de la « maisonnée ».
C’est une façon de réintroduire l’idée de communautés paysannes, d’un lieu de cohabitation familière entre différentes générations, avec une variété de compétences, de métiers, de rapports de genre. On peut y intégrer les animaux, les plantes, le monde vivant et y associer des voisins. Une maisonnée, c’est très peuplé, c’est un petit monde en plein brassage, là où nos cercles familiaux, aujourd’hui, deviennent de plus en plus vides. C’est à la fois une communauté de vie, on y coréside, mais c’est aussi une communauté de travail, les gens ayant des activités communes, ainsi qu’une communauté de débat et d’arbitrage.
C’est donc un lieu où l’on s’interroge par exemple sur la redistribution du travail. Il y a un potentiel d’horizontalisation et d’entraide, c’est un lieu d’interdépendances, où l’on circule dans un réseau vicinal, mais cela peut aussi mettre en lien des territoires distants géographiquement. C’est bien plus ouvert qu’un simple foyer domestique. Un quartier, par exemple, peut être considéré comme un regroupement de maisonnées : quand on dit « les quartiers se mobilisent », on parle en fait exactement de maisonnées qui s’organisent.
Ce sont des échelles politiques plus réduites, en termes d’effectifs, mais c’est cette échelle qui m’intéresse. Parce que les liens sont tangibles et ils se font à une échelle pédestre. Arpenter un même territoire en tous sens, c’est l’appréhender concrètement et ressentir sa dégradation. Rien de tel que voir une personne âgée traverser sur un passage piéton pour comprendre combien l’espace public peut être violent dans son organisation, à travers ses transports, etc. Cette évidence surgit d’autant mieux à ces échelles-là. Cela permet de relocaliser l’espace du politique, sans intermédiaire, et de réfléchir aux vraies conditions d’une démocratie directe.
Cette dimension collective, et donc politique, c’est ce qui constitue la nuance fondamentale entre une politique du « moindre geste » et celle des petits gestes ?
La différence est importante, oui. La politique des petits gestes individuels n’ouvre pas vraiment de réflexion sur la mise en commun des moyens de production et sur le partage du travail, autrement dit, elle ne permet pas vraiment d’accéder à une logique plus collective de production de biens de subsistance. L’autre limite, c’est que cela reste très attaché à un cadre général de consommation. On peut recycler, avoir des toilettes sèches et être zéro déchet, sans à aucun moment questionner par ailleurs le capitalisme. Votre geste vous met en conformité avec une bonne conscience écologique, mais vous n’interrogez jamais la racine du problème. Et si vous ne percevez pas que ce geste vous connecte politiquement aux luttes de Notre-Dame-des-Landes ou de la Via Campesina, par exemple, alors cela reste un « petit » geste qui ne constitue pas une porte d’entrée pour s’engager davantage. Quand on rentre dans une logique de subsistance, on cherche une forme de cohérence de vie assez complète – par exemple, on ne peut plus vraiment continuer à prendre l’avion, ou profiter du salaire de son mari qui est dans la pétro-masculinité… cela devient difficile.
Le moindre geste et les petits gestes ne relèvent donc pas du même référentiel politique, mais pour autant, je ne veux pas monter les uns contre les autres. Dans mon enquête de terrain, je parle aussi bien de luttes « frontales » que de luttes feutrées, avec des gens ordinaires, qui restent pris dans les mailles de la société de consommation. Cela ne les empêche pas de faire de petits pas de côté en faveur du maintien de gestes de subsistance. Il y a des complémentarités à trouver dans ces modes d’action, tous ont leur intérêt. Là aussi, les écoféministes sont très utiles : elles nous rappellent qu’il n’y a pas de petites échelles, de petites approches, de petites actions !
Biographie
Geneviève Pruvost est sociologue du travail et du genre au Centre d’étude des mouvements sociaux de l’EHESS. Médaille de bronze du CNRS, elle a enquêté pendant une décennie sur la police, puis sur l’usage légal et illégal de la violence par les femmes, avant de s’intéresser aux communautés rurales, aux alternatives écologiques et aux fondements politiques de la vie quotidienne.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don