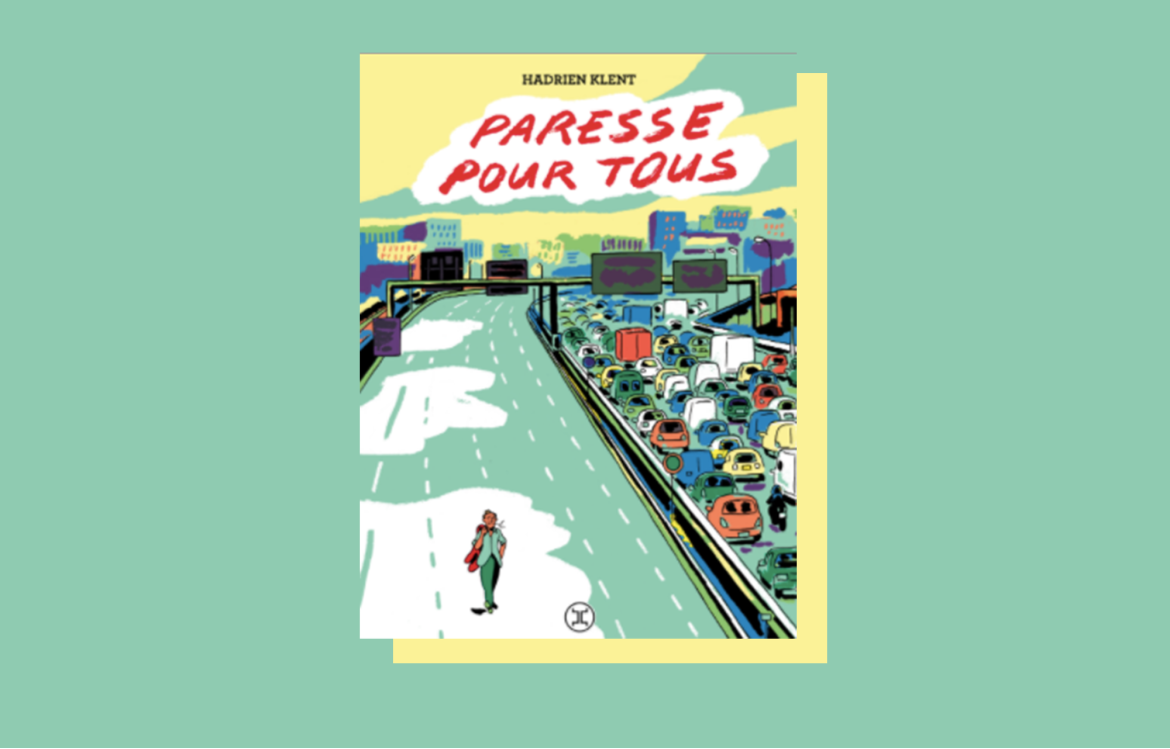Pour commencer, pourriez-vous revenir sur la genèse de ce livre, Paresse pour tous ? Comment cette idée vous est-elle venue ?
Il s’agit d’une idée que nous avons eue à deux, avec Alessandra Caretti. Nous sommes tous les deux de grands fans de L’An 01, la bande dessinée de Gébé, et nous cherchions à l’origine une sorte d’An 01 d’aujourd’hui, une forme d’utopie politique qu’on raconterait en bande dessinée. On était ravis à l’idée de faire une bande dessinée sur un candidat à la présidentielle qui défend le droit à la paresse ! On a fait plusieurs séances de travail, en rigolant beaucoup et fixant pas mal d’idées qui sont encore dans le roman. On avait même commencé à contacter des dessinateurs... Mais assez vite, on s’est rendus compte qu’une B.D. ne permettait pas de raconter assez de choses autour de cette thématique : on est quand même très limités en longueur de texte. Alors avec Alessandra, on a convenu qu’à partir de ce début d’histoire j’allais faire un roman : et somme toute ça s’est révélé être la bonne solution, parce que j’ai pu y mettre beaucoup de choses qui n’auraient pas trouvé leur place en bande dessinée.
Au cœur de votre récit, un candidat à la présidence de la République, Nobel d’économie, place au cœur de son programme une idée originale : « le droit à la paresse » pour tous, rendu possible par l’abaissement du temps de travail à 3h/jour. Cette proposition est réduite par ses opposants politiques à de la « flemme ».
Oui, le mot « paresse » est à double tranchant, et Émilien en parle plusieurs fois dans le roman, notamment lorsqu’il doit expliquer à ses enfants pourquoi ils n’ont pas le droit d’être « flemmards » alors que leur père défend la paresse ! J’aime bien ce passage, où la paresse renvoie clairement à une sorte de reprise en main de la vie : ne plus subir (tant les injonctions productives que les assauts de la consommation passive), décider de ce qu’on fait de son temps. La « paresse » pour Émilien Long, c’est prendre enfin le temps de vivre : ne plus être rivé à son travail, à ses écrans, à la consommation. Une forme de temps libre où l’on est obligés de s’interroger sur ce qu’on a envie de faire, ce qu’on aime, ceux qu’on peut aider, et ainsi de suite — tout simplement parce que tous les jours, après trois heures du travail, on est libre ! Cette liberté oblige à se reposer : se reposer la question de ce qui est bon pour nous.
Il s’agit d’un livre érudit, truffé de références à des philosophes et économistes qui ont pensé notre rapport individuel au temps et in fine la place qu’occupe le travail dans nos vies. Parmi les plus marquants, Lafargue ou Keynes. Ces références sont néanmoins pour la plupart un peu datées...
C’est vrai que beaucoup des références qu’utilise Émilien Long dans son essai datent de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Tout simplement parce que le tournant de la révolution industrielle a bouleversé le rapport des gens au travail, au temps, et à la contrainte. Et donc évidemment il y a eu toute une pensée, qu’elle soit marxienne (Lafargue était à la fois le gendre de Marx et un théoricien du marxisme), à tendance anarchisante (William Morris, les surréalistes), ou plus social-démocrate (Keynes, Russell), qui a cherché à remettre en question la situation qu’imposait le capitalisme triomphant de cette époque. Plus tard, même si les Trente glorieuses ont semblé mettre un peu de côté cette critique, n’oubliez pas que les années 1960 et 1970 n’ont pas été avares de propositions sur le temps libre : le situationnisme, L’An 01 de Gébé et tout le mouvement décroissant (autour de La Gueule ouverte ou de la candidature de René Dumont en 1974) sont aussi des références d’Émilien Long. Quant à aujourd’hui... Eh bien oui, aujourd’hui c’est plus compliqué : la loi sur les 35h a été suivie par des années de polémiques ahurissantes, le « travailler plus pour gagner plus » a fait beaucoup de dégâts, et la pensée critique aujourd’hui a tendance à se déployer dans d’autres champs. Mais n’oublions pas qu’à la présidentielle de 2017, Benoît Hamon a fait entrer dans le début public la notion de revenu universel, qui a tout de même le mérite d’obliger à remettre en question le dogme du tout-travail. Et puis on est dans une période certainement moins théorique, mais qui ne rechigne pas à la mise en œuvre pratique : il y a beaucoup de lieux et de personnes qui mettent en application tout ou partie du programme d’Émilien Long, sans forcément le théoriser ou le médiatiser.
L’intrigue de votre roman débute pendant le premier confinement. Celui-ci a été marqué par de nombreux discours autour du « monde d’après ». Est-ce que vous y croyez ? Quelle place le travail pourrait-il occuper dans ce fameux monde d’après ?
Évidemment, le livre joue sur cette question du « monde d’après » — ne serait-ce que parce que je l’ai écrit pendant le printemps et l’été 2020. Et Émilien Long le note dès mars 2020 : si le travail est simplement remplacé par le télétravail, si le but c’est toujours de faire tourner une machinerie dont on ne sait plus très bien à quoi elle sert, alors franchement cette histoire de « monde d’après », c’est de l’esbroufe. Et ça sera toujours de l’esbroufe tant qu’on ne s’interrogera pas sur la toute-puissance de la société de consommation dans nos vies quotidiennes, depuis maintenant quelques décennies. Car il faut être clair : alors que la productivité a énormément augmenté depuis un siècle et demi, le temps de travail ne diminue plus, ou presque plus, depuis près d’un siècle. Pourquoi ? Tout simplement parce que le capitalisme a su inventer des nouveaux « besoins » que le consommateur va ensuite chercher à combler (et donc a besoin de travailler plus pour gagner de quoi s’acheter ce « plus »). Et la spirale ne s’arrête jamais. Un ordinateur, un smartphone, une tablette, une liseuse, une télévision, qu’on multiplie par le nombre de personnes présentes au foyer... 3G, 4G, 5G, ADSL, fibre, internet satellitaire. Voitures autonomes, avec sièges relaxants et chauffants. Réfrigérateurs nous envoyant des sms quand il n’y a plus de yaourts. Etc. Une surabondance qui ne sert à pas grand-chose, si ce n’est à masquer à nos yeux les enjeux profonds. Il n’y aura pas de « monde d’après » si chacun, individuellement, ne s’interroge pas sur la place qu’il voudra y prendre. Moins travailler, c’est aussi moins consommer (et vice-versa).
Nous avons intériorisé un certain nombre d’injonctions à être plus productifs, plus performants. Votre livre (et le programme d’Émilien Long) peut être lu comme un petit manuel de survie contre celles-ci. Quelles sont, selon vous, les meilleures façons d’y résister ?
Oui, il y a tout un programme que développe tant Émilien Long que le roman au fil des pages. J’ai essayé d’agglomérer, l’air de rien, pas mal de petites luttes qui peuvent se mener de manière quotidienne, et qui sont évidemment connues par beaucoup de gens qui ne veulent pas subir le capitalisme triomphant (et donc, bien sûr, beaucoup de lecteurs de Socialter !) mais qu’il est toujours bon de répéter :
— utiliser son vélo plutôt que n’importe quel véhicule motorisé dès qu’on fait des trajets de moins de 8 kilomètres, et ce quel que soit le climat ou la saison : c’est bon pour le corps, c’est bon pour l’esprit, et c’est bon pour la planète ! Et ça donne le juste rapport au temps : certes c’est un peu plus long, mais on perçoit mieux le trajet qu’on fait. Pareil à pied évidemment !
— refuser d’utiliser au maximum les outils numériques des GAFAM, soit en s’en passant purement et simplement (posologie idéale) soit en les remplaçant par des équivalents ouverts (ordinateurs sous Linux, logiciels libres, téléphones Android « dé-googlisés », applications de communications ouvertes, adresses email surtout pas chez gmail, etc.).
— faire, dès que l’on peut, ses propres productions vivrières : soit sur balcon, soit si l’on a chance d’avoir un jardin en pleine terre. Soit si c’est possible (et c’est souvent possible au moins de s’inscrire sur une liste d’attente) dans un jardin partagé pas loin de chez soi.
— évidemment acheter des produits bio, locaux, etc. Moins de viande (ou pas du tout !).
— refuser de parvenir : ne pas s’obliger à devenir ce que les autres ou la « société » voudraient qu’on soit (réussite sociale, matérielle). Considérer, comme Albert Thierry en son temps, qu’on est plus utile à une place qui nous semble juste qu’à une place qui « leur » semble bonne.
— ne pas accepter un boulot « qu’on n’aime pas mais qui est bien payé », ni « participer un système qu’on déteste », ni encore « bien savoir qu’on n’est pas cohérent là-dessus mais que veux-tu ? », et ainsi de suite. En gros, cesser au maximum d’être complice ; se rappeler que le monde aura du mal à aller mieux si soi-même on l’aide à aller mal.
— et enfin, cerise sur le gâteau, défendre un modèle de société qui diminuerait fortement le temps de travail : et pour cela, voter pour Émilien Long à la prochaine élection présidentielle !
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don