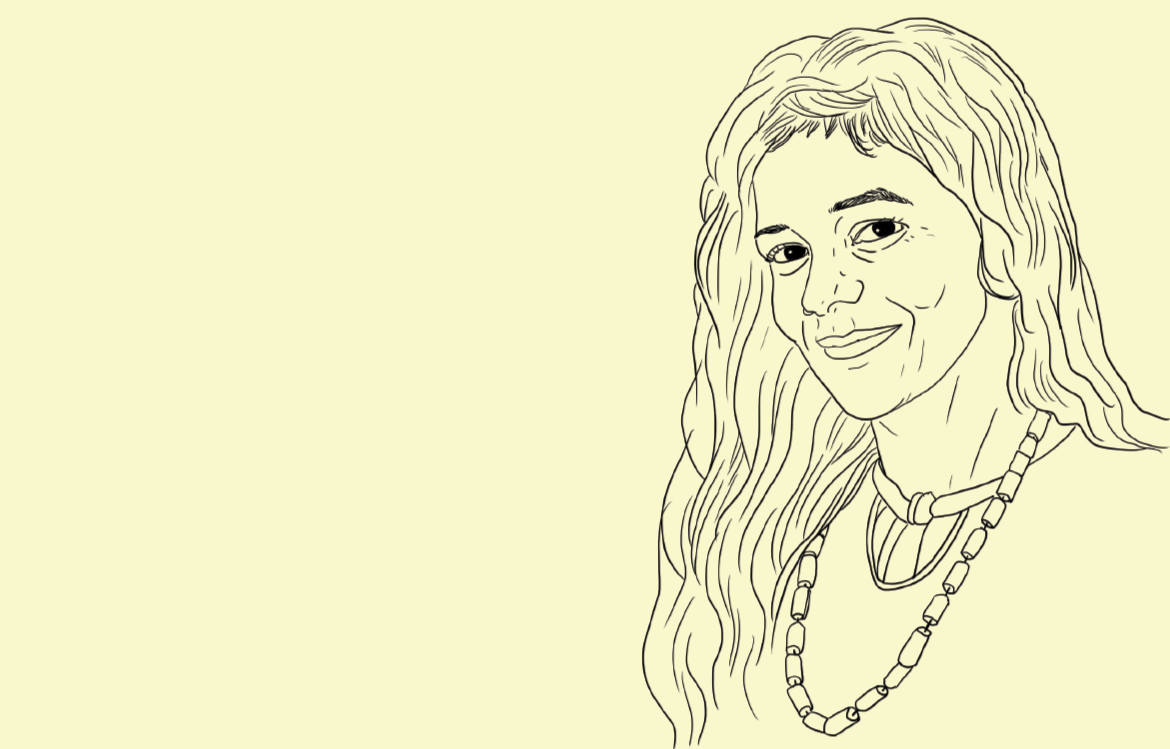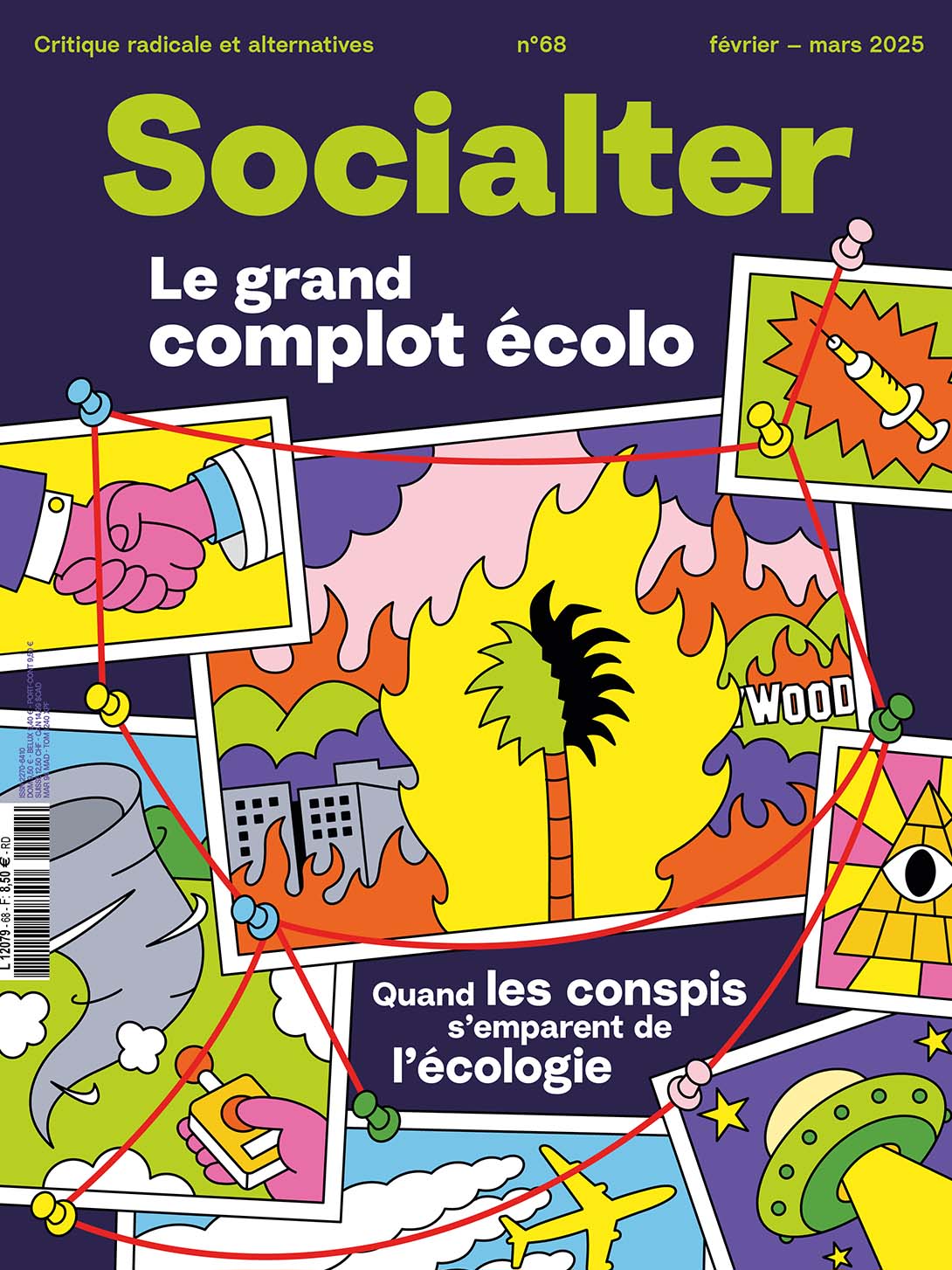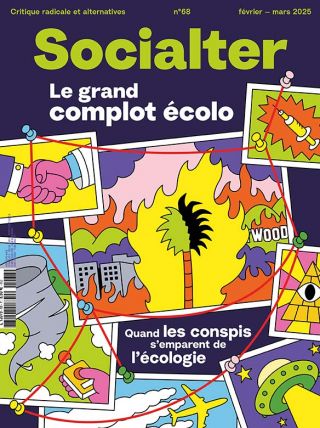«Jacqueline Manicom est décédée. Née en Guadeloupe, elle s’est très tôt intéressée à la condition de ceux qui sont les victimes du capitalisme exploiteur et notamment de la condition de la femme. » Par ces quelques mots, le mensuel communiste révolutionnaire Combat ouvrier du 5 mai 1976 salue la mémoire de l’écrivaine et militante féministe qui s’est donné la mort le 21 avril 1976 à Massy, dans l’Essonne, à plus de 7 000 kilomètres de la Guadeloupe qui l’a vue naître le 1er avril 1935.
Article de notre n°68 « Le grand complot écolo », disponible en kiosque, en librairies et sur notre boutique.
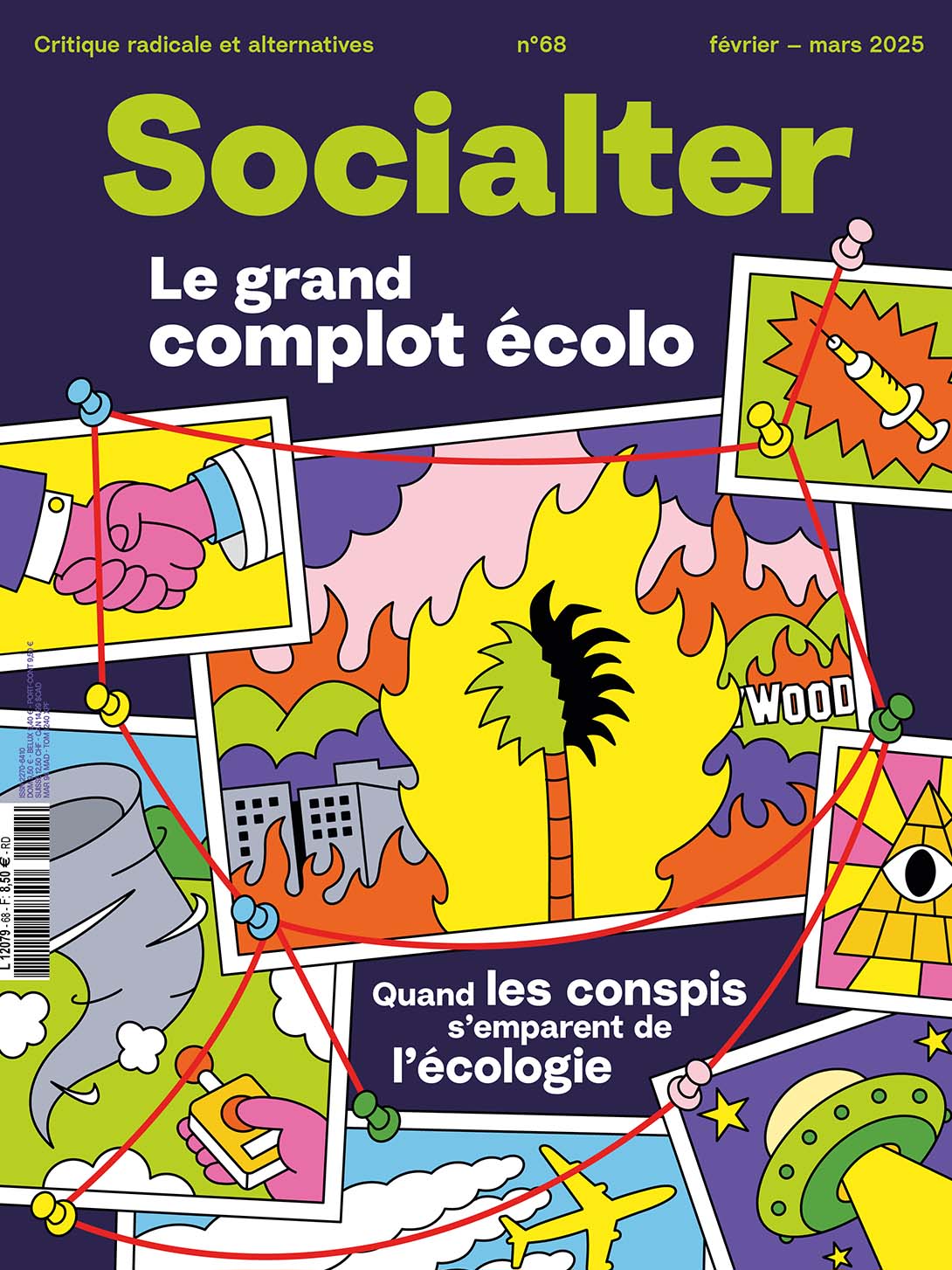
De l’île aux Belles Eaux à la région parisienne, le parcours de Jacqueline Manicom a été fulgurant, avant qu’elle ne tombe dans l’oubli. Elle grandit au Moule, situé sur l’île de Grande-Terre ; son père est le chauffeur personnel du patron de l’usine de rhum Gardel. « Manicom est une “coolie”, comme on dit sur l’île, c’est-à-dire une Indienne. Son arrière-grand-mère, Jitni, est venue de Kolkata (Calcutta) dans les années 1860 », explique sa biographe, l’historienne Hélène Frouard, qui vient de publier Jacqueline Manicom, la révoltée (éditions de l’Atelier), le premier ouvrage consacré à cette figure guadeloupéenne.
Aînée de sa famille, Jacqueline Manicom est suivie par 19 frères et sœurs. Sur les 20 enfants, 10 ont survécu. Elle doit d’ailleurs interrompre ses études à 17 ans et renoncer à passer le baccalauréat pour aider sa mère alitée par une nouvelle grossesse, voyant ainsi disparaître son rêve de devenir médecin. Mais le souvenir de la sage-femme qui avait sauvé la vie de sa mère lors d’un accouchement difficile a joué un rôle déclencheur : « Je me suis dit que sage-femme, c’est ça que je dois faire. Je pourrai aider les femmes comme ma mère. »
Passionnée par son métier, Jacqueline Manicom a été saluée pour son sérieux et pour l’attention qu’elle témoignait aux autres. « Dans ma carrière de sage-femme, j’ai mis au monde plus de cinq mille enfants.Mais chaque femme accouche de “son” enfant, et en face de chacune d’elles, je me retrouve comme devant l’unique accouchée de la Terre », notera-t-elle plus tard dans La Graine. Journal d’une sage-femme, publié en 1972 (Presses de la Cité).
De la « névrose antillaise » à une nouvelle vie
Après des études en Martinique, la jeune femme s’envole vers Paris en 1958, embauchée à l’hôpital Bichat. C’est là qu’elle rencontre Jacques, interne en médecine. Elle tombe enceinte, un mariage est prévu. Mais le bonheur ne dure pas : les parents de Jacques refusent cette union. Les sources du désaccord varient, Jacqueline Manicom invoque leur racisme, la réduisant à un statut d’« exotique étrangère » indigne d’intégrer leur famille. Les parents acceptent finalement le mariage afin que l’enfant à naître soit reconnu, mais auraient demandé à ce que le couple divorce dans la foulée.
Mariés le 20 mars 1959, parents trois mois plus tard d’un petit garçon, Jacques et Jacqueline Manicom divorcent un an après. Elle relate cet épisode de sa vie dans Mon examen de blanc, paru en 1972, mettant en scène une anesthésiste guadeloupéenne et un médecin blanc issu d’un milieu aisé. Sauf que son héroïne, Madévie, refuse finalement ce mariage misérable et avorte, avant de rentrer en Guadeloupe. « Vivre, désormais, pour Madévie, ce sera dépasser sa seule affectivité personnelle en s’intégrant à l’histoire de son pays, dans cette mer des Caraïbes où elle “rentre” », écrit l’avocate et féministe Gisèle Halimi (1927-2020) dans sa recension élogieuse parue dans Le Nouvel Observateur en 1973. Le roman rend aussi compte de la « névrose antillaise » analysée par Frantz Fanon1 (1925-1961).
Au travers de son héroïne Manévie, Jacqueline Manicom décrit la fascination qu’elle a eue pour son premier mari et pour son milieu social, blanc et bourgeois. Considérée comme une figure de la littérature antillaise, à l’instar de Mayotte Capécia, qui a publié en 1950 le roman La Négresse blanche, elle écrit sur la condition de la femme antillaise et la quête de soi : « Elles thématisent ce que Frantz Fanon a désigné comme “le complexe de la lactification”, ce désir d’être blanc dont souffre la société bourgeoise [antillaise] de l’époque », souligne l’universitaire Christa Stevens2.
La sage-femme s’intéresse au Mouvement français pour le planning familial et s’attèle à l’étendre en Guadeloupe.
« À partir d’un échec, le commencement d’une vie », note Gisèle Halimi à propos de Jacqueline Manicom. Après son divorce, elle retourne en Guadeloupe, où la situation sociale et politique est tendue. « Le pouvoir gaulliste a dissous le Front antillo-guyanais. En réponse, les étudiants guadeloupéens de Paris créent clandestinement en 1963 le Groupe d’organisation nationale de la Guadeloupe (le Gong), d’inspiration maoïste et castriste qui devient l’un des principaux foyers de la contestation. (…) L’objectif n’est plus le cheminement vers l’autonomie, comme le réclament les communistes antillais, mais l’indépendance de leurs territoires », rappelle Hélène Frouard.
Devenue sage-femme à la clinique Bellevue, aux Abymes, remariée à Yves Letourneur, professeur de philosophie et militant anticolonialiste, elle a à cœur d’améliorer la prise en charge des femmes enceintes. Les grossesses à répétition, comme ce qu’a vécu sa mère, la scandalisent, d’autant que les familles n’ont pas forcément les moyens d’élever autant d’enfants : « Souvent elles viennent consulter pour leur huitième, neuvième et parfois quinzième grossesse. Il arrive qu’elles soient enceintes pour la vingtième fois ! » écrit-elle.
La sage-femme s’intéresse alors au Mouvement français pour le planning familial, créé en 1960, et s’attèle à l’étendre en Guadeloupe. En 1964, elle fonde le planning familial en Guadeloupe, nommé la Maternité consciente. Le premier centre de consultation gratuite ouvre en janvier 1968 à Pointe-à-Pitre, suivi par 23 autres centres ouverts entre 1969 et 1971. Dans ces centres, pilules et stérilets sont distribués gratuitement aux femmes qui viennent consulter pour un moyen de contraception.
L’ « une des meilleures militantes » de Choisir
Mais Jacqueline Manicom n’a pas vraiment le temps de développer son projet, car, en 1966, elle retourne à Paris avec son mari. L’adoption de la loi Neuwirth qui autorise la contraception le 28 décembre 1967 change la vie des Françaises. La sage-femme, qui travaille désormais à la maternité de l’hôpital Boucicaut, informe les patientes sur les moyens de contraception disponibles et les nouveaux dispositifs légaux.
En parallèle, elle poursuit son travail militant auprès des Guadeloupéens qu’elle soutient dans leurs revendications pour l’indépendance : en mai 1967, plusieurs manifestants guadeloupéens meurent lors des émeutes qui ont éclaté à la suite d’une agression raciste. Son roman Mon examen de blanc, qui parait quelques années plus tard, leur est dédié. Son texte bénéficie aussi des conseils avisés de Simone de Beauvoir. « Moi, une femme de couleur, bafouée par un homme blanc. Je me suis sentie votre sœur et mieux vous avez été une amie », écrivait Manicom à Beauvoir en 1965.
Elle partageait avec la philosophe son souci pour la cause des femmes, adhérant en janvier 1972 au mouvement Choisir, cofondé par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir et œuvrant pour la dépénalisation de l’avortement. Jacqueline espère que « [son] expérience et [ses] compétences de sage-femme puissent servir » et témoigne d’ailleurs de la détresse des femmes face à l’avortement clandestin lors des célèbres procès de Bobigny, où une lycéenne tombée enceinte après un viol était jugée pour avoir tenté d’avorter. Son activisme médical se retrouve la même année dans son essai La graine. Journal d’une sage-femme, un succès de librairie, dans lequel elle dénonce les dysfonctionnements de la hiérarchie médicale, le paternalisme qu’elle subit de la part des médecins, le désarroi des patientes mal préparées à l’accouchement : « La sage-femme n’est pas adulte », constate-t-elle dans un reportage de l’ORTF de 1974.
Son décès, après une vie de lutte épuisante, est suivi par de nombreux hommages, où elle est saluée par Gisèle Halimi comme « l’une de leurs meilleures militantes ».
1. Essayiste et psychiatre martiniquais, il a notamment traité de cette question dans son ouvrage clef Peau noire, masques blancs, paru en 1952 aux éditions du Seuil.
2. Christa Stevens, « Entre fatalité et contestation : la littérature des femmes », dans Le Roman francophone actuel en Algérie et aux Antilles, sous la direction de Danièle de Ruyter-Tognotti et Madeleine van Strien-Chardonneau, CRIN, volume 34, 1998.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don