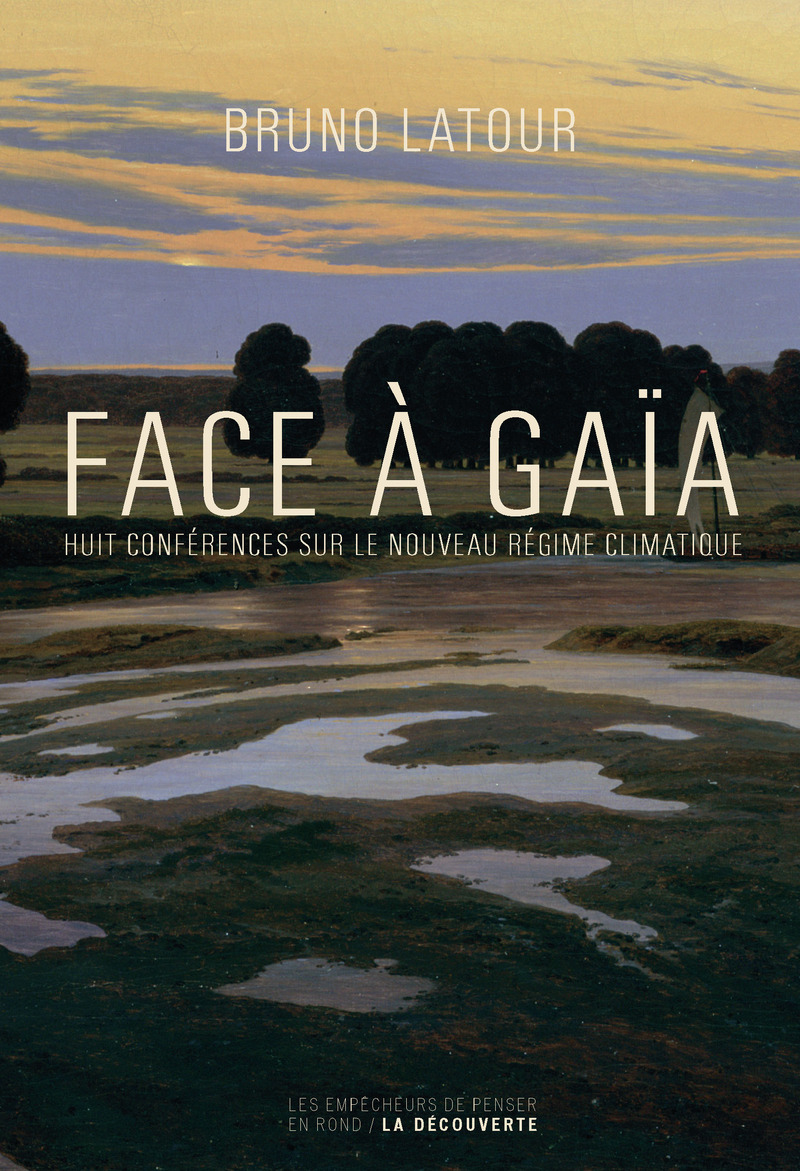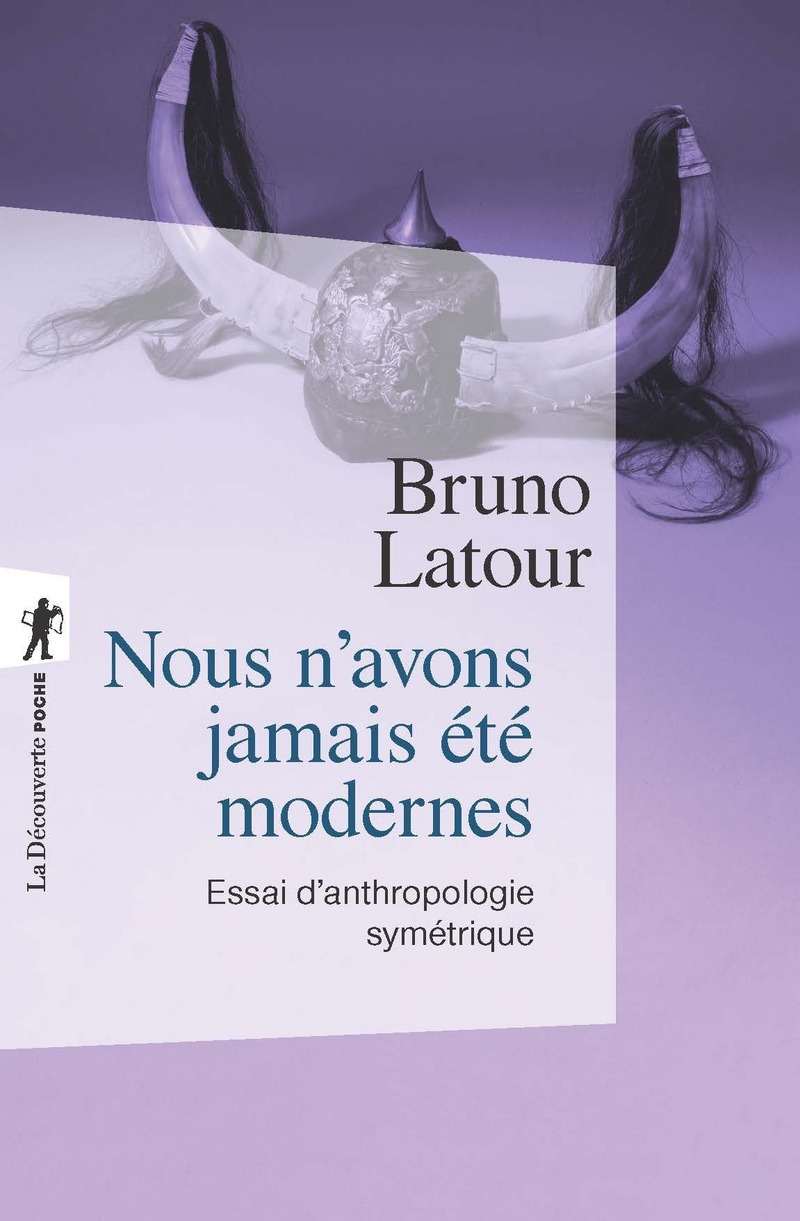C'est chez lui que Bruno Latour nous reçoit, un matin gelé de janvier. Dans un vaste appartement du quartier de l’Odéon, épicentre de toutes les grandes institutions intellectuelles françaises et du monde de l’édition. Sur la table carrée du salon, des bouquins sont éparpillés. On y trouve certains ouvrages auxquels il a récemment participé, comme le livre de son exposition Critical Zones, qui a eu lieu à Karlsruhe (Allemagne), ou un autre inspiré de sa pensée et qu’il a préfacé, Controverses, mode d’emploi (collectif sous la direction de Clémence Seurat et Thomas Tari, Presses de Sciences Po, 2021). Et, devant lui, notre hors-série Renouer avec le vivant. Ces derniers mois, Bruno Latour, 73 ans, a lutté contre la maladie ; il nous avertit qu’il est fatigué et que l’entretien pourra difficilement durer plus d’une heure. Finalement, l’échange s’étirera sur une heure et demie – et il le terminera en pleine forme.
Désormais, seule la Lune peut être regardée sans qu’on se sente coupable de la dégrader, dites-vous en ouverture d’Où suis-je ? Notre époque est-elle celle de la culpabilité généralisée ?
Avec cette image, je souhaitais introduire la variation cosmologique nouvelle dans laquelle nous nous trouvons : la responsabilité de l’action humaine est plus étendue qu’autrefois – mais, attention, responsabilité n’est pas culpabilité. Mon propos part de l’expérience du confinement et vise à dire : « Profitons du confinement pandémique pour comprendre cet autre confinement qui est le nôtre à l’intérieur de ce qu’on appelle la « zone critique » (1). À rebours de l’interprétation galiléenne faisant de la Lune et de la Terre les parties d’un même univers, la notion de zone critique nous resitue dans ce qu’on nous appelions autrefois « la planète ». Ainsi, nous avons accès à d’innombrables savoirs sur le reste de l’univers, mais toutes ces connaissances ne sont produites qu’à l’intérieur de cette zone critique – on ne peut faire l’expérience d’autre chose. Cette variation cosmologique a une conséquence politique : alors que l’action humaine paraissait peu de choses dans l’univers infini, celle-ci prend une ampleur inédite dans la zone critique. En traitant ainsi du problème du seuil et des dimensions, Où suis-je ? est un conte métaphysique.
C’est dans la littérature que vous piochez la figure emblématique de votre essai avec Gregor Samsa, le personnage principal de La Métamorphose (1915) de Franz Kafka. En quoi l’étrange destin de ce représentant de commerce un beau matin transformé en cafard éclaire-t-il notre condition contemporaine ?
L’événement que la nouvelle de Kafka signale équivaut à ce que nous subissons avec cet épouvantable confinement, qui figure notre confinement étendu à l’intérieur de la zone critique. Gregor Samsa incarne la façon dont ce changement cosmologique a des conséquences sur notre conception : nous ne pouvons plus définir un humain hors du monde dans lequel il est, et cela change ce que nous sommes en tant qu’humains. Mon hypothèse est que la notion de « nature » ne parvenait pas à rendre cela car elle créait une réalité extérieure dont les valeurs humaines, comme la conscience et la pensée, étaient coupées – ce fut la grande erreur de l’écologie politique que de s’être focalisée sur « la nature ». Si nous ne sommes pas dans « la nature », où est-on ? Dans la zone critique, à l’intérieur de Gaïa (2).
Quelles sont les implications philosophiques de notre « grand confinement » sur Gaïa ?
Nous sommes humains mais n’avons plus la même forme qu’avant, comme dans La Métamorphose. Et ce n’est pas simplement parce que nous portons des masques, mais parce que, désormais, nous nous préoccupons du CO2 que nous émettons, des microbes que nous transmettons, de l’impact écologique de nos achats. Ce bouleversement nous conduit à la question que j’avais abordée en 2017 dans Où atterrir ?, c’est-à-dire celle des mutations dans les luttes politiques. Jusque-là appréhendées comme un conflit de classes sociales, elles se transforment en lutte de classes « géosociales » lorsque l’on ajoute aux dimensions économiques celles liées à l’habitabilité de la planète. La lutte des classes sociales était censée se résoudre en rejetant l’exploitation sur les autres qu’humains. Avec l’actuelle lutte des classes géosociales, les injustices sont toujours commises et les inégalités encore là, à l’intérieur de notre zone d’habitabilité. Les bouleversements introduits par notre temps de l’Anthropocène renouvellent la question politique, à l’image de la crise des Gilets jaunes qui a débuté sur une question de classe géosociale – vouloir régler un problème environnemental avec une nouvelle injustice sociale, une taxe sur le carburant.
Pensez-vous que le confinement de 2020 ait constitué une telle rupture dans l’esprit du grand public ?
Tout dépend de la manière dont se passera la sortie du confinement. Je répète, depuis mars 2020, qu’il faudra se servir de la crise pandémique pour faire quelque chose d’original sur le plan écologique, mais je ne suis pas sûr de mon affaire. Cependant, malgré l’urgence médicale et économique, les questions de climat et de biodiversité n’ont pas été mises de côté, alors que j’étais initialement convaincu que la reprise économique balaierait le sujet. C’est ce qui me rend vaguement positif.
Est-ce, selon vous, le signe d’une bascule historique ?
Les historiens trouvent toujours des antériorités qui relativisent l’idée qu’il existe des « bascules historiques ». Mais le problème n’est pas la conscience d’un problème environnemental, c’est le nombre de gens qui partagent cette conscience et le temps pour atteindre une masse critique. On n’innove donc pas sur le contenu, mais sur le nombre de situations dans lesquelles ces connaissances sont mobilisées. Cela dit, j’ai animé il y a trois ans, au Collège des Bernardins, un séminaire sur « Les sources de l’insensibilité écologique » : je ne l’intitulerais plus ainsi aujourd’hui. Je crois qu’il y a, depuis trois ou quatre ans, un déplacement, notamment dû à Greta Thunberg et ce que j’appelle « la croisade des enfants ». Désormais, même ceux qui sont dans le déni sentent le vent du boulet ! Les catastrophes naturelles existent depuis longtemps, mais il y a quelque chose de nouveau dans ce passage de l’insensibilité à la sensibilité. Le problème, à présent, est que nous sommes sensibles mais ne savons pas quoi faire.
L’historien Jean-Baptiste Fressoz critique tacitement l’idée de « nouveau régime climatique »que vous défendez dans Face à Gaïaen montrant, dans son dernier livre Les Révoltes du ciel (coécrit avec Fabien Locher,Le Seuil, 2020), que l’anxiété à propos du climat remonte à la colonisation des Amériques. En quoi l’Anthropocène est-il une ère inédite ?
La critique formulée par Jean-Baptise Fressoz est pertinente, mais démontre en même temps un manque de sens historique. Le travail des historiens est de trouver des précurseurs, et ce dernier a tout à fait raison de montrer, comme dans L’Apocalypse joyeuse (Le Seuil, 2012), que l’absence de ces questions environnementales a tenu non pas à leur ignorance, mais à un déni conscient. Le moment important est celui où nous avons cessé, au XXe siècle, de penser le sujet, mais la nouveauté irréductible est que nous en sommes sortis pour poser une question planétaire qui s’adresse à 8 milliards d’individus. On peut donc dire « rien de nouveau sous le soleil », comme il le fait ; moi, j’affirme que c’est manquer de sens historique de ne pas saisir que cette question autrefois bourgeoise est devenue une transformation du système Terre au sens de Gaïa. Un récent article paru dans la revue Nature montrait que la masse des objets fabriqués par l’homme, comme le béton ou le goudron, dépassait désormais la biomasse vivante : c’est stupéfiant ! L’ouvrage Les Révoltes du ciel n’avance aucun exemple contredisant cette nouveauté, à savoir que l’aspect inédit de l’Anthropocène tient à ce que ce ne sont pas seulement les sols et les forêts qui réagissent à notre action, mais c’est le système Terre dans son entier qui est affecté – et cela se mesure. En la matière, ce sont les calculs du « groupe de travail sur l’Anthropocène » dirigé par mon ami, le géologue Jan Zalasiewicz (3), qui font à mon sens toute la différence. Ces travaux sont fantastiques par les données qu’ils permettent d’accumuler, et montrent l’accélération très récente de notre empreinte terrestre. Ainsi, le fameux « jour du dépassement » était encore en décembre dans les années 1970, alors qu’il se situe en juillet en 2019. Saisir ce basculement tient du sens historique, et un historien doit comprendre qu’il existe là une différence générationnelle. Quand nous affirmions cela, à l’époque de Nous n’avons jamais été modernes (La Découverte, 1991), nous étions comme des zozos. Maintenant, le problème s’est renversé. Nous savons cela, mais nous nous demandons : « Qu’est-ce qu’on fait ? »
« Mon rôle est de dramatiser en disant que nous vivons, cinq siècles après son ouverture, la fin de la parenthèse moderne. »
Peut-on aujourd’hui dire que la modernité, c’est terminé ?
Oui, mais il n’y a que moi qui pense cela (rires). Je voudrais bien savoir combien de personnes ont un tel avis. Mon rôle est de dramatiser en disant que nous vivons, cinq siècles après son ouverture, la fin de la parenthèse moderne. Mais je crois que je ne fais qu’exprimer quelque chose qui est déjà dans les consciences.
Dans Où suis-je ?, vous montrez à quel point tout ce qui est évident ne l’est plus : Gaïa est partout mais insaisissable, le vivant est mouvant et la délimitation de nos corps elle-même semble nous échapper. Vous reprenez ainsi le terme d' « holobionte » (4) proposé par Lynn Margulis en lieu et place d’« individu ». Ce corps insaisissable, vous en parlez notamment dans cet essai à travers votre expérience de la maladie. En quoi cette épreuve physique et psychique a-t-elle joué un rôle dans votre philosophie ?
Je n’ai pas d’autre terrain philosophique que mon expérience vécue, mais ce que la maladie y ajoute est l’intensification de la sensation de métamorphose. Je ne pense pas que j’aurais choisi cette figure de Kafka sans le choc d’avoir subi une telle médicalisation. Plus généralement, trop peu de penseurs de l’intime s’intéressent à l’écologie et vice-versa, et c’est un problème. En 2020, le quotidien Le Monde a proposé deux séries d’articles sur ces sujets, l’une sur les « Penseurs du nouveau monde » consacrée à l’écologie et l’autre sur dix « Penseurs de l’intime »: aucun de ces derniers ne parle d’écologie, et aucun des premiers ne parle d’intime. Or, il faudrait que ces deux séries se rejoignent ! Dans Où suis-je ?, j’ai ainsi essayé de montrer que l’intime et le corps ont les mêmes problématiques que celles qui traversent actuellement l’anthropologie, avec cette nouvelle cosmologie induite par l’Anthropocène.
Votre essai laisse aussi l’impression que vous tentez de rapprocher Gaïa de la réalité concrète et en particulier de la philosophie autour du vivant – portée par Baptiste Morizot – actuellement en vogue, afin de démontrer la complétude de votre proposition philosophique…
Ma définition de Gaïa est un peu différente de celle de Baptiste Morizot. Elle m’intéresse par le fait que cette théorie a été produite par un chimiste et physiologique, le Britannique James Lovelock, et une microbiologiste, l’Américaine Lynn Margulis. L’oxygène qui plane au-dessus de ma tête m’intéresse tout autant que les microbes de Lynn Margulis ou les loups de Baptiste Morizot : le vivant ne s’arrête pas aux animaux. La théorie de Gaïa rappelle que, depuis toujours, personne n’a jamais fait l’expérience de choses inertes. L’action des vivants est partout, en centre-ville comme dans ma campagne de l’Allier. Je suis arrivé à l’écologie par la recherche sur la science et les techniques, pas par le naturalisme. Il est très important, pour sortir l’écologisme de certaines impasses, d’ajouter à notre pensée l’idée que nous sommes des vivants par l’ingénierie des vivants qui nous ont précédés – ingénierie à laquelle nous ajoutons la nôtre, humaine, tantôt positive et tantôt catastrophique. Cette approche permet d’établir des continuités là où l’on pense encore la question de l’écologie comme une discontinuité.
L’un de vos grands soucis est de trouver des modes de représentation politique de « la nature ». Depuis au moins Politiques de la nature (La Découverte, 1999), vous mettez en avant la figure du diplomate comme modèle de négociation permettant de faire dialoguer humains et autres qu’humains. Cette idée a notamment été mise en œuvre dans l’expérience du « Théâtre des négociations », menée avec 200 de vos étudiants à Sciences Po en mai 2015 au théâtre Nanterre-Amandiers. Cette simulation des débats de la COP21, organisée quelques mois avant le sommet international, visait à représenter les intérêts des non-humains – espèces en danger, océans, forêts… Mais les rivières et les lapins sont-ils aptes à entrer dans le théâtre de la politique humaine ? Notre époque n’exige-t-elle pas de réinventer aussi la forme de cette diplomatie ?
Ma vision politique de la nature dans les années 1990 était une version sociale-démocrate : maintenant, nous sommes entrés dans un conflit de mondes. Je reconnais que la notion de diplomatie est tendue car, depuis quatre ans avec Donald Trump et Greta Thunberg, ce n’est plus une dispute que l’on peut résoudre par la diplomatie, mais un conflit planétaire. La vision peut-être un peu naïve du Parlement des choses, avec la représentation des non-humains, était une approche probablement beaucoup trop optimiste de la situation. Reste qu’il faut bien trouver un moyen, et quelle que soit la vision – démocrate ou tragique – que nous essayons d’inventer, il faut simultanément accepter l’état de guerre et en même temps trouver des solutions qui évitent l’extermination. Je pensais le problème soluble, et il l’était encore dans les années 1990. Nous pensions alors pouvoir résoudre la question écologique, et moi-même j’imaginais qu’elle se réglerait comme celle de l’hygiène. Mais, à cette situation, s’est ajouté un déni de certaines élites qui ont rejeté le problème climatique. Ce négationnisme, qui a commencé dans les années 1980, a transformé une situation que la social-démocratie aurait pu résoudre en situation tragique.
Êtes-vous devenu pessimiste ?
Je ne suis pas pessimiste mais la situation est tragique, alors qu’avant elle n’était pas si difficile à résoudre que cela.
L’un de vos combats philosophiques porte contre l’emprise de ce que vous nommez « Économie », avec une majuscule, laquelle s’est arrogé le monopole de définir ce que doit être le monde. Vous évoquez parallèlement, dans Où suis-je ?, l’écologie comme « ce que devient l’Économie quand la description reprend ». En quoi la description, action qui semble ne pas être politique, aurait-elle des vertus pour transformer notre monde ?
Rien n’est plus compliqué que de connaître une situation, car nous vivons dans une matière vivante et façonnée par des vivants. Ceux-ci n’ont pas de limites, comme le souligne la notion d’« holobionte », et sont toujours plus nombreux qu’on croit à interagir. L’idée qu’il serait possible de réduire le nombre d’êtres à prendre en compte revient à se mettre un doigt dans l’œil. L’Économie est extraordinairement peu descriptive et fonctionne en simplifiant à l’extrême les individus, leurs intérêts, leurs relations. Cela permet de faire fonctionner des marchés, mais on s’aperçoit que le nombre d’acteurs permettant de comprendre les situations est beaucoup plus large. L’enquête par la description n’est pas à l’opposé de l’action mais, au contraire, constitue son vecteur nécessaire. Là où l’Économie voile la réalité et simplifie les situations, l’écologie interdit cette réduction de la complexité. La description et l’autodescription sont pour cette raison très difficiles car elles conduisent à prendre en compte la façon dont chacun est dépendant des interactions avec d’autres vivants pour exister. C’est ensuite, une fois la description établie, que la diplomatie est nécessaire pour trouver des marges de manœuvre et négocier.
En mars 2020, au début du confinement, vous proposiez à tout un chacun un questionnaire ludique visant à profiter de cette période pour réaliser un « inventaire » des activités nécessaires à notre société et celles, au contraire, qu’il serait bon d’arrêter. Mais les milliards d’euros pour sauver l’économie n’ont-ils pas montré que toutes les activités – même nocives – ne peuvent être arrêtées sous peine de créer des catastrophes sociales ?
Le but de cet article sur le site AOC était d’abord de nous occuper durant le confinement. Bien entendu, on ne peut pas imaginer de transformation facile d’une société industrielle, mais nous ne pouvions pas non plus imaginer qu’en mars la question de la continuité se poserait à toutes les échelles et pour tous les emplois. Ce questionnaire visait à envenimer la plaie, et j’ai quand même l’impression que le doute s’est désormais instillé dans l’argument jusqu’ici évident du « TINA » [« There is no alternative », selon la célèbre phrase de Margaret Thatcher, ndlr] : le nombre de choses indiscutables actuellement remises en question est colossal ! Il est évident qu’il s’est passé quelque chose, en particulier avec cette étonnante rémanence de la question du climat. Personne n’a osé dire : « On met de côté la question climatique à cause de la relance économique. » Si vous y réfléchissez, c’est extraordinaire. Il y a un sens inédit du mur dans notre confinement.
Sur le même site, un haut fonctionnaire répondait à votre questionnaire dans un texte critique. Il soulignait d’une part que « les éboueurs, postiers, agriculteurs, infirmier(e)s, paysans [seraient] peu nombreux à lire AOC et à répondre au questionnaire » et, de l’autre, que renvoyer chacun à ses préférences individuelles faisait courir le risque de laisser à une « autorité mystérieuse » le soin de choisir entre elles. Vos propositions n’omettent-elles pas l’irréductible conflictualité de la politique et, in fine, la réflexion nécessaire quant au pouvoir potentiellement inique de l’instance qui arbitrera entre les intérêts de chacun ?
Cet article part de l’hypothèse qu’il existe un État définissant la volonté générale et universelle sur ces questions, et que celle-ci différerait des délibérations individuelles : ce n’est pas vrai. Affirmer cela revient à soutenir que les cahiers de doléances, en 1789, n’étaient que des opinions individuelles. Or, c’était bel et bien une construction de la volonté générale. Ce réflexe de pensée est typique des hauts fonctionnaires, qui sentent pourtant qu’ils n’ont pas l’État qui correspond à la situation. Il existe seulement un État vaguement capable de défendre la volonté générale sur l’épidémie, mais pas d’État de l’écologie apte à prendre en compte autre chose que l’emploi si Amazon décide d’implanter un entrepôt dans une campagne. Personne au sein de l’État n’est là pour penser un État d’abondance dans les limites de l’accord de Paris sur le climat. C’est aussi l’illusion de Yannick Jadot de penser : « Si je suis élu président, j’occupe l’Élysée et j’ai les instruments pour faire une mutation écologique. » Mais il n’y a aucun instrument, c’est une illusion complète ! Aucun fonctionnaire ne connaît l’hypothèse Gaïa ! Notre État reste fondamentalement un État de la reconstruction de l’après-guerre et de la modernisation. Un État armé pour la mutation écologique ne peut pas exister car il faudrait d’abord que la société civile, dont il est l’émanation, ait pris en charge le problème par elle-même.
« Un Etat armé pour la mutation écologique ne peut pas exister car il faudrait d'abord que la société civile ait pris en charge le problème par elle-même. »
Plus largement, l’hypothèse Gaïa et la notion d’Anthropocène font l’objet de critiques récurrentes sur la façon dont elles considèrent une humanité uniformisée masquant les rapports de force sociaux, entre dominants et dominés, et historiques entre l’Occident et les régions du monde qui ont subi la colonisation et le pillage de leurs ressources – ce que pointe notamment Malcom Ferdinand dans son essai Une écologie décoloniale (Le Seuil, 2019). Comment penser Gaïa sans omettre ces fractures, afin que la notion d’Anthropocène ne soit pas un impérialisme de plus pour ceux qui ont fait les frais de la modernité ?
Je n’ai jamais compris cette critique. Rien dans l’Anthropocène n’est contraire à la pensée postcoloniale. Cette notion permet même de multiplier la critique de l’exploitation à toutes les échelles. Les classes géosociales renouvellent le regard pour penser la façon dont le prolétaire français exploite aussi bien des coquilles Saint‑Jacques que des enfants bangladais en achetant des vêtements en coton bon marché. Il y a un glissement, et les classes géosociales constituent la meilleure façon d’appréhender la question décoloniale – par exemple, le fait de consommer des produits de l’exploitation d’autres humains en Afrique ou en Asie. Se construit ainsi une relation de classe géosociale qui complique la situation du prolétaire français lorsqu’il va lutter contre son patron. Ce qui se passe actuellement, c’est une généralisation de la compréhension des injustices révélées – l’Anthropocène offre en cela une immense accélération des connaissances. Moi, je suis décolonial depuis cinquante ans et mon passage en Afrique [Bruno Latour a commencé à étudier l’anthropologie en Côte d’Ivoire au début des années 1970 et a traité, dans l’un de ses tout premiers articles scientifiques, des préjugés des cadres industriels blancs sur les présumées déficiences cognitives de leurs alter ego ivoiriens, ndlr] ! Mais, pour certains, il faut le dire en employant les paroles sacramentelles de la gauche : je ne les prononcerai pas. Ne pas voir que je pose la question des injustices, c’est rester dans l’impuissance qui est celle de la gauche depuis un demi-siècle.
« Ce que ne comprend pas la gauche qui veut repérer des camps à l'ancienne, c'est que la révolution a eu lieu et elle s'appelle l'Anthropocène. »
Justement, vous vous employez, depuis Où atterrir ?, à cartographier les lignes de clivage politique de l’Anthropocène. Dans cet essai, vous opposiez les « modernes », vivant dans l’illusion d’une société d’abondance éternelle, aux « terrestres », souhaitant retrouver un mode de vie compatible avec les réalités biologiques de la planète. Dans Où suis-je ?, vous introduisez une nouvelle opposition entre les « extracteurs », pillant toujours plus les ressources de la Terre, et les « ravaudeurs », qui cherchent au contraire à la réparer. En quoi ce nouveau clivage est-il fondamental ?
J’essaie de travailler sur ces classes géosociales en captant l’esprit du temps. Que se passe-t-il, par exemple, quand on entend la phrase d’Emmanuel Macron comparant les anti-5G aux Amish ? Pourquoi trouve-t-on cette phrase ridicule ? C’est ce décalage, qui n’aurait pas été ressenti comme tel il y a une décennie, qui m’intéresse et me permet de donner des noms pour qualifier l’époque. Ainsi, la notion d’« extracteur » résume l’argument postcolonial : le monde où l’on vit et celui dont on vit sont absolument différents. Ce que « ravaudeur » signale n’est pas une attitude révolutionnaire, mais une attitude qu’on résume en anglais par le « care » (« prendre soin »). Ce que ne comprend pas la gauche qui veut repérer des camps à l’ancienne – entre, grosso modo, capitalisme et anticapitalisme –, c’est que la révolution a eu lieu et elle s’appelle l’Anthropocène. Nous ne sommes plus devant une révolution à faire, mais devant une révolution déjà faite qu’on a pu qualifier de différentes manières, comme par exemple avec la notion de « Grande accélération » (5). Les catégories de la gauche ne sont plus adaptées à cette nouvelle situation. Le mot « ravauder » m’a, lui, paru embrasser des actions aussi différentes que celle des zadistes défendant des zones humides, de l’anthropologue Anna Tsing auscultant les zones de friction de notre monde ou de l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas) créant des « réserves de vie sauvage » dans la Drôme. Nous ne sommes plus à l’heure du changement de système appelant une action radicale et collective devant nous : cette action est derrière nous, et elle est la situation de non-action et de déni existant depuis les années 1980. Nous sommes donc aux prises avec une révolution qui a eu lieu et qu’il faut réparer, et la gauche n’a pas l’habitude de penser dans ces termes. Ceux de Tarnac, des ZAD ou Greta Thunberg, eux, ont déjà mis ces nouveaux affects politiques en pratique.
En même temps, l’Anthropocène n’induit-il pas un rapport au temps contradictoire, entre l’urgence de l’action politique et la lenteur – à l’échelle humaine – des processus du vivant ?
La tragédie est là. Il n’y a aucune solution à ce problème, alors qu’une partie de l’avenir climatique est dans une certaine mesure déjà joué. Nous sommes contraints de prendre des décisions à l’échelle d’élections pour gérer l’accélération du temps de la planète elle-même. Ce qui était autrefois une accélération de l’histoire est devenu une accélération de l’histoire géologique – ou de la géohistoire. Notre seul problème de ce type, jusqu’ici, avait été les déchets nucléaires, mais ce sujet n’a aucune commune mesure avec l’actuel, qui est la réaction du système Terre à nos actions. Pour cela, une métaphore aussi puissante que celle de La Métamorphose de Kafka se justifie, avec la rupture générationnelle qu’elle pointe entre Gregor Samsa et ses parents, et qui est celle que nous vivons. Alors que les parents de Gregor y voient un problème comme un autre, lui sait qu’il a affaire à une situation radicalement nouvelle. Mon effort est de refuser de simplifier cette question en la neutralisant : oui, notre situation est tragique.
Dans son dernier livre, Chronos. L’Occident aux prises avec le Temps (Gallimard, 2020), l’historien François Hartog évoque votre pensée– sur laquelle il s’appuie pour réfléchir au temps de l’Anthropocène – comme celle d’un « apocalypticien conséquent ». En quoi votre intérêt pour la théologie chrétienne, qui constitue une partie moins connue de votre œuvre, influence-t-elle votre rapport au temps de Gaïa ?
L’ignorance de la sphère intellectuelle française sur la question religieuse et la notion d’apocalypse me conduit à préférer ne pas évoquer ces sujets rapidement. Je veux toutefois souligner l’importance de l’encyclique du pape François sur l’écologie, Laudato Si’ (2015), qui associe le cri de la Terre au cri des pauvres. Aucun marxiste n’aurait eu le culot de relier ces deux réalités dans une même pensée. Cette injonction prophétique du pape mérite d’être creusée.
Emanuele Coccia, Vinciane Despret, Baptiste Morizot, Nastassja Martin, Pierre Charbonnier… Une nouvelle scène de la pensée française en écologie a émergé ces dernières années en se réclamant, plus ou moins directement, de votre pensée. Alors que paraît, avec Le Cri de Gaïa, un livre collectif autour de votre œuvre, quel regard portez-vous sur cette nouvelle génération dont vous apparaissez comme l’autorité tutélaire ?
J’ai longtemps eu l’impression d’écrire des choses que personne ne comprenait. À présent, nous sommes une bande et, quand on est vieux, c’est sympa d’avoir des collègues. J’ai désespéré de la politique, de l’État, de la gauche, et voilà que, brusquement, une nouvelle conjonction très puissante se réalise entre ces travaux académiques et les problèmes de notre société : les conditions actuelles permettent de reconstruire la politique à partir de sa base. Mais j’ai simplement des amis, et le rôle d’« animateur » me va bien.
Lequel de ces penseurs est votre meilleur héritier ?
Émilie Hache a offert le plus juste résumé en disant : « Nous sommes tous en train d’écrire le même livre. » On essaie tous de trouver un vocabulaire, de cerner des affects. L’ampleur de la tâche est la même que celle du XVIᵉ siècle : en découvrant une nouvelle Terre, il a fallu tout changer. Au XXIe siècle, nous découvrons aussi une nouvelle Terre, et il nous faut à notre tour tout changer. Ce travail immense est actuellement accompli par des philosophes, des scientifiques, des artistes, des citoyens. Malgré la crise que nous vivons, j’observe un niveau de sérieux et une qualité dans ces travaux qui sont tout à fait nouveaux... et enthousiasmants.
Notes
(1) Zone critique : couche externe de la Terre où sont réunies les conditions d’habitabilité du vivant.
(2) Gaïa : nom donné à une hypothèse scientifique initialement formulée en 1970 par James Lovelock et Lynn Margulis désignant l’ensemble des vivants et les interactions par lesquelles ils créent, tel un vaste organisme, des conditions propices à la perpétuation de la vie.
(3) Les travaux de ce groupe de travail de la Commission internationale de stratigraphie (ICS) de l’Union internationale des sciences géologiques (IUGS) visent à déterminer si l’anthropocène constitue une nouvelle époque géologique succédant à l’holocène.
(4) Holobionte : nous ne vivrions pas sans les milliers de microbes (bactéries, levures…) composant nos microbiotes – intestinal, mais aussi cutané, buccal ou vaginal. Holobionte (du grec holos, le « tout », et bios, la « vie ») désigne cet ensemble formé par le macro-organisme qu’est un individu et tous ces êtres vivants minuscules qui le composent.
(5) Grande accélération : appellation donnée à la période débutant par la reconstruction de l’après-Seconde Guerre mondiale et correspondant à une pression humaine d’une intensité inédite sur l’environnement.
Livres

Où suis-je ? Leçons du confinement à l’usage des terrestres, La Découverte, 2021.
Conçu comme une « métaphysique du déconfinement », le dernier livre de Bruno Latour utilise l’expérience du Covid-19 comme une métaphore de notre grand confinement sur Gaïa, et poursuit son travail de cartographie politique entamé dans Où atterrir ? afin de cerner les clivages autour de l’habitabilité de la Terre.

Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, La Découverte, 2017.
Convaincu que la question climatique est la boussole pour comprendre les enjeux politiques de notre temps, Bruno Latour analyse à travers ce prisme l’élection de Donald Trump en 2016 et la crise des migrants, et tente, au-delà, de cartographier les nouveaux clivages fondamentaux.
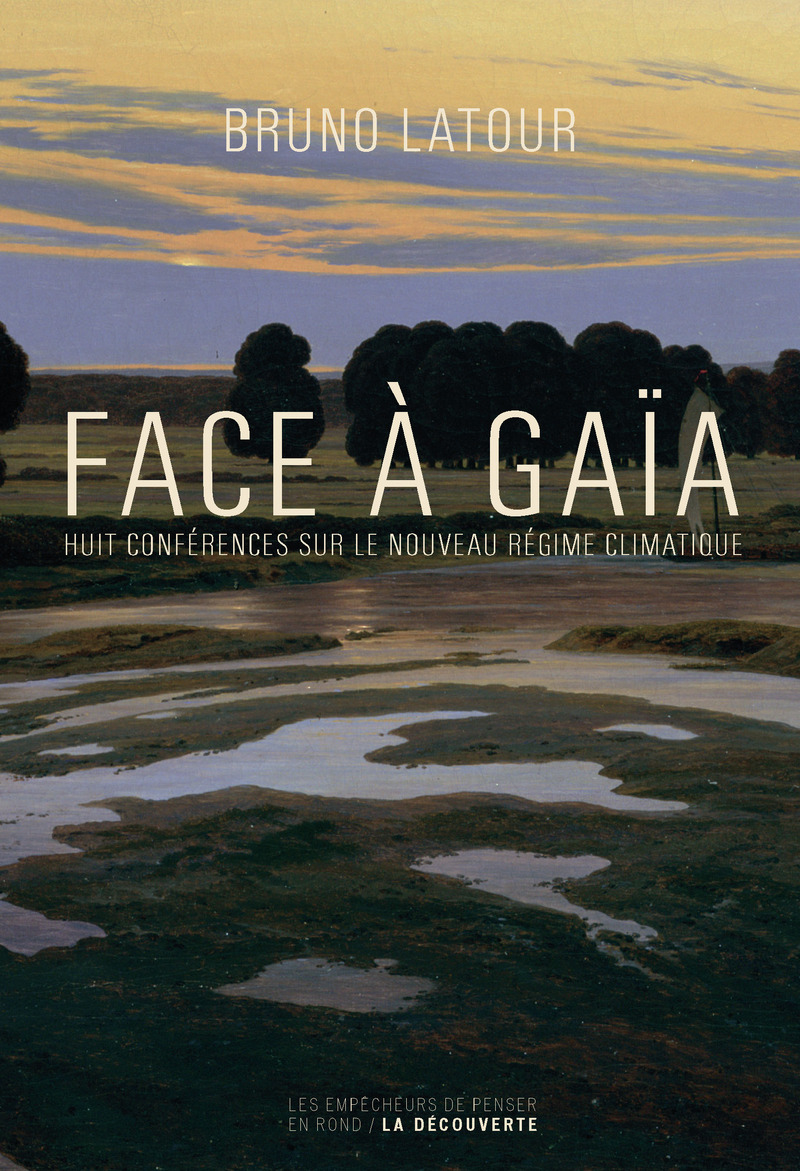
Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique, La Découverte, 2015.
Cette œuvre maîtresse de la pensée écologique de Bruno Latour développe les implications philosophiques de ce qu’il nomme « nouveau régime climatique », soit l’interaction nouvelle entre l’histoire humaine et celle de la Terre – ou « géohistoire » – au cœur de l’Anthropocène.
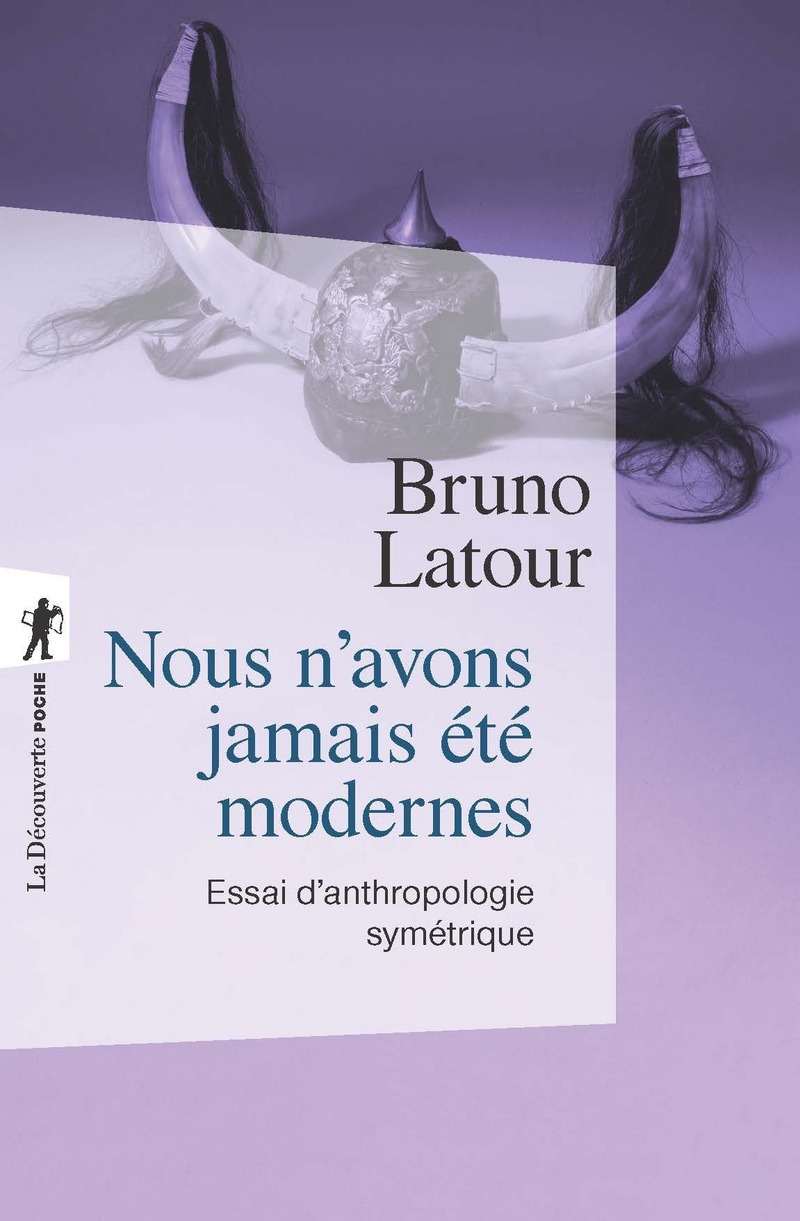
Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, La Découverte, 1991.
Bruno Latour s’en prend à la grande séparation opérée par la modernité entre ce qui relève de la nature d’un côté et de la société de l’autre, montrant que cette distinction « officielle » bute sur certains hybrides dépendant des deux régimes et que seule une « anthropologie symétrique » pourra lever ces contradictions.

Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie, La Découverte, 1999.
La modernité a laissé les choses de la nature aux scientifiques et le sort des choses humaines à la politique. C’est à ce partage auquel Bruno Latour s’attaque ici en tentant de trouver les modalités concrètes pour réintégrer la « nature » et les sciences dans le champ de la délibération commune.

Le Cri de Gaïa. Penser la Terre avec Bruno Latour, sous la direction de Frédérique Aït‑Touati et Emanuele Coccia La Découverte, 2021.
Construit autour de l’œuvre de Bruno Latour et en particulier de Face à Gaïa, cet ouvrage collectif réunit les réflexions de 10 intellectuels, parmi lesquels Vinciane Despret, Baptiste Morizot, Nastassja Martin ou encore Sébastien Dutreuil.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don