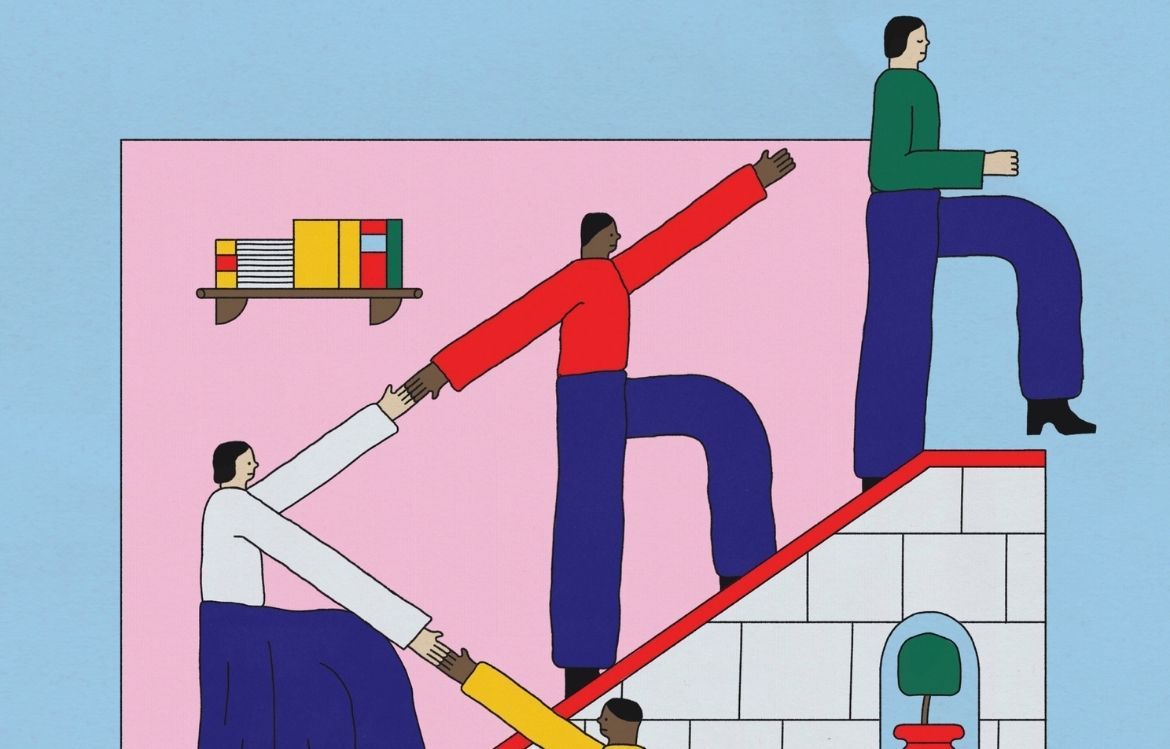Depuis la Révolution française au moins, le progrès occupe une place considérable dans l’imaginaire collectif. Il est à la fois l’objet de tous les fantasmes et de toutes les angoisses. Certains font de lui la boussole de leurs actions, d’autres estiment que c’est un piège qui précipite l’homme dans des eaux troubles et inconnues. Si le progrès s’est d’abord constitué à partir d’une doctrine claire et délimitée, sa définition semble aujourd’hui plus extensive, voire floue.
Par les temps qui courent, que ne fait-on pas dire à la notion de progrès ? En son nom, certains sont prêts à tout sacrifier, même la raison. D’autres, en revanche, fondent leur rejet du progrès sur des approximations et l’assimilent trop rapidement au libéralisme. Rappelons d’abord que, historiquement, le progrès n’est pas ce fourre-tout idéologique, ce catalyseur qui permet de justifier à peu près tous les comportements, qu’on agisse en sa faveur ou contre lui.
Article issu de notre hors-série Renouer avec le vivant, sous la rédaction en chef de l'écrivain Baptiste Morizot. Disponible sur notre boutique.

Le destin de la notion de progrès est lié à celui de la modernité. Avant l’avènement de ce que les historiens ont coutume d’appeler les « temps modernes », les hommes n’avaient pas le regard tourné vers l’avenir mais vers le passé. Le présent n’était pas surdéterminé par demain mais par hier. Les ancêtres et la tradition étaient les garants de la marche du monde. Le bonheur et l’épanouissement de l’homme ne résidaient à aucun moment dans l’idée ou la projection vers un avenir radieux.
C’est la modernité qui va forger cette nouvelle téléologie et proclamer l’idée d’un sens de l’Histoire. La notion de progrès peut se résumer, de manière condensée, par l’idée que demain sera meilleur qu’aujourd’hui. Or, cette approche implique nécessairement une forme de sécularisation des esprits car une société – en l’occurrence le monde chrétien – qui croit dans la Providence, c’est-à-dire que l’enchaînement des événements est toujours conforme au dessein divin, ne peut croire au progrès. On ne peut croire en même temps que ce sont Dieu et l’homme qui déterminent l’histoire, il faut prendre parti. Les tenants de l’idée de progrès, eux, ont choisi : ils affirment que ce n’est plus Dieu mais l’homme.
Un renversement radical
L’émergence de la notion de progrès implique donc une sécularisation mais aussi une individualisation des esprits. La Réforme protestante a joué un rôle décisif dans la constitution de que nous appelons désormais « l’individu ». Si le terme paraît tout à fait banal aujourd’hui – qui n’est pas individualiste ? – il ne va pas de soi au XVIe siècle, où les sociétés sont encore radicalement holistes, c’est-à-dire qu’elles considèrent que le tout prime sur les parties.
Il y a dans la démarche de Luther, notamment dans l’encouragement à la pratique du libre examen, quelque chose de profondément révolutionnaire. En proposant la première traduction de la Bible en langue allemande, le réformateur estime que tout homme doit avoir accès librement aux textes sacrés, sans recourir à la médiation d’un clerc qui connaît le latin. Cette nouvelle approche – qui préfigure la démarche de la philosophie des Lumières – sera vivement attaquée par les penseurs contre-révolutionnaires comme Joseph de Maistre et Louis de Bonald, qui voient dans la pratique du libre examen et dans l’essor de la « raison individuelle » une attaque contre l’ordre divin.
Ce sont donc ces deux tendances – la sécularisation et l’individualisation des esprits – qui vont permettre les premières formulations explicites de l’idée de progrès. C’est avec l’instauration des sciences mathématiques, des sciences naturelles et de la philosophie moderne que le grand tournant va être opéré. Car le progrès désigne d’abord celui de la science. Galilée, avec son Dialogue sur les deux grands systèmes du monde (1632), Bacon, avec son Novum Organum (1620), puis Descartes, avec son Discours de la méthode (1637), vont révolutionner de fond en comble la vision du monde qui est encore celle de l’homme du Moyen âge, bien que Copernic ait déjà montré la voie au siècle précédent.
Pour ces trois philosophes et scientifiques considérables, le monde doit pouvoir entièrement être expliqué par des lois mathématiques et géométriques. La rationalité, qui avait déjà permis aux Anciens de faire des découvertes significatives, va se transformer en rationalisme. L’individu, auquel Descartes va donner un cadre philosophique avec son cogito, est avant toute chose un être doué de raison. Une raison qui n’est pas l’humble logos des Grecs, c’est-à-dire une faculté consciente de ses propres limites, mais un instrument nouveau qui ambitionne de comprendre le monde dans sa totalité et de garantir le développement infini de la science. Descartes allant jusqu’à formuler dans Le Discours de la méthode l’idée d’un homme « maître et possesseur de la nature ».
C’est un renversement radical : l’homme n’est plus la victime passive des grandes forces telluriques, il n’est plus non plus, comme chez les Grecs, le jouet des dieux. Les grandes représentations du monde chrétien sont aussi ébranlées : la Terre n’est plus le centre de l’univers, l’histoire n’est plus la réalisation d’un dessein divin, mais devient une production de l’homme lui-même. Tout n’est plus déjà écrit, à la créature de changer le cours des choses.
La résistance romantique
Si l’idée de progrès participe d’abord d’une révolution scientifique et philosophique, elle va ensuite être impliquée dans une révolution éthique et politique. Car c’est bien sur un projet d’émancipation de l’homme par la raison que va s’appuyer l’idéal des Lumières, que ce soit en France ou en Allemagne. Pour les encyclopédistes, il est nécessaire que l’homme accède à un certain niveau de connaissances, qu’il sorte de l’obscurantisme et de la superstition, pour fonder sa volonté politique. Car seul un homme éclairé peut devenir un véritable citoyen. Les Lumières encouragent la tolérance contre le despotisme de la religion et de l’État.
En Allemagne, Kant, dans Qu’est-ce que les Lumières ? (1784), écrit cette formule célèbre qui prend la forme d’un impératif : « Sapere aude ! », littéralement « Ose savoir ! », c’est-à-dire « Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! » C’est cet idéal que l’on considère comme à l’origine de la Révolution française, événement d’une importance telle que Kant, à son annonce, interrompit pour la seconde fois de sa vie sa promenade quotidienne. La première fois, dit-on, ce fut pour terminer l’Émile (1762) de Rousseau.
Ce dernier occupe d’ailleurs une position à la fois très importante et ambiguë vis-à-vis de la notion de progrès. Il est le penseur du contrat social, de l’égalité et du progrès civique, mais en aucun cas il ne doit être considéré comme un défenseur du progrès de la science, du progrès de la raison et de la technique. Au contraire, Rousseau estime qu’il faut se défaire de la croyance naïve qui identifie progrès social et progrès intellectuel. Dans son Émile, il écrit : « Il n’y a point de vrai progrès de la raison dans l’espèce humaine parce que tout ce qu’on gagne d’un côté on le perd de l’autre. » Annonciateur de la réaction romantique, Rousseau se méfie des prétentions de la civilisation et fait l’apologie de l’état de nature avec son « bon sauvage ».
Paradoxalement, c’est Rousseau, celui qui était le plus disposé à idéaliser la nature humaine, qui a compris le premier que l’homme pouvait faire un usage dangereux de sa raison. À l’engouement pour la science et la technique, qui sont la marque du début du XVIIIe siècle, va se succéder un sentiment de défiance et une première remise en question de ce que l’on peut désormais nommer l’idéologie du progrès. À la radicalisation hégélienne de l’idée de progrès portée par les Lumières – « Tout le réel est rationnel, tout le rationnel est réel » – va se succéder le romantisme, mouvement philosophique et littéraire qui entend valoriser à nouveau le lien que l’homme entretient avec la nature. Si le XIXe siècle est celui du romantisme, des poètes maudits, du « fanal obscur » de Baudelaire – expression qui condense son hostilité au progrès – c’est aussi celui de la révolution industrielle, et donc de la mise en pratique des idéaux rationalistes et technicistes du siècle précédent.
Le progrès ? Quel progrès ?
Le monde occidental va se transformer comme jamais auparavant. La machine à vapeur de James Watt va modifier radicalement le rapport que l’homme entretient avec le temps et l’espace, facilitant grandement la mobilité et quadrillant les territoires de son chemin de fer. Frederick Winslow Taylor va « rationaliser » et « optimiser » le rendement des ouvriers grâce au développement du travail à la chaîne. Ce monde nouveau, qui fait l’apologie de la vitesse et de l’efficacité, qui accorde désormais une place considérable à l’économie, a quelque chose de grisant : tout semble désormais possible. On peut maintenant réaliser en une vie ce que l’on n’aurait pas même imaginé faisable en plusieurs siècles.
La bourgeoisie, c’est-à-dire les détenteurs du capital et des moyens de production, s’épanouit ; le peuple est au travail et la démocratie libérale s’est imposée dans la plupart des pays dits « civilisés ». Pourtant, un sentiment de malaise grandit et l’intuition de Rousseau se confirme peu à peu : il y a bien une différence – une conciliation impossible ? – entre le progrès de la science et le progrès social. Cette inquiétude va se traduire d’abord par les écrits des penseurs du socialisme utopique héritiers de Saint-Simon comme Charles Fourier ou Pierre-Joseph Proudhon, qui vont tenter de proposer une alternative à la société industrielle, en revalorisant le progrès social contre le progrès de la science. Redistribution, réorganisation du travail, réflexion sur la vie communautaire seront les piliers pour lutter contre l’injustice et l’aliénation dont sont victimes ceux qui ne font pas partie de la classe bourgeoise.
La critique de l’aliénation par le travail sera au cœur de la réflexion de Karl Marx, qui emboîtera le pas aux socialistes qui l’ont précédé tout en s’en distinguant par l’originalité de ses vues. À ses yeux, il faut abolir le capitalisme, la division du travail et mettre un terme à la lutte des classes afin d’aboutir à la dictature du prolétariat, phase transitoire dans laquelle celui-ci disparaîtra en s’universalisant. Pour Marx, le progrès social n’a un sens que s’il épouse les traits de la révolution. On comprend qu’une dialectique du progrès s’est mise en place : le progrès de la raison entraîne à la fois le progrès de la science et l’exigence d’un progrès social. Mais, comme l’avait pressenti Rousseau, l’un joue souvent contre l’autre. Le progrès technique aboutissant au XIXe siècle à l’aliénation par le travail et, en réaction à celui-ci, à une nouvelle exigence d’émancipation.
Le jugement de la postérité
Mais c’est au XXe siècle que le progrès va prendre la forme la plus mortifère. Les deux totalitarismes (soviétique et nazi) – selon la définition restreinte donnée par Hannah Arendt – sont, dans leur organisation même, intimement liés à la notion de progrès. D’une part, le progrès scientifique et technique va trouver son expression la plus radicale et la plus effrayante dans le développement de la guerre moderne : le gaz moutarde utilisé pendant la Première Guerre mondiale, la destruction par l’arme atomique des villes d’Hiroshima et de Nagasaki, la découverte des camps d’extermination à la Libération... D’autre part, le progrès social va souffrir d’un désaveu terrible avec les planifications soviétiques et chinoises, avec le contrôle de la liberté d’expression et la généralisation des camps de travail. Frappés de sidération, nous avons compris que ce qui devait au départ être un instrument d’émancipation au service de la raison pouvait devenir un instrument de mort au service de la folie.
Le progrès a beaucoup souffert des tourments du XXe siècle. Il semblerait néanmoins que nos sociétés aient la mémoire courte. Car si le mot est employé aujourd’hui avec prudence, il n’a pas tardé à être remplacé par une autre notion : le changement. Celui-ci a le mérite d’être moins chargé idéologiquement. Loin des racines philosophiques du progrès, le changement ne désigne plus rien dans l’absolu si ce n’est la volonté formelle que les choses changent, sans se soucier véritablement du contenu de ce changement. Paradoxalement, si la doctrine du changement paraît moins structurée que celle du progrès, sa marche en avant fait l’objet d’un consensus politique presque total.
La volonté d’un développement infini de la croissance dans un monde fini, malgré les problèmes écologiques, socioéconomiques et philosophiques (pour ne pas dire logiques) que cela entraîne, n’est jamais remise en question et ceux qui s’y opposent, peu importe leurs convictions politiques profondes, sont perçus comme des « passéistes », des « conservateurs » ou des « réactionnaires ». Le changement désigne aujourd’hui une pensée magique intégralement linéaire, incapable d’inflexions dialectiques et soumise à des impératifs économiques. Le mantra est toujours le même : demain sera nécessairement meilleur qu’hier, bien qu’un simple regard dépassionné sur l’état du monde suffise à comprendre que nous faisons fausse route. Peut-être faudrait-il accepter de ralentir et oser regarder dans le rétroviseur ?
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don