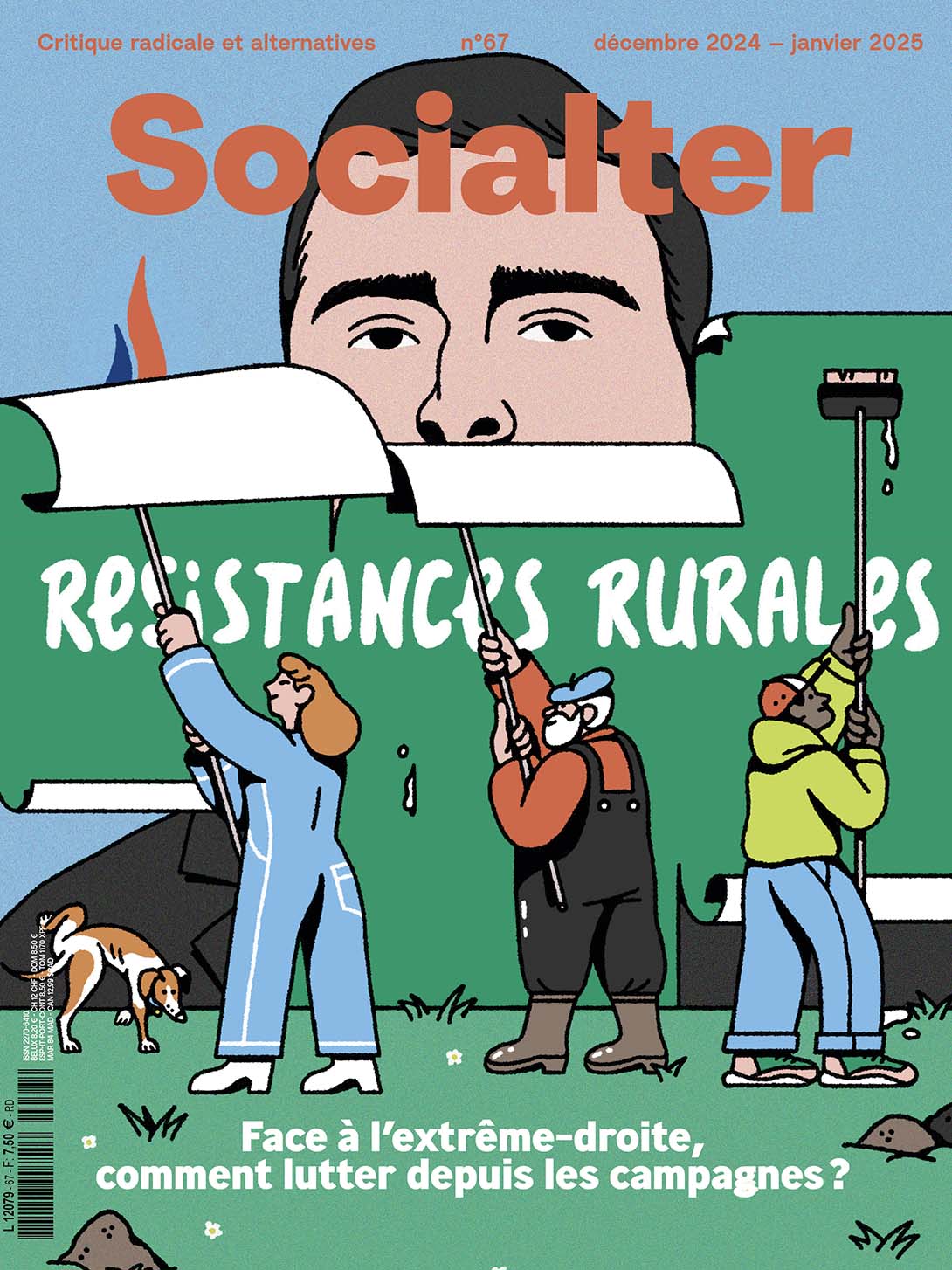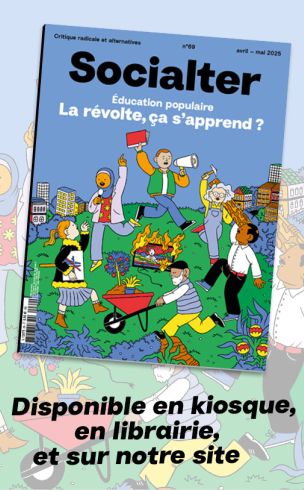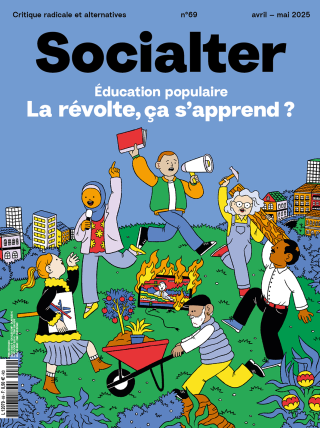«Un petit peu alternatif, mais pas trop (…) dans l’idée que chacun y trouve sa place. » Voilà comment se décrit le Tremargad Kafé, café associatif de Trémargat (Côtes-d’Armor) sur son site Internet. Quand on passe la porte, on réalise rapidement que le cahier des charges n’est pas tout à fait respecté. Enfilade d’affiches militantes, brochures contre la répression, stickers réclamant la fin du capitalisme ou du patriarcat… Au zinc, des bonnets colorés, des barbes drues et des pulls effilochés.
Article issu de notre n°67 « Résistances rurales », disponible en librairies et sur notre boutique.
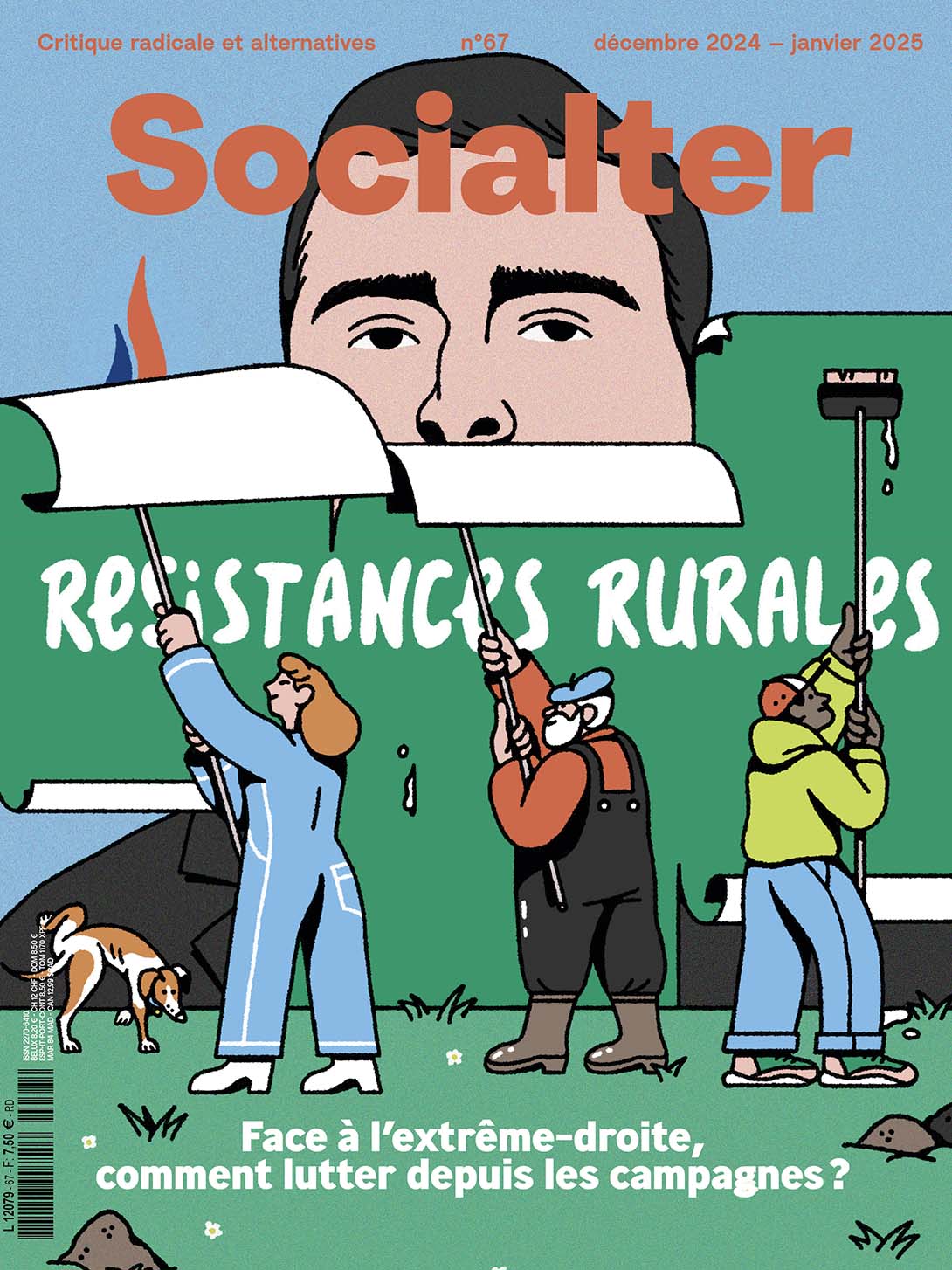
Le café, à l’image de la commune, fait figure de bastion écolo-socialiste. Depuis plusieurs décennies et à chaque élection, le village place en tête des partis verts ou roses. Au second tour des législatives 2024, la candidate NFP y a récolté 89 % des suffrages, contre 55 % à l’échelle de la circonscription.
Pour Matthieu, membre de La Pépie, l’association qui gère le café associatif depuis 2008, cette curiosité électorale s’explique simplement : « La population actuelle de Trémargat est composée d’une majorité de néoruraux. Ça a commencé avec “les pionniers”, quatre ou cinq couples qui se sont installés dans les années 1970 et qui avaient déjà une vision “agro-écologique”. » Depuis, les terres de ce coin de campagne alors dépeuplé, abordables car vallonnées et peu fertiles, ont attiré un flot continu de nouveaux prétendants à la vie rurale.
Au comptoir, les mêmes histoires reviennent : celles de gens arrivés il y a quelques mois, quelques années ou quelques décennies pour monter un écolieu, une petite ferme où « vivre une vie plus proche de la nature ». « Le Tremargad kafé, c’est un organe essentiel de la vie du village, défend Matthieu. Il permet aux gens qui arrivent de rencontrer du monde et de s’intégrer. C’est une pépinière. Beaucoup d’idées partent d’ici comme “Épice et tout” [l’épicerie associative attenante au café, NDLR] par exemple. »

Bar du Champ commun à Augan.
Derrière le bar, Delphine, l’une des salariées de l’association, ne partage pas son enthousiasme. Cette enfant du pays a appris à jouer du piano dans ce bistrot, à l’époque où la mairie ne l’avait pas encore racheté et confié à La Pépie pour éviter sa fermeture. Elle qui défend l’utilité sociale des cafés de village déplore le fait que le Tremargad Kafé soit devenu sans le vouloir la chasse gardée d’une partie de la population. « Il y a des personnes du village qu’on ne voit jamais », regrette-t-elle.
Conflits politiques ? « Les affiches, les stickers, ça fait fuir une certaine partie des gens du bourg », avance François Salliou, maire de Trémargat. « Conflits personnels », complète Agnès, une conseillère municipale, qui rappelle que « les villages alternatifs ne sont pas immunisés contre les rancœurs ».
Des gens un peu différents
À 115 kilomètres de là, direction sud-est, à Augan, dans le Morbihan, une dizaine de personnes jouent aux fléchettes et discutent au comptoir de l’Estaminet. Comme à Trémargat, ce café-concert aux allures de pub propose un espace de sociabilité tous les soirs de la semaine sauf le lundi mais ici, pas de trace d’affiches ni de stickers militants. Il a été créé en 2010 par les membres de la coopérative Le Champ commun, qui entend démontrer qu’une autre économie fondée sur l’égalité salariale et la participation citoyenne est possible et que la dévitalisation des bourgs ruraux n’est pas une fatalité.
« Quand les gens parlent de Grand remplacement ici, ils ne parlent pas de Noirs et d’Arabes, ils parlent de nous, les classes moyennes qui font monter le prix des loyers. »
En quinze ans, la mobilisation des 240 associés et des quatorze salariés a permis d’ouvrir à Augan, en plus de l’Estaminet, un restaurant, une brasserie, une auberge, une épicerie, un relais postal et un centre de formation à l’économie sociale et solidaire (ESS). Une petite révolution dans ce bourg de 1 500 habitants. Les rares personnes rencontrées dans la rue en ce froid matin de novembre et les quatre amies attablées autour d’un café au Ptit bar, l’autre établissement d’Augan, sont unanimes : Le Champ commun est une chance pour le village, bien que la plupart ne le fréquentent qu’occasionnellement.
Adrien, responsable de l’auberge du Champ commun, explique que la coopérative est devenue une référence à l’échelle nationale dans le monde de l’ESS mais que, paradoxalement, elle peine à faire l’unanimité localement. Malgré les efforts faits pour éviter l’entre-soi, les membres de la coopérative ont forgé le lieu à leur image et certains Auganais ne se sentent pas à l’aise. Si des produits premier prix comme le taboulé Belle France à 1,30 euro jouxtent des galettes de tofu bio à 4,60 euros, l’esthétique de la boutique, avec ses présentoirs « bien-être », ses luminaires en bois, et sa tête de gondole dédiée aux tisanes artisanales, est plus proche du magasin bio que de la supérette.
Revitalisation VS Grand remplacement
Le Champ commun n’a pas simplement ouvert des commerces, il a contribué à attirer à Augan un nouveau type de personnes : salariés et usagers venus pour « expérimenter une autre façon de faire société ». Auganais fraîchement débarqués et habitants de longue date de ce bassin de population décrit comme pauvre, vieillissant et principalement composé d’ouvriers et d’employés1 peinent encore à se mélanger. Les premiers apportent leurs codes souvent citadins, leur capital culturel, leurs valeurs et souvent leurs moyens financiers.
Les seconds, souvent précarisés, se sentent exclus de cette nouvelle société qui se construit à leur porte. Mathieu, un des fondateurs du Champ commun, est bien conscient de l’ornière dans laquelle leur projet s’enfonce : « Quand les gens parlent de Grand remplacement ici, ils ne parlent pas de Noirs et d’Arabes, ils parlent de nous : les classes moyennes qui font monter le prix des loyers et qui font que leurs enfants ne peuvent plus vivre au pays », constate-t-il.

Clients du Tremargad Kafé.
Plusieurs rumeurs concernant la coopérative sont revenues aux oreilles des membres. Ils seraient drogués, gavés de subventions et responsables d’une action de L214 (association de défense des animaux) dans une ferme des environs. La défiance générée par leur arrivée emprunte parfois des chemins étonnants pour s’exprimer.
Au comptoir du Ptit bar, René (prénom modifié) raconte ne plus fréquenter le Champ commun car il a dû expliquer au serveur de l’Estaminet ce qu’était une môminette, une demi-dose de pastis diluée dans de l’eau, boisson qu’il a découverte à Marseille. « Ils ne savent pas bosser ces gens-là, j’ai autre chose à faire que de leur apprendre leur métier », tranche-t-il, définitif. Mais imperceptiblement, des lignes bougent. Suite aux confinements, l’entreprise a connu des difficultés financières. À cette occasion, le club de foot a fait un cadeau de 70 euros. « C’est symbolique mais c’est le soutien qui m’a le plus touché, témoigne Adrien. Ils m’ont dit : “on ne veut pas que le Champ Commun ferme”. »
« Les résultats locaux suivent la tendance nationale. Pourtant ça fait quinze ans qu’on existe. C’est pas anecdotique quinze ans. Quand j’y pense, ça me désole. »
À Trémargat, la question de la cohabitation entre les mondes se fait moins pressante tant les alternatifs sont devenus majoritaires. Mais la poussée brune de 2024 fera peut-être bouger les lignes. Au moment des élections, des tags hostiles ont fleuri sur les panneaux de signalisation de la commune, rappelant au village écolo qu’il existait un monde en dehors de celui qu’ils et elles construisent et que ce monde-là ne leur est pas favorable.
À cette période, pour beaucoup, le bar a été un refuge. « On a projeté la soirée électorale au café, il y avait du monde car les gens avaient peur. On a pensé aux réactions possibles au cas où des fachos arriveraient avec des battes de base-ball. On envisageait le pire. Qu’est-ce qui se passe s’ils viennent ? Comment on réagit ? » Mais la crainte a cédé la place au soulagement quand les résultats sont tombés et les réflexions ne se sont pas poursuivies, au grand désarroi de quelques habitants du village qui alertent sur le fait que le répit n’est que temporaire et qu’il faudrait déjà préparer la suite.
Prendre position ?
Mais les lieux alternatifs peuvent-ils quelque chose contre la progression du RN en zone rurale ? Sylvain Dumas en est persuadé. Codirecteur général de Villages Vivants, il a fait de la revitalisation des bourgs ruraux son cheval de bataille. Cette coopérative récolte de l’épargne citoyenne pour financer l’achat de locaux qu’elle loue ensuite à des entreprises de l’ESS en zone rurale. Il pense qu’en recréant des espaces de convivialité et en luttant contre le sentiment de déclassement, ces initiatives peuvent contribuer à faire barrage à la progression du RN. Pour étayer cette intuition, il cite une étude2 qui montre la corrélation « entre les scores du RN et la présence ou l’absence de commerces, de services publics et de vie associative ».

Le Tremargad Kafé à Trémargat.
À l’exposé de cette hypothèse, le visage d’Adrien s’assombrit. « Ça n’a manifestement pas marché ici. Les résultats locaux suivent la tendance nationale. Pourtant ça fait quinze ans qu’on existe. C’est pas anecdotique quinze ans. Quand j’y pense, ça me désole. » À Augan, le RN est en effet arrivé largement en tête aux européennes et a raflé 37 % des suffrages au deuxième tour des législatives. Alors que le parti d’extrême droite était aux portes du pouvoir, il n’y a eu ni réaction ni discussion collective sur le sujet au sein de la coopérative car, selon Adrien, la bataille permanente pour la rentabilité économique ne leur en a pas laissé le loisir.
Mathieu, lui, pense que le problème est plus profond : « On touche là à une des limites de notre modèle. On est 240 associés qui se sont réunis autour de l’idée de maintenir le commerce de proximité en milieu rural, ce qui est une idée plutôt de droite à la base. Mais si on l’avait présentée comme une lutte plus radicale contre la grande distribution, on aurait été cinq. Ça fait que face à un sujet trop clivant, on ne peut pas prendre position en tant qu’entreprise. » Mathieu souhaite cependant que le lieu continue à être une « base arrière » pour les luttes comme elle a pu l’être pendant le mouvement des Gilets jaunes ou, plus récemment, contre la réforme des retraites.
À cette occasion, la coopérative avait pris position en garantissant la continuité des salaires aux employés grévistes et en le revendiquant auprès de sa clientèle. Le Champ commun organise également chaque mois des discussions sur des sujets qui touchent le territoire : déserts médicaux, pesticides, construction d’une cantine scolaire municipale. Mais ni à Augan, ni à Trémargat, la question du racisme, pourtant un des moteurs principaux du vote RN, n’est sérieusement traitée.

Sivan à droite, 19 ans a effectué son stage à l’épicerie du Champ commun, ici avec son cousin Esteban.
« Jusqu’où doit-on jouer le jeu de l’habiter ensemble ? » se demande Mathieu du Champ commun. Jusqu’à cet été, l’auberge de Boffres, une coopérative soutenue par Villages Vivants, et qui s’est installée dans le village ardéchois de Boffres – 600 habitants – en 2019, n’avait jamais pris position politiquement. « Mais là, les résultats des élections européennes nous ont mis une claque [le RN est arrivé premier avec 30 % des voix, NDLR]. C’est parti d’un coup de sang. On ne voulait pas entendre des discours racistes chez nous », raconte Antoine, un des associés. L’équipe a alors décidé de placarder des affiches3 ostensiblement antifascistes sur et dans l’auberge. « Ça a permis des discussions, on s’est parfois autorisés à remettre des gens en place et on a réalisé qu’ils nous aimaient bien malgré ça », raconte Thomas, un autre associé.
À Trémargat, à Augan ou à Boffres, qu’ils se positionnent ou pas publiquement, ces collectifs sont d’emblée étiquetés comme gauchistes ou écolos. Partant de là, Flo, salarié de La Pépie, invite donc à assumer d’avoir un nez au milieu de la figure plutôt que de chercher vainement à le cacher : « C’est compliqué de vouloir plaire à tout le monde et de porter des valeurs un peu radicales. On va pas faire semblant d’aimer les OGM juste pour que des adhérents de la FNSEA puissent être à l’aise ici. »
1.Rapport de présentation - Diagnostic, Scot Pays de Ploërmel, 2018.
2. « L’influence de l’isolement et de l’absence de services et commerces de proximité sur le vote FN en milieu rural », étude Ifop, 2016.
3. Des affiches ont été créées pour inviter les restaurants à se positionner, voir le compte Instagram @delicieusement-antifasciste.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don