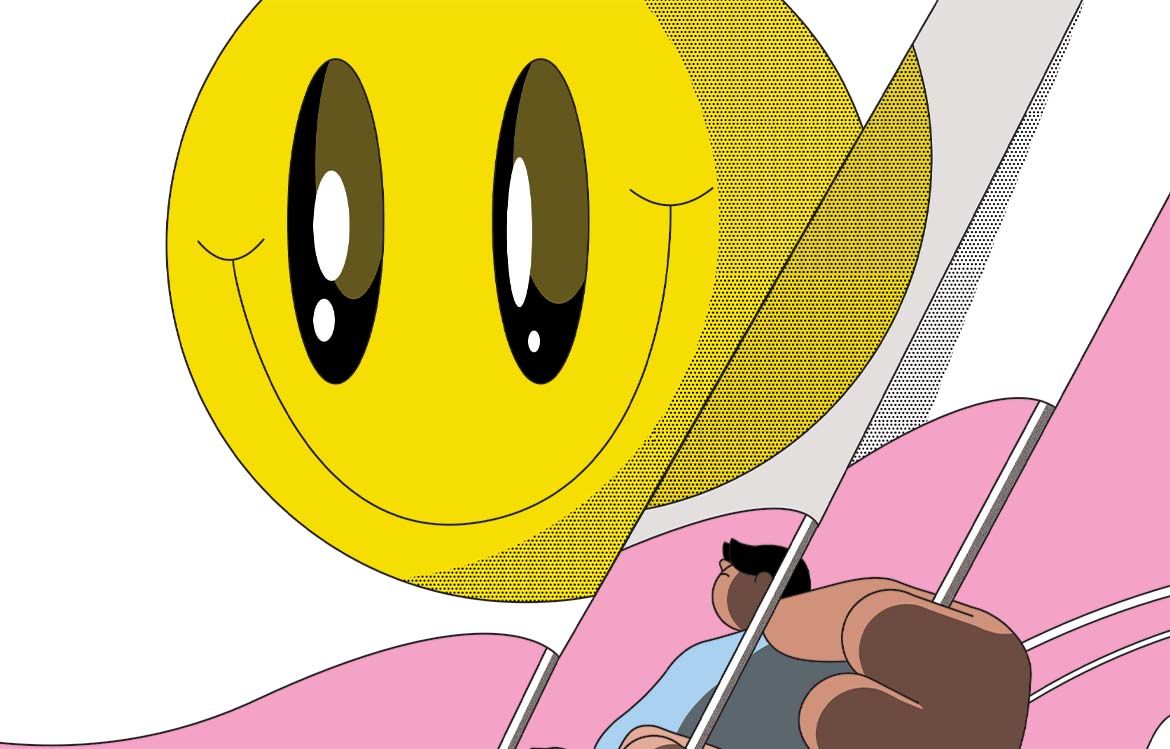De la poésie, René-Guy Cadou, un poète qu’on lit encore à l’école, aimait dire qu’elle est « inutile comme la pluie » : vitale, ignorée, vaguement méprisée, pourtant aussi essentielle que l’air qu’on respire ou le feu qu’on rallume après l’orage. De la joie, on pourrait dire tout pareil. Mais qu’ont-elles en commun, ces deux drôles de fées, la poésie et la joie, qui pourraient justifier qu’on s’en préoccupe plutôt que d’en profiter comme d’un quelconque divertissement ? À première vue, même joliesse et même insignifiance. On laisse la poésie aux adolescents, la joie aux tout petits enfants. On saute de joie, on savoure des poèmes.
Article issu de notre numéro juin-juillet 2022 « La joie malgré les défaites », disponible sur notre boutique en ligne.

Alors qu’on nage dans le bonheur et qu’on écrit des livres, activités fort sérieuses, relevant déjà du travail, on se contente de batifoler avec la joie et de faire joujou avec les vers. Tout cela sonnerait même, pour un peu, vaguement mystique – la joie parfaite, la grâce et tout l’attirail spirituel des grands rêveurs d’absolu n’est pas sans décontenancer le commun des mortels. À seconde vue, même ardeur et même utopie. Tout cela ne mérite pas vraiment que les gens raisonnables s’y intéressent. Laissons la poésie aux poètes et aux derviches tourneurs, la joie aux saints et aux naïfs.
Elles seraient de la couleur des plages, des manèges et des barbes à papa, du côté des zoos, des zozos et des marchands de bulles de savon, tout près des funambules et autres dresseurs de chevaux. Du côté des militants purs et durs, même son de cloche : ils sont là pour en découdre, à coups de citations marxistes et de théorèmes très graves. Qu’on leur parle, à la rigueur, de roman social et de théâtre engagé. Mais la poésie se porte mal en bandoulière et on oublie que Neruda (1904-1973) écrivit d’abord des poèmes d’amour.
Or, que trahit cette peur panique des usages politiques de la poétique et de la joie ? Que nous dit ce recul d’effroi devant l’idée qu’on pourrait s’amuser, autant que travailler (avec tout autant voire plus de légitimité, de mérite et de talent) ? Que reflète cette terreur devant la jouissance partagée, l’affinement des sens par l’esthétique, en un mot la beauté du monde, ce truc d’aristo-dandy et de social-traître érudit, qu’on enverrait bien aux champs se faire rééduquer, n’eût été le fâcheux précédent polpotien ? Peut-être nous dit-elle une chose trop simple pour que l’on ose la reconnaître : que l’on se trompe du tout au tout, dans notre vie quotidienne, en survalorisant l’effort et la peine, la sueur et l’exploit, la performance et le « dépassement » de… quoi ? De soi, c’est-à-dire de ce qui en nous résiste aux aberrations de la vie adulte.
Gavroche ne tombera pas toujours
Ce fumeux culte de la rentabilité du temps perdu, c’est en fait la voie la plus courte vers une mort vivante, ravie d’afficher tous ses stigmates : regardez comme je m’empêche bien de vivre ! Et comme j’ai réussi à l’oublier ! Lire des livres ? Aller au concert ? Paresser au soleil ? La vie serait un hamac ? Vous n’y pensez pas ! Ce serait s’apercevoir de toutes les fausses routes qu’on emprunte depuis l’école, réaliser que la sacro-sainte obligation n’était qu’un cache-sexe pour l’obéissance ; qu’on ne sait même plus à quoi on se devait ainsi d’obéir sinon à l’immémoriale objurgation sociale – circulez, travaillez, et ne vous en plaignez pas, puisque vous, au moins, avez la chance inouïe de ne pas être au chômage, cette tare ultime qui rendrait socialement inutile, naturellement invisible et potentiellement remplaçable par n’importe qui d’autre (voire n’importe quoi, dans le cas des automates). En bref, si ce qui rend heureux se mettait soudainement à avoir de l’importance, c’est tout le système capitaliste de reddition des comptes par la souffrance qui déraillerait.
Du côté de la subversion, on retrouve côte à côte la joie et la poésie, mais aussi l’émerveillement et la magie : ceux qui nous surprennent par la radicalité de leur discours sont forcément de méchants sorciers prêts à nous payer en monnaie de singe pour endormir notre vigilance. Qu’on ne vienne pas nous parler d’un autre monde, il sent la poudre de perlimpinpin à des (bottes de sept) lieues à la ronde ! Ainsi tourne-t-on subtilement en rond dans la grande roue des rats de laboratoire. Alors que la beauté suscite la joie qui vivifie le courage, le désespoir s’alimente à coups de fouet dans la laideur et le renoncement aux plaisirs. Et n’imaginez surtout pas, pauvres fous que vous êtes, qu’on pourrait vivre autrement, qu’il y aurait des lendemains qui chantent et des aurores après la nuit. Fatale erreur ! On a donné ! La révolution finit toujours mal.
Gavroche tombera toujours en chantant sur les barricades. Tous ceux qui ont voulu « transformer le monde » autant que « changer la vie » se sont fait avoir. On ne les y prendra plus. Désormais, on commencera par prendre soin de soi (on a tant fait pour les autres, ces mauvais coucheurs), on s’occupera de développement personnel (c’est toujours mieux que celui du business model), bref, on changera de style de vie, on pratiquera le tri sélectif, on promettra de moins prendre l’avion, on s’achètera un vélo électrique et on ira peut-être voter, une dizaine de fois dans une vie, pour celui ou celle qui se sera senti pousser des ailes en même temps qu’une vocation de délégué de classe. Et vogue la galère de la démocratie représentative, quand de tous nos pouvoirs il ne reste que cette braise, si ce n’est de la cendre : le vote comme un rituel pour oublier que le reste du temps, nous ne sommes comptables ni responsables de rien.
Un insatiable désir de magie
C’est à cette drôle de conception de la vie démocratique que certains tentent depuis longtemps d’échapper – on les dit anarchistes ou tentés par l’autogestion, conseillistes ou communalistes. On pense, pour les décennies les plus récentes, à Cornelius Castoriadis (1922-1997) de Socialismeou barbarie [mouvement révolutionnaire créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puis devenu revue du même nom, ndlr], à Murray Bookchin (1921-2006) l’écosocialiste, à Raoul Vaneigem (1934-) le situationniste. Cette étonnante trinité, qui n’a pas encore la postérité pour elle, aura pourtant tenté de repenser la politique à l’aune de la liberté et de la joie. Avec Castoriadis, c’est la notion d’autonomie radicale qu’on peut aller chercher du côté grec, dans la cité athénienne antique, où « l’objet de l’institution de la polis est [aux yeux de Périclès], la création d’un être humain, le citoyen athénien, qui existe et qui vit dans et par l’unité de ces trois éléments : l’amour et la “pratique” de la beauté, l’amour et la “pratique” de la sagesse, le souci et la responsabilité du bien public, de la collectivité ».
Pas de démocratie sans liberté de se donner ses propres lois ; pas de lois humaines possibles sans le sens d’une finitude tragique au terme de laquelle la mort l’emporte ; mais c’est justement parce que les vivants ne le resteront pas qu’ils peuvent instituer des règles et s’autolimiter, au service de la collectivité, au nom de la mémoire qu’on lègue, seule trace tangible de notre existence. Chez Murray Bookchin, c’est la forme du communalisme, parfois nommé municipalisme, qui fait l’objet d’une exploration tous azimuts : contestant la puissance révolutionnaire des « modes de vie » plus ou moins bohèmes qui se donnent pour anticonformistes, il s’intéresse aux modalités de l’action collective dans un système de démocratie directe organisée par cercles concentriques d’assemblées fédérées, qui inspire aujourd’hui le Rojava (Kurdistan syrien).
Enfin, Raoul Vaneigem n’a eu de cesse de contester les effets mortifères d’un système économique fondé sur la seule valeur marchande et de réhabiliter la gratuité, l’élan pulsionnel de la création artistique, les vertus de la pédagogie par l’enthousiasme. Ce qu’ils auront eu en commun, c’est d’ouvrir les vannes de l’imaginaire politique au nom de notre insatiable et légitime désir de magie. Dans le registre indistinctement romanesque et politique, Ursula Le Guin (1929-2018) est sans doute celle qui aura le mieux assumé ce désir d’utopie en racontant mille manières de faire société autrement, dans La Main gauche de la nuit (1969), Les Dépossédés (1974) ou L’Œil du héron (1978), par exemple.
Nous qui rêvons sans fin
De l’autonomie au fédéralisme, de la gratuité à la coopération, ils nous disent qu’il existe toujours des moyens de s’extraire de la grande légende néolibérale du meilleur des mondes pour se souvenir de tout ce qu’elle néglige et que nous devons préserver : la convivialité et la tendresse, le temps libre et vertical du poème, une fête qui ne serait ni orgiaque ni destructrice. La question proprement politique qu’ils n’ont cessé de poser et reposer dans tous les sens est celle à laquelle nul théoricien ne peut donner de vraie réponse puisque seule la pratique prouvera ce qu’on n’a pas encore su démontrer. La joie, celle de vivre et celle d’agir, celle d’aimer et celle de partager, celle d’embrasser largement son destin et celle d’en offrir de meilleurs aux plus faibles, saura-t-elle changer le monde sans sacrifier aux fausses vertus de la pureté et de la violence, de l’intolérance au nom d’une justice défaite par sa propre intransigeance ?
On continue de vouloir d’une révolution qui ne ferait pas mal, d’une radicalité qui ne dévorerait pas ses enfants, d’une exultation qui n’abîmerait pas ce qu’elle désire, d’une jouissance qui ne détruirait pas son objet, d’une jubilation partageuse qui récuserait tout cynisme. Nous qui rêvons sans fin, saurons-nous faire de la joie une fin en même temps qu’un moyen ? Si la poésie devait « servir à quelque chose », comme la pluie, ce serait à combler notre soif inassouvie de ferveur en nous signalant qu’il n’est ni absurde ni honteux de s’intéresser à l’essentiel – à la naissance et à la mort, aux larmes et à l’innocence, au mal et à son revers, qui n’est peut-être rien d’autre que la possibilité de la joie.
Comme si, dans le miroir de l’enfance qu’on croyait innocente, se dévoilait en fait une évidence très ancienne mais parfaitement escamotée par plusieurs millénaires de discours sur la culpabilité, le mérite, le paradis perdu à expier et le prix à payer pour le regagner. Ce que nous dit le bambin en cavale sur sa licorne imaginaire, c’est d’abord qu’on naît pour rigoler, ce que savait Zarathoustra, pas seulement chez Nietzsche (1844-1900), mais déjà dans toutes les légendes avestiques, indiennes ou iraniennes rapportant qu’il fut le premier prophète à éclater de rire dès son premier souffle (l’auteur de Peter Pan, J. M. Barrie [1860-1937],devait retrouver cette intuition en l’affirmant : « Lorsque le premier bébé éclata de rire pour la première fois, son rire se brisa en mille morceaux qui se transformèrent en fées. »).
La politique n’est jamais que la somme des actes qui créent les conditions dans lesquelles exercer notre capacité à la joie. Le rappeler un peu plus souvent à ceux qui prétendent en faire, parfois à notre place et parfois en notre nom, ne serait que justice, et la plus subversive des justices encore. Après la désobéissance civile, pourquoi pas la grande marrade civique ? On constate souvent qu’il y a plus de gravité et de vérité dans une farce que dans le moindre débat parlementaire – reste à rêver d’un monde où toutes les langues de bois ravalées se transformeraient en nez de Pinocchio, à rallonge pour prouver le mensonge. On aurait assez de bois pour se chauffer au long des hivers à venir et, qui sait, pour rallumer un feu de joie révolutionnaire, mais doux.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don