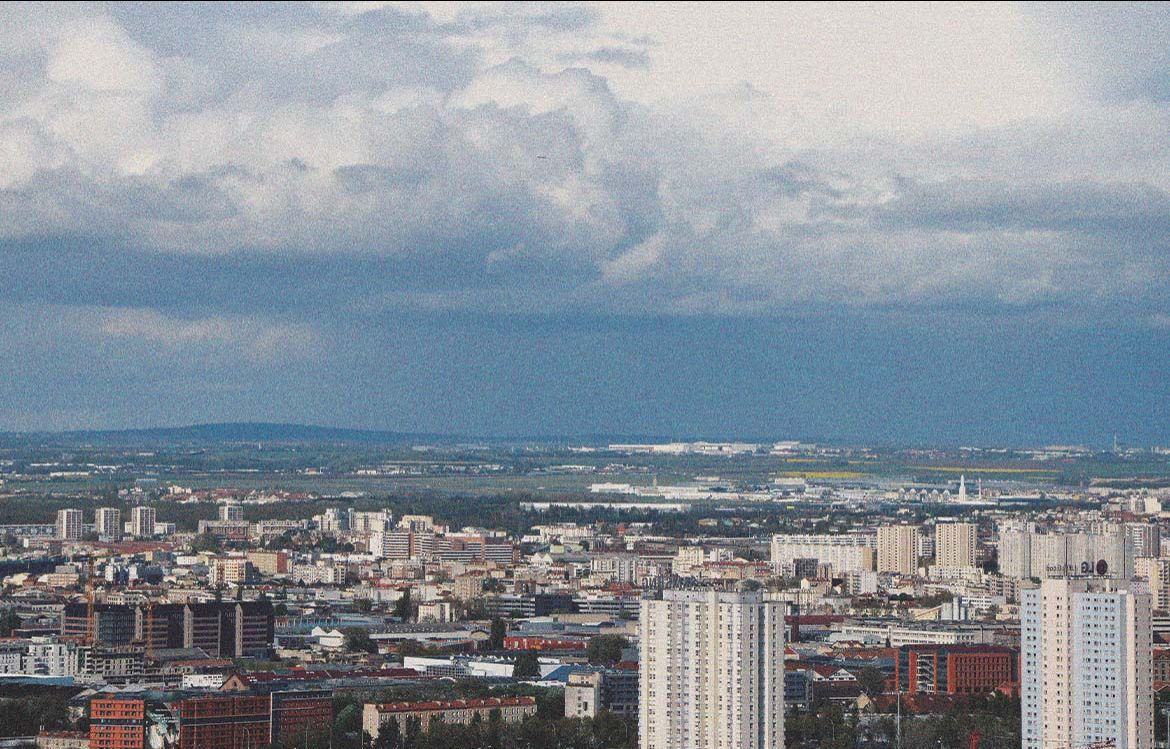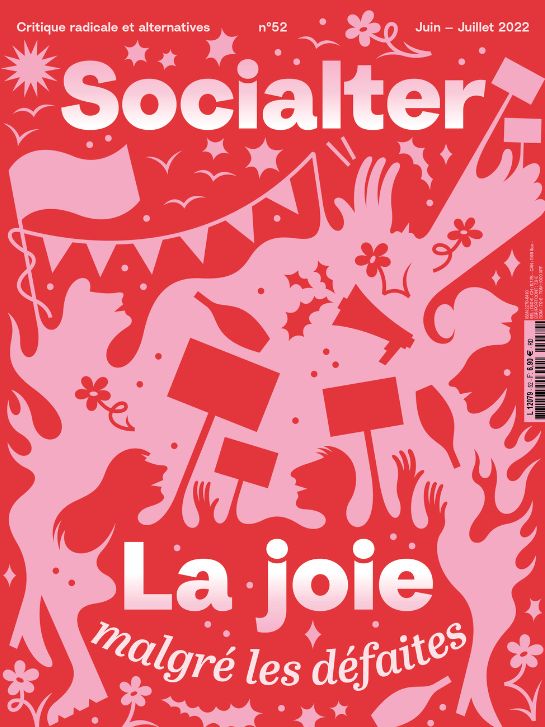Équipés de sacs-poubelle verts et de pinces, des jeunes de la cité de Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise) s’empressent de ramasser les déchets qui jonchent le sol. Ils ne sont ni en stage, ni en apprentissage, ni embauchés pour suppléer les agents municipaux : ces jeunes participent bénévolement à un « Clean Challenge ». Filmée par le média Brut, l’opération consiste à nettoyer leur quartier et, une fois l’action terminée, à nommer d’autres participants sur les réseaux sociaux dans une cité voisine, afin que ses habitants relèvent eux aussi le « défi ». « Les gens des cités ne trient pas assez leurs déchets et, même nous, on n’a pas ce réflexe », explique ainsi Hind Ayadi, présidente de l’association Espoir et Création, à l’initiative de cette action.
Enquête issue de notre numéro 52 « La joie malgré les défaites », en kiosques en juin-juillet et disponible sur notre boutique.
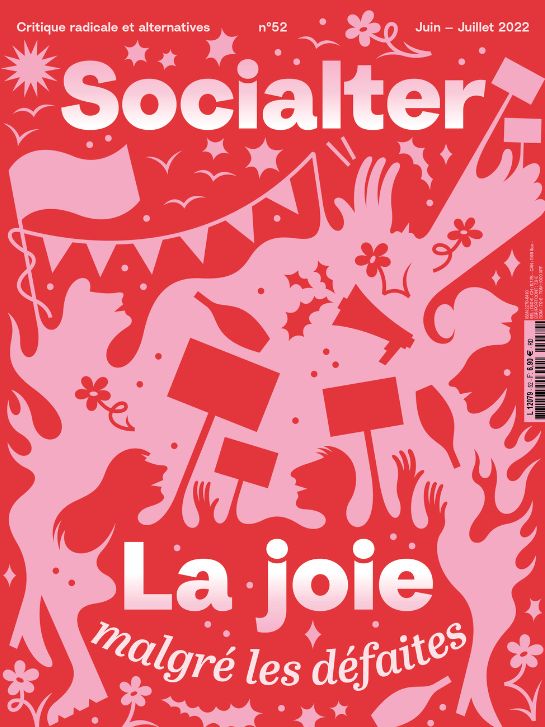
La démarche de la jeune femme, elle-même originaire de banlieue, se veut sincère : « Les enjeux environnementaux, ce sont ces jeunes-là qui vont demain les subir », prévient-elle chez Brut. D’autres médias, comme France Inter, L’Express ou encore Le Parisien, friands de ce genre d’initiatives, couvrent également ces événements pleins de bons sentiments, qui promeuvent une écologie des petits gestes, « citoyenniste » et ludique. Quand on sait que les quartiers populaires – où vivent principalement des personnes issues de l’immigration postcoloniale – sont souvent situés à proximité des autoroutes et des usines classées Seveso, donc dangereuses, et que ces zones sont en moyenne bien plus exposées aux particules fines et aux sols pollués, il y a de quoi récuser la dimension « inspirante » d’une telle démarche.
Une écologie « hygiéniste »
« Pourquoi ce serait à nous de nettoyer nos quartiers ? Pourquoi, côté pavillonnaire, il y a les services publics… qu’on finance pourtant tous avec l’impôt ? », s’interroge, agacée, Fatima Ouassak, cofondatrice du Front de mères (syndicat de parents d’élèves) et fondatrice de la Maison de l’écologie populaire Verdragon à Bagnolet en Seine-Saint-Denis. « C’est la seule “écologie” acceptable dans les quartiers, avec une dimension hygiéniste manifeste », remarque-t-elle. Dans cette logique, c’est donc aux habitants des quartiers d’effectuer ce travail gratuitement, sans que la question essentielle et politique des services publics égalitaires ne soit posée.
Les mairies ont très vite pris connaissance de ces opérations afin de les subventionner ou de les réaliser elles-mêmes. Ainsi, Laurent Monnet, maire-adjoint de la ville de Saint-Denis, délégué à la transformation écologique et conseiller territorial de Plaine Commune (territoire du Grand Paris qui regroupe neuf villes en Seine-Saint-Denis), les accueille (très) chaleureusement : « Les [opérations de] “Clean Challenge” comme [celles] de Garges-lès-Gonesse sont tellement inspirant[e]s qu’on avait mené des actions similaires avec tous les acteurs, dans une logique de respect du cadre de vie, de propreté, de tri, contre les incivilités, sans oublier le respect du travail conséquent des agents. » Du travail bénévole pour pallier le manque de services publics ? Un argument « un peu léger » pour ce maire-adjoint, car ces opérations interviendraient seulement « en complément ».
Pourtant, selon un rapport d’information sur l’évaluation de l’action de l’État dans l’exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis, présenté par les députés François Cornut-Gentille (LR) et Rodrigue Kokouendo (LREM) devant l’Assemblée nationale le 31 mai 2018, il y aurait des « sous-effectifs injustifiables à mission égale » par rapport aux autres territoires du pays. On a en effet du mal à imaginer Stanislas, Apolline et autres Marc-Édouard s’armer d’une pince pour ramasser les détritus dans leur quartier huppé du XVIe ou du Ve arrondissement – mais on se les figure très prompts à se plaindre auprès de leur mairie ou des agents de la ville si les poubelles en bas de chez eux n’étaient pas ramassées. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si c’est en Algérie, en 2015, que le « Clean Challenge » voit le jour. Un pays dans lequel les services publics sont absents et où il n’existe pas d’impôts sur la gestion des déchets…
Dans la catégorie « toujours plus dans l’indécence », la mairie de Marseille aurait pu décrocher une médaille en envisageant carrément, fin janvier-début février 2022, de demander aux habitants de ramasser eux-mêmes leurs déchets – à la suite d’une grève des éboueurs – pour que la ville « respire »… à défaut d’écouter les revendications sociales des travailleurs. « Respire », « Clean », « Briller » : le vocabulaire hygiéniste ici convoqué (ou la version coolet respectable du « Kärcher » de Nicolas Sarkozy) fait passer la dimension écologique au second plan. Ou comment réduire l’écologie à une simple question de nettoyage de l’espace public.
Racisme environnemental
Dans Le Quai de Wigan publié en 1937, George Orwell pourfendait déjà l’idée selon laquelle « c’est l’habitant du taudis qui fait le taudis », croyance alors globalement partagée par la « bourgeoisie bedonnante ». En 2022, ce mépris de classe s’additionne, dans les cités, aux représentations postcoloniales qui désignent les populations arabes et noires comme intrinsèquement sales, qu’il faudrait « éduquer » aux « bons gestes ».
À rebours de ce paternalisme, le mouvement pour la justice environnementale émerge dès les années 1980 aux États-Unis. Il consiste à pointer du doigt le fait que les activités industrielles polluantes sont essentiellement situées à proximité des quartiers où vivent des classes populaires et des personnes racisées (Amérindiens et Afro-Américains). La lutte fondatrice, en 1982, est celle des habitants du comté de Warren en Caroline du Nord contre l’implantation d’une usine chimique à proximité d’un quartier populaire de Noirs américains.
« Aux États Unis, le champ scientifique de la justice environnementale s’est mis au service de mouvements sociaux ancrés dans les quartiers populaires, très connectés au mouvement pour les droits civiques », complète Léa Billen, géographe de formation préparant une thèse sur la justice environnementale dans les quartiers populaires. « Très tôt, le terme de racisme environnemental a été posé alors que cette approche intersectionnelle [mettre en rapport la classe, la race, le genre et la nature, ndlr] des injustices environnementales est encore peu reconnue en France », regrette la chercheuse. La notion de « racisme environnemental », renseigne le sociologue Razmig Keucheyan, a été forgée par Benjamin Chavis – révérend et compagnon de route de Martin Luther King – qui a coordonné en 1987 un rapport sur le lien entre la race et les déchets toxiques aux États-Unis.
Projets écocidaires
Dès le XIXe siècle, à Paris, la répartition géographique a été imaginée en fonction de la direction des vents dominants et des fumées industrielles et domestiques – ce qui explique que les beaux quartiers se situent à l’ouest et les quartiers ouvriers et populaires, à l’est. En plus de ces fumées et de la présence d’usines polluantes, les quartiers populaires doivent régulièrement faire face à l’arrivée de grands projets inutiles qui, à défaut d’apporter des emplois, détruisent la biodiversité. Ainsi d’EuropaCity, le projet de mégacomplexe commercial et de loisirs définitivement abandonné en 2019 après plusieurs années de lutte pour protéger de riches terres agricoles du « triangle de Gonesse ». Le 14 mars dernier, Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) renonçait de son côté à construire l’extension d’une piscine pour les prochains Jeux olympiques dans les jardins ouvriers de la ville, à la suite de longues semaines d’occupation de parcelles rebaptisées « Jardins à défendre » (JAD).
« Les quartiers populaires doivent régulièrement faire face à l’arrivée de grands projets inutiles qui, à défaut d’apporter des emplois, détruisent la biodiversité. »
Dans cette commune qui jouxte le Nord de Paris, de grandes tours HLM marron en ordre dispersé entourent et surplombent des jardins datant de 1935, émaillés de petits cabanons colorés. Dolorès Mijatovic, jardinière et militante âgée de 59 ans, indique que ces terres fertiles sont utilisées par des personnes aux revenus modestes, issues des quartiers alentour, leur permettant de cultiver des fruits et légumes à moindre coût. « Le Grand Paris aménagement (GPA) s’en fout de tout ça », peste la militante, qui aura dormi dans les JAD plusieurs nuits, au grand dam des institutions « arrogantes ». Mais ces luttes intègrent-elles suffisamment les habitants d’Aubervilliers ? « Les gens qui luttent sont parfois des quartiers autour, assure Dolorès, mais ils ne représentent pas la majorité ; on trouve des militants d’Extinction Rébellion, de Youth for Climate, etc. » Les résidents des grandes tours HLM, en face des jardins, aidaient les militants des JAD en organisant la distribution de plats préparés. « Ils travaillent, ce n’est donc pas aussi évident pour eux de s’investir dans la lutte que pour des retraités comme moi ou des militants très aguerris », constate Dolorès.
Une lutte qui se veut « uniquement » écologique : un autre frein dans la réalisation de cette jonction ? Plutôt que de parler d’inégalités environnementales en Seine-Saint-Denis, Alice Canabate, autrice d’un rapport sur le sujet, préfère parler d’« inégalités territoriales » : « Le principal aspect des inégalités environnementales, c’est leur côté cumulatif et croisé, raconte la sociologue. Mettre l’accent dessus parle plus aux premiers concernés, les injustices qu’ils vivent étant tout aussi écologiques qu’économiques, sociales et politiques, et, par ailleurs, puissamment liées à un héritage territorial ; agir politiquement dessus, ajoute-t-elle, suppose d’être conscients de leur tragique intrication. »
Une militante des JAD d’Aubervilliers – qui préfère rester anonyme – indique que, « sur ce type d’occupation, les gens sous-estiment l’énergie que ça prend de gérer la vie quotidienne, qui est énorme, avec des menaces d’expulsion chaque matin. Du coup, on n’a pas pu faire ce qui nous tenait à cœur pour se connecter avec les habitants du quartier : du troc, des marchés solidaires… », regrette-t-elle. Marjorie Keters, l’une des animatrices de Pour une écologie populaire et sociale (PEPS) à Pantin (Seine-Saint-Denis), où se trouvent également des jardins ouvriers à défendre, partage ce constat : « La question n’a pas été totalement résolue, mais des liens ont été créés entre habitants des cités et militants écologistes, assure-t-elle, sur la base à la fois des besoins immédiats des habitants et en faveur de la biodiversité : soirées anti-répression, initiation au jardinage, ateliers de recyclage… »

Une stratégie de long terme
Ce qui a justement le plus intéressé la chercheuse en géographie sociale Léa Billen, c’est l’écologie ordinaire, ancrée dans les territoires et les modes de vie quotidiens. À la différence des écogestes, les démarches d’écologie ordinaire sont « très politiques et radicales sans le référentiel habituel de lutte, mais davantage axées sur l’autonomie et le quotidien, marquées par l’industrialisation et le productivisme ». L’universitaire a suivi la régie de quartier de Saint-Denis pour observer comment cet organisme arrive à mobiliser les habitants et l’écologie : « Ils ont un vide-grenier de réemploi à Saint-Denis avec des dons d’objets de seconde main », raconte-t-elle, fascinée par la dimension à la fois sociale et écologique du lieu.
Marche des mamans à Mantes-la-Jolie en 2019 pour dénoncer les violences policières subies par près de 150 lycéens (ils avaient été mis à genoux face à un mur par la police) ; lutte de deux mères, en 2016, contre l’installation d’un data center polluant dans leur quartier de La Courneuve ; création de l’association le Front de mères en 2016 à Bagnolet, par Fatima Ouassak et Diariatou Kebe, pour lutter contre les discriminations et les violences que subissent les enfants… Dans les quartiers populaires, une véritable « politique de la maman » semble à l’œuvre. L’écologie est d’ailleurs l’un des principaux combats menés par le Front de mères, à travers les revendications autour de l’alternative végétarienne et biologique dans les cantines scolaires, contre les produits industriels d’Elior ou de Sodexo.
Le collectif s’est associé au mouvement écologiste Alternatiba en juin 2021 pour créer la Maison de l’écologie populaire Verdragon, à Bagnolet. Devenue depuis une association, elle est située dans un ancien dépôt industriel de La Noue (Montreuil), le quartier le plus populaire de la ville. Un écrin de verdure à côté du périph’, entouré de pancartes issues de manifestations écolos. Ce mardi, l’équipe de bénévoles s’active pour l’inauguration d’un espace culturel ouvert à tous. De la soupe aux oignons de Normandie et des plats marocains végétariens sont servis gratuitement, tandis que jeunes du quartier, militants écolos de Montreuil et femmes musulmanes de Bagnolet discutent stratégie politique.
« Depuis juin 2021, on a eu des attaques répétées alors que le bail était discuté en mairie pour être prolongé. On a fini par l’obtenir. En tant qu’association antiraciste et autonome, c’était surtout nous le problème, le Front de mères, moins Alternatiba », raconte, indignée, Fatima Ouassak. « Le drapeau vert (couleur de l’islam) flotte sur Bagnolet », s’hérisse, le magazine Causeur le 9 décembre 2021 ; « À Bagnolet, des habitants s’inquiètent de l’implantation d’une association indigéniste », titre Marianne le 11 novembre 2021. Certains habitants des « quartiers pavillonnaires », selon Fatima, considèrent en effet qu’ils ne doivent pas occuper ces lieux et ont même signé une lettre ouverte à la mairie contre leur présence – dès que des Arabes s’organisent politiquement, le fantasme raciste et complotiste du « séparatisme islamiste » n’est jamais loin. Mais une tribune comprenant entre autres la Ligue des droits de l’homme (LDH) a tout de même fini par voir le jour en soutien à Verdragon, le 17 décembre 2021.
« C’est une stratégie sur le long terme, on est plus forts politiquement avec un lieu à occuper. On a obtenu la “cantine végétarienne”, les ascenseurs… en se demandant simplement comment améliorer nos conditions d’existence. »Après quelques découragements, Fatima Ouassak se veut désormais optimiste sur l’avenir des luttes écologiques et sociales dans les cités : « Notre lieu, c’est classe populaire et classe moyenne ; il y a de tout et c’est ça qui fait notre force – le seul lieu d’écologie de ce type. Il faut absolument le point de vue des quartiers pour que ça marche ! »
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don