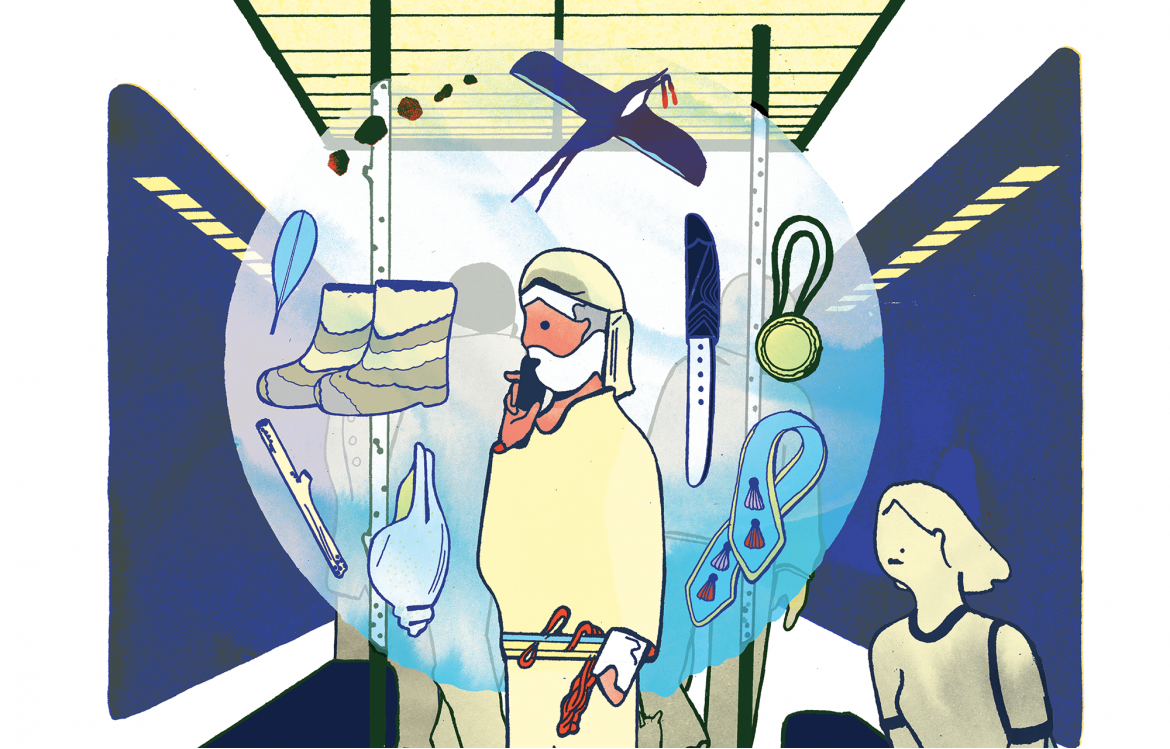Souvenez-vous : en un temps pas si lointain, nous nous réunissions dans des lieux clos, à moins d’un mètre de distance, pour parler de nos vies autour d’un verre. Entre éclats de rire et postillons, nous refaisions le monde, plongeant nos mains non désinfectées dans des bols remplis de biscuits apéritifs dans l’espoir d’y trouver un dernier mini bretzel. Parmi les sujets de conversation les plus en vogue autour de la table ces dernières années : le désastre écologique en cours, le déclin dramatique de la biodiversité, le réchauffement climatique et, finalement, le fait que nous nous dirigeons vers une asphyxie collective dans un monde en flammes. Face à ce constat se posait alors la question : que faire ? Plusieurs options s’offraient à nous. Les plus attentistes décidaient de se resservir un verre en faisant comme si de rien n’était ; les plus investis évoquaient leur jardin partagé comme un geste écoresponsable allant de soi ; les plus originaux, enfin, étaient susceptibles de vanter leur dernier stage de chamanisme en forêt comme une façon de se reconnecter « au monde et à leur nature profonde ». Avouons-le, il n’était pas rare qu’un sourcil moqueur se lève alors. Pourtant, après l’enthousiasme qu’elles ont suscité dans les années 1970, les philosophies prônant un rapport non anthropocentré au monde connaissent un nouvel élan : outre les magazines féminins qui présentent l’ayahuasca comme « le trip le plus en vue du moment », le succès des livres signés par les chamanes Alberto Villoldo ou Miguel Ruiz, tous tirés à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde, en est peut-être la meilleure illustration. Au-delà de la simple quête d’exotisme dans laquelle on pourrait vite le cantonner, que dit de nous cet engouement ? Quelles perspectives éthiques, politiques, sociales en tirer ?
Grands bols d’air et tambours chamaniques
« Revenir à la terre », « se reconnecter à la nature » : tout le monde a lu ou entendu ces expressions. Le degré de conscience croissant quant à la crise écologique à laquelle nous sommes confrontés a fait son œuvre, et il y a fort à parier que la crise sanitaire que nous traversons ne fera qu’accélérer ce besoin de nous rapprocher de la nature – a minima pour les urbains ou périurbains claquemurés dans des espaces restreints et bétonnés. Ces derniers représentent la grande majorité de ceux qui se présentent à la porte du centre L’appel des forêts, dans le Loiret, pour participer à des stages d’art de vivre dans les bois, de découverte de la flore ou de « rencontre avec l’arbre ». Professeur d’EPS de formation, Philippe Boiron a monté cette association avec l’objectif de partager son approche sensible de l’environnement. En face de lui, « des personnes plutôt physiques, d’autres plus mystiques, quand certaines sont simplement en quête d’autonomie ou plus prosaïquement d’un grand bol d’air ». Il explique : « Je tâche de canaliser ces différentes motivations pour nourrir l’idée d’une résilience nécessaire. Pour moi, il est crucial d’aller dans la nature pour y puiser les solutions de notre futur. » Une vision et un projet qui semblent porter leurs fruits, puisque son activité ne cesse de croître : outre des stages archi-complets, les démarches sont aujourd’hui engagées pour passer du statut d’association à celui d’entreprise.
Même constat du côté d’Else Orève. Installée en Île-de-France, cette ancienne ingénieure en génie mécanique accompagne des personnes dans un processus d’apprentissage chamanique. Elle exerce en cabinet ou lors de sorties en forêt où elle encadre des groupes qui, soutenus par le bruit du tambour, tâchent de se reconnecter au vivant. Cette démarche repose sur l’idée qu’il se trouve quelque chose de plus subtil derrière la matérialité des choses, une « âme » présente dans chaque être : « En tant qu’Occidentaux, on a tendance à considérer le monde qui nous entoure comme une simple matière. » Son accompagnement a ainsi vocation à modifier le regard que l’on pose sur le monde : « La société dans laquelle on évolue nous demande d’être opérationnel en permanence, d’être constant, productif… Alors que l’on vit sur une planète régie par l’alternance de l’action et du repos, comme le montrent les saisons. On demande de plus en plus aux personnes de vivre comme des machines, des individus performants aux émotions lissées. » Désireuses de faire un pas de côté, les personnes qui viennent la voir s’engagent dans une quête intérieure, armées du souhait de renouer un lien avec la nature et, par celui-ci, de « trouver leur place dans le monde ». Comme Philippe Boiron, dont l’une des sources d’inspiration se trouve dans le rapport à l’environnement de la communauté Bishnoï (présente dans le nord de l’Inde), Else Orève puise ses connaissances et son inspiration dans des cultures non occidentales. Elle a notamment étudié à la Fondation pour les études chamaniques créée par l’anthropologue Michael Harner, et s’est dotée d’un solide bagage qu’elle aborde lors de ses formations. Loin de surfer sur ce qui peut s’apparenter de prime abord à une hype passagère, tous deux s’inscrivent dans une certaine tradition occidentale.
Des steppes aux rayons de développement personnel
L’intérêt pour les cultures qui ont un rapport au monde ontologiquement différent du nôtre ne date pas d’hier. Les passions successives suscitées par le chamanisme en sont sans doute le meilleur exemple. Au xviiie siècle déjà, des chamanes étaient invités par de grandes familles de la noblesse russe pour partager leurs savoirs et pratiquer des rituels de guérison. Preuve de leur succès : après être devenu une figure de salon, le Chamane de Sibérie s’est imposé comme personnage littéraire sous la plume de l’impératrice Catherine II de Russie. Le xixe siècle, traversé par le courant romantique, a par la suite étendu à l’Europe entière l’intérêt pour ces pratiques. Enfin, plus proche de nous, ce sont les années 1970 qui ont fini de démocratiser ces approches dans un élan baba lié aux drogues et à la contre-culture américaine. En 1980 sort La Voie du chamane, signé de l’anthropologue Michael Herner, qui fera école en plus de rencontrer un succès planétaire. Cet ouvrage développe l’idée selon laquelle les rites chamaniques pratiqués aux quatre coins du globe partagent une même racine, et propose un « core-chamanisme » – ou « chamanisme essentiel » – qui intègre différentes traditions pour les rendre accessibles aux Occidentaux. En 1997, c’est un neurochirurgien mexicain devenu chamane, Miguel Ruiz, qui publie son livre Les Quatre Accords toltèques. Il puise dans cette culture ancienne, antérieure à celle des Aztèques, des préceptes qui doivent permettre à ses lecteurs de déconstruire les conditionnements qui sont les leurs pour retrouver un semblant de paix intérieure. Ce texte s’est écoulé à plus de quatre millions d’exemplaires dans le monde depuis sa sortie, dont plus de 100 000 en France.
Ethnologue et maître de conférence à l’École pratique des hautes études, Charles Stépanoff est l’auteur du livre Voyager dans l’invisible, fruit d’années d’enquêtes de terrain menées auprès des sociétés chamanes (lire son récit p. 148). Pour lui, le mouvement qui a marqué la seconde partie du xxe siècle s’est efforcé de trouver un fond commun universel en puisant à travers différentes traditions venues des cinq continents : « Il les a entremêlées pour remonter à ce qui serait le “cœur” du chamanisme, un chamanisme primordial et essentiel. Il y a eu une adaptation pour aboutir à un chamanisme mondialisé et réécrit pour répondre à des besoins occidentaux. Cette démarche est profondément liée à notre psychologie, à la quête de soi. » Le succès que cette proposition rencontre à partir des années 1970 répond en effet à un besoin de spiritualité individuelle qui échappe à l’Église, aux institutions ou à une quelconque doctrine dogmatique. Sous cette forme, le chamanisme contribue au boom du développement personnel et des courants new age. Ces démarches reposent sur une forme de management de l’individu par lui-même, épousant parfaitement la doctrine néolibérale qui s’impose alors sous nos latitudes comme doctrine hégémonique.
Le souci de nourrir une relation bienveillante et non hiérarchique à la nature est quant à lui beaucoup plus récent. De fait, face au désastre écologique en marche, ceux qui se tournent vers ces pratiques spirituelles le font désormais dans une démarche d’humble retour vers un environnement malmené. La tentation de rejeter l’idée d’une séparation étanche entre les humains et la nature – ce que l’anthropologue Philippe Descola désigne comme l’ontologie naturaliste propre aux sociétés occidentales depuis le Renaissance – y affleure. À l’échelle individuelle, le temps d’une escapade en forêt, c’est indéniablement tentant. En revanche, on peut se poser la question de sa transformation à l’échelle d’une société : le rejet de cette dualité peut-il être source de transformations collectives ?
Composer avec l’héritage occidental
Selon Virginie Maris, philosophe rattachée au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier et autrice de La Part sauvage du monde (Le Seuil, 2018), un essai stimulant qui tente de réhabiliter l’idée de Nature et défend la préservation d’un monde sauvage, « ces connaissances sont très fertiles et aujourd’hui incontournables ». Selon elle, « l’engouement pour l’animisme ou le chamanisme revêt un intérêt important et nouveau pour des savoirs dont les populations autochtones sont détentrices, et essentiels si l’on veut faire face à la situation actuelle. En revanche, l’exotisme qui peut opérer dans notre fascination pour ces savoirs est sans doute moins fertile qu’une recherche centrée sur des rapports à la Nature déjà existants en Occident. » En effet, l’idée qu’il y aurait, en Occident, une seule et unique conception des rapports de l’homme à son environnement semble illusoire, comme l’illustrent la culture paysanne, la permaculture, la domesticité et les liens de compagnonnage avec des animaux loin d’être considérés comme de la simple « matière ».
Plutôt que de se diriger vers des ontologies autres, la première chose à faire serait donc de prendre conscience du fonctionnement de notre société et du rapport qu’elle a développé à la nature : un rapport hiérarchisé par rapport au vivant. Pour Charles Stépanoff, « en Occident, on a tendance à considérer les choses à un niveau très abstrait, en se disant qu’on est écologiste à partir du moment où, dans sa tête, on a un rapport respectueux à la Nature. Mais tant qu’on est dans une société urbanisée basée sur la division du travail, notre rapport à cette Nature dépend de l’organisation de notre société, avec une agriculture industrialisée et des infrastructures dont on n’est absolument pas responsables individuellement. » Composer avec l’héritage qui est le nôtre implique donc, dans un premier temps, de penser le régime productiviste dans lequel nous nous trouvons, qui s’exprime dans la mise au travail de la terre jusqu’à épuisement. Ce questionnement implique une réflexion qui excéde les rapports entre humains et non-humains. Comme le rappelle Virginie Maris : « Il importe de réfléchir à la mesure dans laquelle ce régime d’exploitation de la Nature s’exprime aussi dans un rapport violent à d’autres humains. Il y a un angle mort important dans le diagnostic que l’on fait de la crise actuelle. En pointant du doigt un dysfonctionnement du rapport des humains à la Nature, on s’empêche de voir son imbrication avec d’autres dominations. Cet intérêt pour les ontologies non occidentales peut ainsi passer à côté d’enjeux essentiels. » Elle fait le pari que nous avons les outils pour penser le monde en conservant la dualité dont nous héritons, tout en s’affranchissant des logiques de domination qui l’ont accompagnée : la Nature et la Culture de part et d’autre, mais sans que l’une ne domine l’autre. « Il s’agit bien d’un pari, je ne sais pas ce qu’il adviendra… Mais je fais ce pari », mise-t-elle. Face à l’héritage de Descartes, sans doute faudra-t-il se résoudre à tenter un pari pascalien.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don