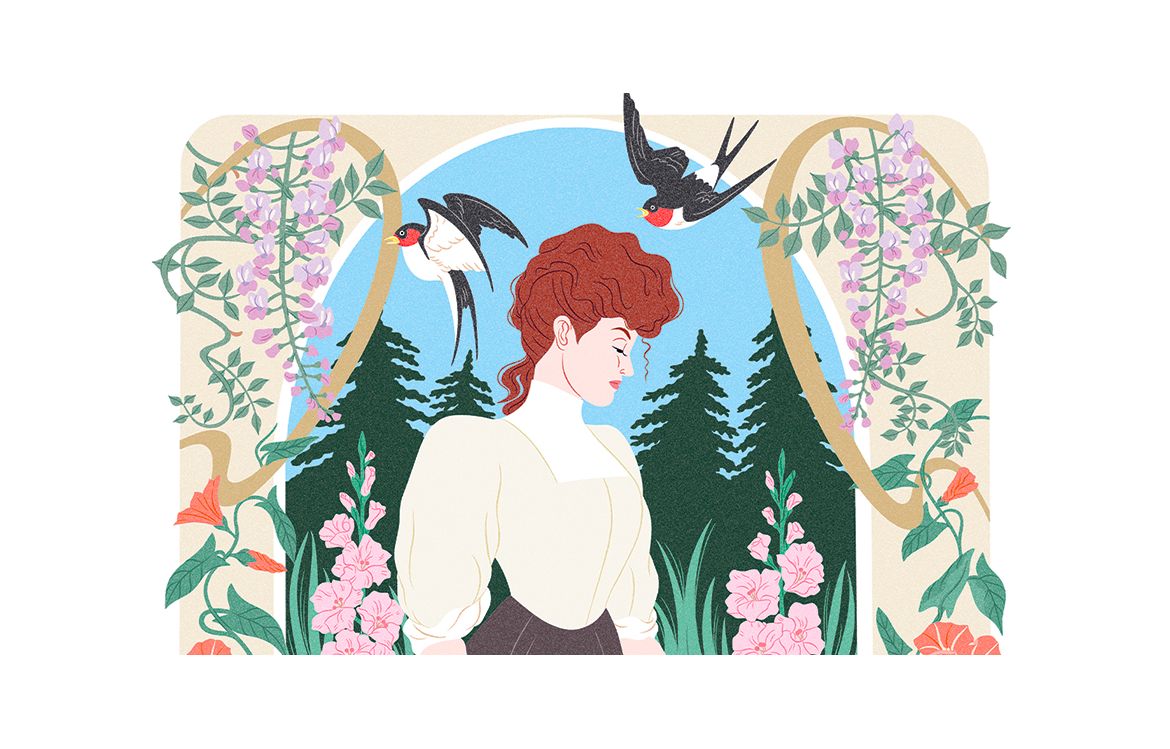Le serpent du jardin d’Éden, la rose de Ronsard, le corbeau de La Fontaine, l’herbier de Rousseau, le lac de Lamartine, la jungle du Douanier Rousseau… Au premier regard, le monde vivant semble omniprésent dans notre culture. L’amour de la nature n’est-il pas d’ailleurs un des lieux communs de la création artistique ? Alors, pourquoi estimer qu’une culture du vivant reste aujourd’hui à construire, qu’il y aurait une bataille culturelle à mener à son endroit, comme en appelle Baptiste Morizot ? Pour résoudre ce paradoxe apparent, il s’agit de regarder les êtres vivants qui peuplent notre histoire artistique et culturelle d’un peu plus près. Ne pas seulement recenser leur présence, mais interroger comment ils sont présents : suivant quelles modalités, suivant quel style d’attention ? Ce qu’on découvre alors, c’est que bien souvent, si le vivant est effectivement présent, il est présent pour autre chose que lui-même. Il est là, mais il n’est pas vraiment là : dans l’immense majorité des œuvres, il est en effet convoqué comme symbole ou comme support de projection d’émotions humaines. La rose, c’est en fait l’éphémère de la jeunesse. Le lac, c’est en fait le souvenir tragique de l’être aimé. Il y a comme une forme d’orientalisme du vivant dans notre culture : dans bien des cas, à l’instar de ces peintures de harems fantasmés, cela ne dit rien des autres, cela ne parle que de nous et de nos obsessions collectives.
La cultivation de cette relation de correspondances symboliques et sentimentales constitue une manière à part entière de nouer avec le vivant, qui n’est bien sûr pas problématique en soi : c’est son quasi-monopole dans notre histoire culturelle qui est à interroger si l’on souhaite aujourd’hui créer une culture du vivant. Comment expliquer une telle perdurance, un tel succès de cette modalité de relation au vivant jusque dans la production culturelle la plus récente ? On pourrait l’interpréter de bien des manières. Comme le symptôme de notre cosmologie naturaliste, ou encore comme une nécessité politico-économique : comme dans l’orientalisme, faire disparaître sous soi l’altérité et l’autonomie des autres formes de vie que la sienne permet en réalité de légitimer les formes de domination et d’exploitation de celles-ci. C’est une autre piste que je voudrais explorer ici : l’ultraprédominance de la relation symbolique et sentimentale au vivant comme une mauvaise solution à un bon problème – à savoir la recherche de relations responsives avec lui.
Le silence du monde vivant
Une relation responsive, selon le sociologue Harmut Rosa, c’est l’idéal de relations au monde que nous cherchons constamment à mettre en place dans les différents domaines de notre existence. C’est une forme de relation au monde qui se caractérise par le sentiment de pouvoir produire des effets sur un « vis-à-vis », une entité identifiée comme autre et extérieure, et par la perception d’une réaction de celle-ci en réponse à mon action, qui m’affecte en retour. Ce rapport responsif, vécu sur le mode de la « fluidité », de « l’adhérence » au monde, s’oppose à un « rapport muet », caractérisé par l’infranchissable et l’absence de rétroaction entre le monde et moi. Selon Rosa, c’est ce dernier rapport qui caractérise notre relation aux non-humains aujourd’hui : « Le propre de la modernité occidentale est de ne pouvoir accorder aucune qualité de résonance aux choses, c’est-à-dire aux objets non humains (…) dans l’organisation cognitive de ses relations au monde (…). L’univers de la modernité, qui tient sa légitimité de la connaissance rationnelle et scientifique, est (…) un “univers muet” dans lequel aucune voix ne se fait entendre hormis celle de l’homme. » Le monde vivant ne nous parle plus comme au temps de la Renaissance, où les ressemblances formelles entre les êtres étaient autant de clés cachées du cosmos, révélant les sympathies cachées et profondes entre les choses du monde – selon cette cosmologie dite « analogiste », la fleur d’aconit, dont la forme rappelle un œil humain, est considérée comme un remède pour la cécité. La modernité naturaliste rend extrêmement difficile toute possibilité d’une relation au vivant autre qu’instrumentale : si la nature n’est que de la matière physique, extérieure à nous, quantifiable, dépourvue d’intériorité, alors je peux la manipuler, l’extraire, l’accumuler, l’organiser, mais comment puis-je entretenir décemment une relation responsive avec elle ?
Rendre le monde vivant responsif, coûte que coûte
Le rapport sentimental et symbolique tâche de rompre le silence du monde vivant, d’abolir la distance entre lui et nous, et surtout d’effacer l’indifférence qui semble le caractériser à l’ère de la modernité, le fait qu’il ne nous concerne pas. C’est un premier pas pour sortir de la relation mutique moderne au monde vivant. Mais les formes d’interaction et de dialogue qu’il met en place ne sont que des simulacres de responsivité : ce n’est pas le vivant qui me parle, c’est moi qui me parle à moi-même. Ce n’est pas un dialogue, mais un soliloque. Lorsque, pensive, je marche sur un sentier, que je vois un saule pleureur et que je m’émeus devant la mélancolie de ce paysage, je n’ai fait que ventriloquer le saule : je ne l’ai jamais rencontré comme altérité me faisant face. Lorsque j’aperçois un loup et que je n’y vois qu’un rappel de la part sauvage et indomptable de l’humain, je n’ai pas en réalité vu le loup, je l’ai fait disparaître sous mon désir de rendre le monde vivant responsif, coûte que coûte. Coûte que coûte, car ce rapport de correspondances symboliques, poétiques et affectives, et le sentiment qu’elle apporte d’une union retrouvée, a un prix : celle d’écraser toute forme d’altérité du vivant. Je ne vois que moi partout, autrement dit je ne vois rien. C’est en cela qu’il s’agit d’une relation responsive, certes pleine de charmes, mais illusoire. Pour qu’il y ait responsivité, il ne suffit pas d’avoir l’impression que le monde nous dit quelque chose. Il faut être confronté à un vis-à-vis autonome, « qui est indisponible, qui nous résiste et nous tient tête », pour reprendre Rosa, absent du rapport symbolico-sentimental, où je ne reçois en écho que ce que j’ai moi-même projeté dans le monde. C’est un rapport au monde vivant « amputé de moitié » – un rapport au monde vivant sans le monde vivant.
Faire de la place à l’altérité
La question devient donc : comment créer une relation responsive au vivant qui fasse de la place à l’altérité ? Non plus une relation avec un monde que l’on pense muet et que l’on réanime en se projetant soi-même partout, mais une relation avec un monde vivant bruissant de signes et de significations qui révèlent les « manières d’être vivant » de chacun, et par-là même les nôtres. Car faire de la place à l’altérité, ce n’est pas postuler, suivant une inversion symétrique, que le vivant ne révèle, ne dit, ne recèle en fait rien de nous. Il s’agit ici de pluraliser le « nous », de pluraliser les versions de nous-mêmes : certes, le vivant ne parle pas de nous, si ce « nous » est nos singularités biographiques, mais il parle pourtant inlassablement de nous en tant que vivant. Il nous révèle plus justement qui nous sommes : en nous donnant à voir ce que nous avons profondément en partage avec d’autres formes de vie (par exemple, cette propension que nous partageons avec le castor à trouver le monde décidément plus aimable s’il a été aménagé de fond en comble par nos soins), mais aussi notre singularité irréductible parmi elles, notre manière humaine d’être vivant – comme il existe une manière castor d’être vivant. Rechercher une relation responsive avec le vivant n’est donc pas une quête illusoire, obscurantiste, prémoderne à laquelle nous devons renoncer : celle-ci a tout son sens, à condition de changer qui nous sommes dans cette relation.
Comme dans d’autres domaines de l’existence, faire de la place à l’altérité exige d’apprendre à connaître l’autre. C’est souvent un bon début. Dans l’aire culturelle occidentale, c’est aux sciences naturelles qu’a traditionnellement échu cette tâche de connaître le vivant. Dans Vesper Flights, paru cette année, l’historienne des sciences et écrivaine Helen MacDonald relate ainsi de manière frappante : « Ce que la science fait, c’est ce que la littérature ne fait pas assez à mon goût : nous montrer que nous vivons dans un monde magnifiquement compliqué qui ne tourne pas tout entier autour de nous. » Parce qu’elles enquêtent à longueur de journée sur d’autres formes de vie que la nôtre, parce qu’elles consistent à inventer sans cesse des dispositifs pour « faire parler » le vivant, les sciences naturelles apparaissent comme bien plus aguerries dans cet art de faire de la place à l’altérité que certaines de nos traditions artistiques. Elles constituent ainsi un antidote puissant à notre habitude si moderne de ne pas voir le vivant. Pour créer une relation responsive avec un vivant reconnu comme alter, il s’agirait ainsi de l’adosser à des connaissances en sciences naturelles.
La connaissance qui sépare
Cependant, il y a un hic. Car connaître le vivant prend une forme très particulière dans les sciences naturelles, héritières de la modernité. Je parle ici du canon à partir duquel s’est construite la science moderne, et non des sciences dans leur pluralité et leurs pratiques de recherche quotidiennes. Connaître le monde vivant pour un Moderne, c’est avant tout le désenchanter. Désenchanter ne signifie pas seulement ici renoncer aux croyances au surnaturel. Non, c’est autre chose encore : c’est faire la preuve, par des opérations d’objectivation, que le vivant est d’abord de la matière, régie par des causalités mécaniques et dépourvue de significations et d’intentionnalités (ce qui permet d’ailleurs de le considérer comme simple ressource à disposition et ouvre la voie aux pratiques d’exploitation sans égards). « Tout ceci, ce n’est que... » : voilà comment la science moderne a petit à petit eu pour effet d’évider le monde vivant de toutes significations, autres que mathématiques. La connaissance scientifique, telle qu’élaborée par la modernité, réduit, quantifie, convertit en faits et en lois, ce qui était l’instant d’avant un être plein de vie et de mystère.
La nature des savoirs tend ainsi à produire un effet de désanimation, de réduction du monde vivant, et dégrise brutalement toute personne chez qui naîtrait un intérêt minimal pour lui. Combien de fois ai-je ouvert un manuel scientifique, enthousiaste à l’idée d’en savoir plus sur les mousses, par exemple, pour le refermer immédiatement après, convaincue que rien, rien au monde n’était plus ennuyeux et plus étranger qu’une mousse... Quelle injustice faite aux mousses ! Autrement dit, la connaissance scientifique moderne, parce qu’elle naît du Grand Partage entre Nature et humains, est une connaissance qui sépare. On comprend mieux pourquoi les arts ont tant privilégié une relation symbolique et sentimentale au vivant : c’est en partie une forme d’attitude réactive et compensatoire à l’égard de l’aliénation et de la réduction du monde vivant produites par les sciences. Pour réinventer la culture du vivant dont nous avons besoin aujourd’hui, il nous faut sortir de cette fausse alternative que la modernité nous offre à l’heure de choisir nos relations au vivant : vivre dans un monde faussement responsif, sans altérité et sans connaissance de celles-ci, ou vivre dans un monde tragiquement réduit et séparé.
Une connaissance qui relie
L’un des grands enjeux d’une culture du vivant est ainsi, à mon sens, de mettre en lumière, et d’inventer des formes de connaissance qui relient. Des manières de connaître, qui conservent cette exigence des sciences naturelles à l’égard de l’exploration de l’altérité, mais qui nous tissent au monde vivant – plutôt qu’elles ne le repoussent dans le domaine des choses mortes à nos yeux. Cette connaissance qui relie n’est pas seulement présente dans les aires culturelles qui ont échappé à la modernité naturaliste, sous la forme des savoirs animistes par exemple. On peut aussi la trouver dans notre propre tradition, bien qu’elle ait été souvent oubliée, enfouie sous une autre version de l’histoire. Cette manière de connaître a été en réalité incroyablement mise en œuvre au XIXe siècle, en Angleterre et aux États-Unis, par une lignée de femmes écrivaines et naturalistes. Botanique, entomologie, ornithologie, théorie de l’évolution, tous les domaines de l’histoire naturelle sont pris en charge par ces femmes. Leurs ouvrages, véritables best-sellers de leur époque, aujourd’hui ignorés, prennent la forme d’introductions à une discipline, de guides de terrain ou encore de récits d’observation. Autodidactes, n’ayant pas droit de cité dans l’académie, étudiant ainsi le vivant chaque jour depuis chez elles, dans les jardins ou les alentours, ces femmes ont inventé un style d’attention au vivant parfaitement singulier : un style d’attention non moderne, où la connaissance du vivant a pour ambition explicite de faire entrer en relation avec lui.
C’est ce que décrit la naturaliste Frances Theodora Parsons dans How to Know the Wildflowers (1893), premier guide de terrain en Amérique du Nord consacré aux fleurs sauvages. Voici ce qu’elle écrit : « Je réalise aujourd’hui à quel point je perdais au change quand je cédais trop facilement au découragement, bien que j’en avais déjà quelque peu conscience, durant cette longue période de ma vie où les plantes étaient pour moi anonymes. Lorsque je me retrouvais parmi des fleurs dont les visages m’étaient familiers, mais leurs noms inconnus, je sentais que je ne tirais pas le meilleur parti de la situation. Et quand je rencontrais des plantes que je ne connaissais ni de vue ni de nom, j’étais alors bel et bien une étrangère parmi elles. »
Les termes employés par Parsons peuvent surprendre : elle parle des « visages » des fleurs, elle ne dit pas « trouver » les fleurs, mais les « rencontrer ». Doit-on y voir de l’anthropomorphisme ? Ce serait manquer la subtilité de ce que construit ici l’auteure. Car, par le choix de ces mots, Parsons établit une analogie, qui n’est pas une analogie entre deux termes : elle ne compare pas les fleurs à des humains. C’est une analogie entre deux relations. Parsons en appelle en effet à une expérience connue du lecteur pour qu’il ressente ce qui est manqué, lorsqu’on ne sait pas nommer les plantes. Ne pas connaître leur nom, nous dit Parsons, c’est comme se retrouver dans cette situation inconfortable qui se produit lorsqu’on arrive à une fête et où l’on ne connaît personne, où l’on peine ainsi à prendre part à ce qui se passe autour de nous. Ne pas connaître le nom des plantes autour de nous, c’est s’exposer à éprouver ce même sentiment de n’être pas à sa place, de ne pas appartenir, d’avoir le sentiment d’être seul alors même que l’on est entouré. L’origine du sentiment de solitude cosmique des Modernes n’est peut-être pas une lucidité métaphysique supérieure sur le fait que nous sommes les seuls sujets dans un monde de choses, matière muette absurde : c’est simplement qu’on hérite d’une socialisation culturelle telle qu’on ne connaît personne à la fête du vivant.
Se connaître comme manière d’être vivant
Ne pas connaître le nom des plantes fait de nous « des étrangers » parmi les plantes, écrit Parsons. Elle procède ici à une très belle inversion : ce ne sont pas les plantes qui sont des inconnues, formule qui nous viendrait plus spontanément à l’esprit, mais soi. Vous n’êtes pas chez vous dehors, semble dire Parsons : être chez soi dehors n'est pas un donné, cela se gagne, et vous ne serez pas chez vous à moins d’apprendre à connaître ceux qui y vivent. L’ignorance du nom des fleurs exclut, non pas du cercle des érudits, mais du cercle des plantes elles-mêmes. L’absence de connaissance est ici caractérisée comme un empêchement des relations. Et ainsi, une privation d’un pan de l’expérience. Le nom est mobilisé ici singulièrement : il n’est pas cet outil qui fige, qui met à distance, qu’il faut posséder pour établir un ordre taxinomique, souvent analysé comme volonté de domination de la nature. Le nom n’est pas le point d’arrivée de la relation. C’est le point de départ. Il est ce qui ouvre la possibilité d’une relation. Car savoir nommer, c’est savoir distinguer, opération critique pour une culture qui a empaqueté la myriade des formes de vie sous un seul terme générique de « nature » : « Comme la nature est belle ! » s’exclame-t-on en étranger, arrivant dans une prairie. Parmi les antidotes puissants à l’aplat moderne naturaliste, le nom est un ingrédient important. On n’a souvent appris à ne voir que des « fleurs », là où il y a des anthyllides vulnéraires et de la petite pimprenelle. Or, ne voir que des « fleurs », même si on apprécie leur beauté, c’est une certaine façon de ne pas les voir : c’est leur retirer leurs qualités distinctes, ou mieux dit leur « manière d’être vivant ». « Leurs noms seuls servent d’indices nous révélant leurs histoires, nous donnant le sentiment d’une camaraderie partagée avec les alentours », écrit Frances Theodora Parsons. Sans le nom, il n’y a qu’un décor anonyme : sans lui, il n’y a personne.
Ou plutôt : on ne peut être personne parmi ces plantes, si l’on suit l’inversion à laquelle procède la naturaliste nord-américaine, c’est-à-dire qu’on ne peut pas établir de relations. On est voués à rester anonymes dans un monde sans noms, à être un étranger dans un monde peuplé seulement d’étrangers. La connaissance des plantes comme des manières d’être vivant est un miroir inattendu et dépourvu de narcissisme : un miroir qui ne renvoie pas l’image de nos sentiments intimes comme dans l’attitude romantique, mais une image de nous-mêmes comme vivant parmi les vivants. On pourrait appeler ce phénomène, l’inversion de l’identification : identifier les plantes permet de s’identifier soi-même, non pas d’un point de vue taxinomique, mais comme une manière d’être vivant parmi d’autres et tissée à d’autres. L’ignorance des manières d’être vivant des autres qu’humains entraîne l’impossibilité de s’individuer soi-même comme une manière d’être vivant, et ainsi de se percevoir comme appartenant au vivant. On ne peut dès lors se sentir qu’étranger de passage parmi eux. Frances Theodora Parsons nous montre ici quelles allures peut prendre une culture du vivant, dans laquelle la connaissance du vivant relie, plutôt qu’elle ne sépare. Où l’on se sent chaque jour devenir un peu plus quelqu’un, un autre soi-même, noué aux autres vivants que soi.
À propos de l'autrice
Normalienne et docteure en histoire de l’art, Estelle Zhong Mengual enseigne à Sciences Po et aux Beaux-Arts de Paris. Elle est l'auteure de L'Art en commun (Presses du Réel, 2019) et co-auteure de Esthétique de la rencontre (Seuil, 2018). Son prochain livre,Apprendre à voir. Le vivant dans l’œil des peintres et des naturalistes, est paru chez Actes Sud en 2021.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don