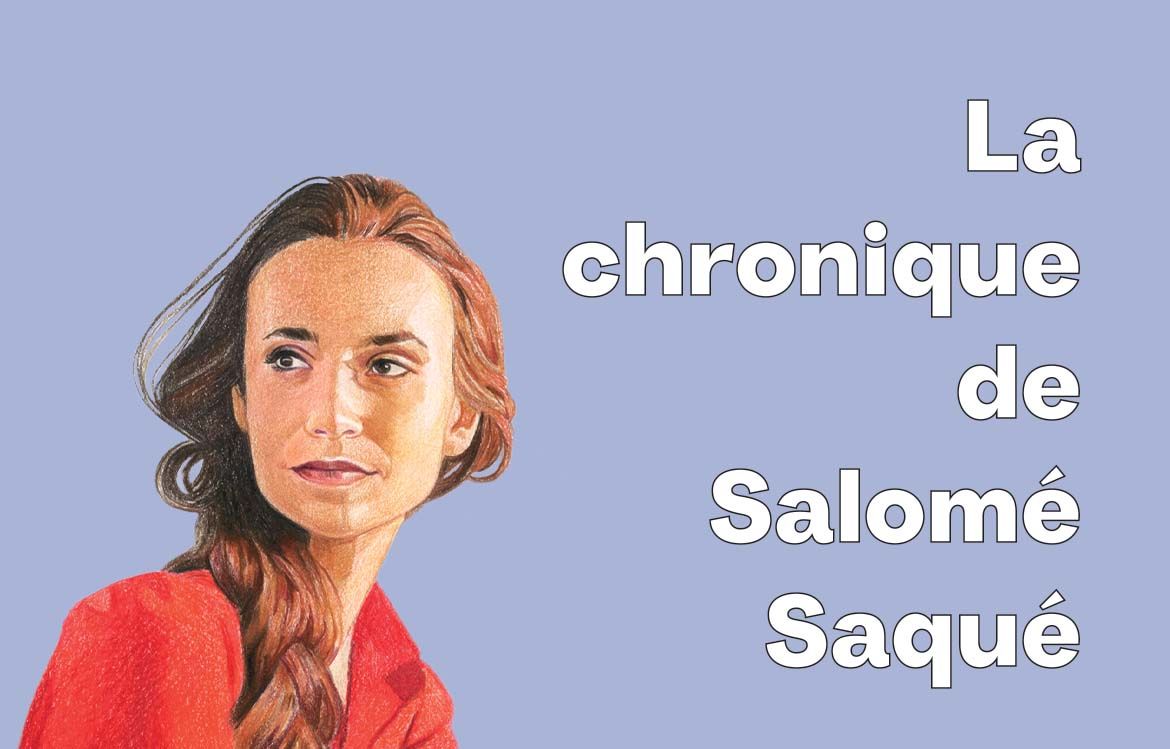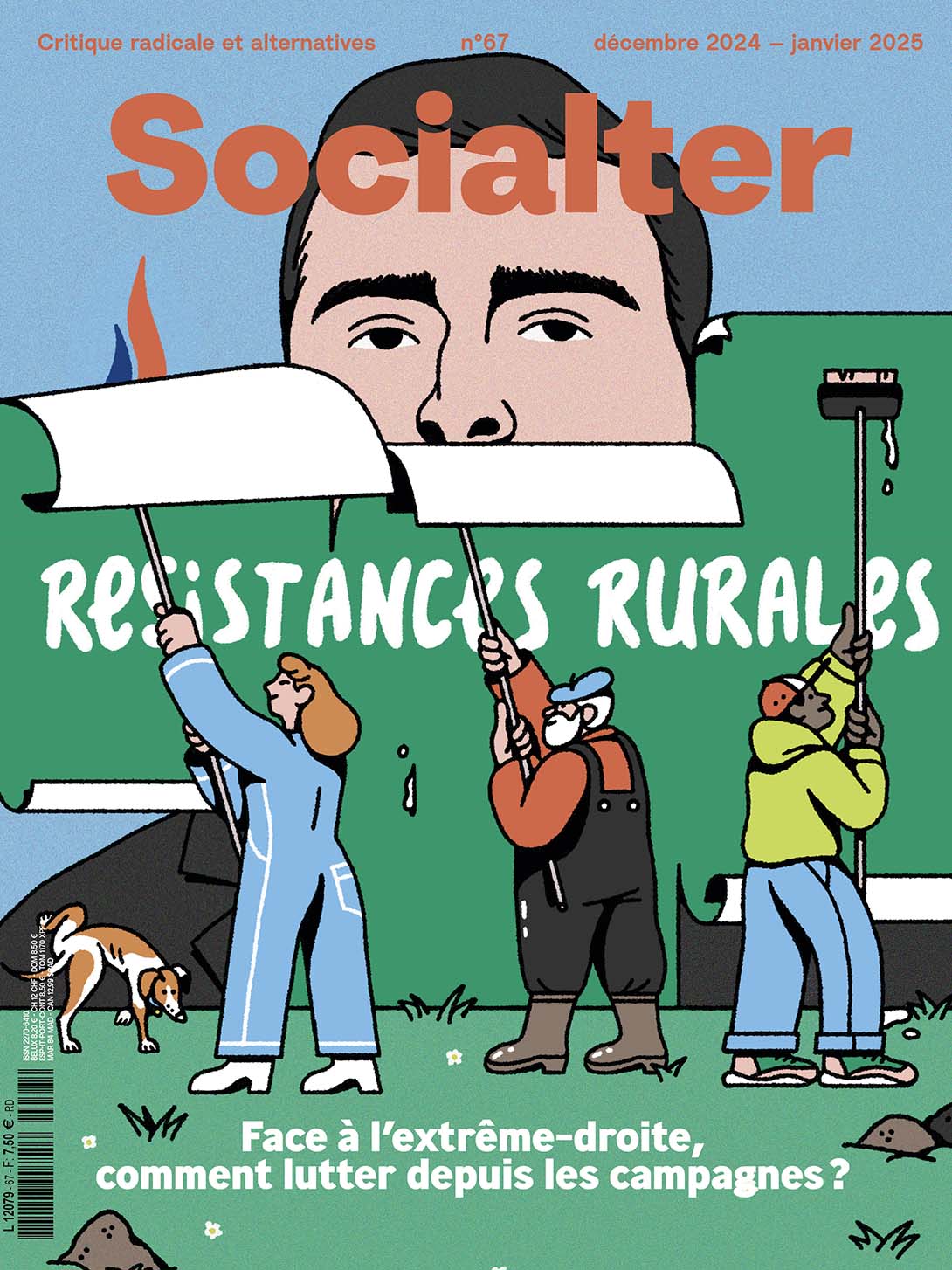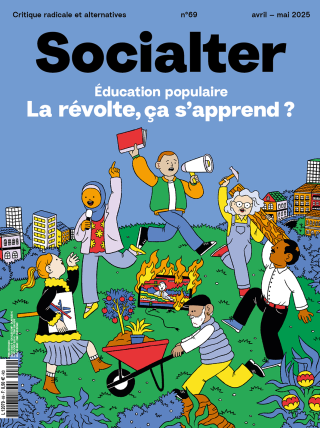Imaginez : vous sortez du lit un matin, prenez votre café, quand des hordes de gens se postent devant votre fenêtre et se mettent à vous insulter.
Certains profèrent des menaces, d’autres vous dénigrent en inventant n’importe quoi à votre sujet. Imaginez vous défendre pour que cela cesse, mais votre voix peine à émerger face au bruit de la foule déchaînée. Ces inconnus sont là, ils s’époumonent, créent un brouhaha d’injures et de diffamation qui enveloppe tout. Tout à coup, le téléphone sonne, l’un de vos employeurs vous appelle et vous demande, « mais c’est vrai ce que ces gens crient sur toi dans la rue ? ».
Chronique issue de notre n°67 « Résistances rurales », disponible en kiosque, en librairies et sur notre boutique.
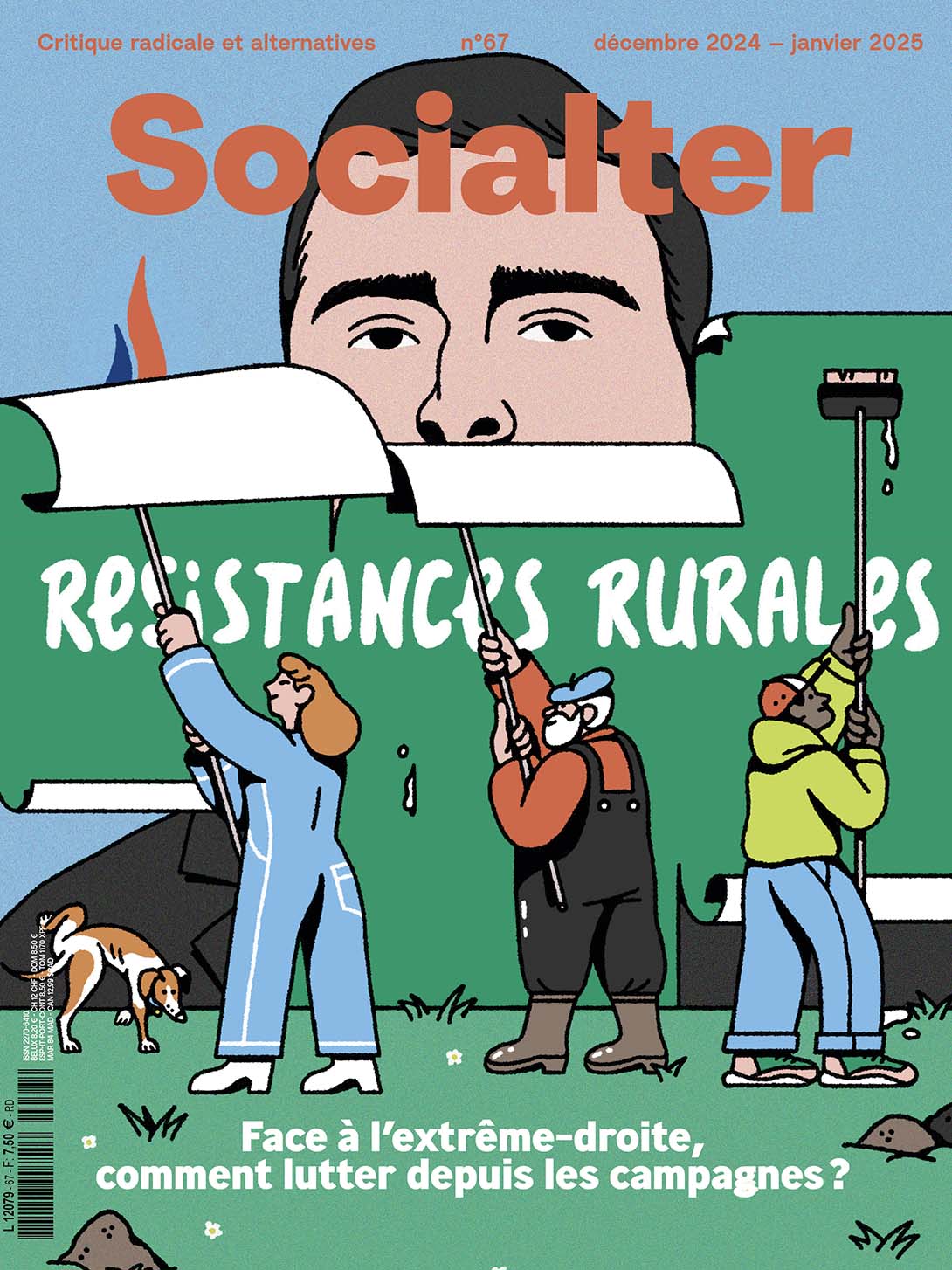
Des insultes quotidiennes
Ça, c’est mon expérience de journaliste avec Internet. Ma fenêtre, ce sont les réseaux sociaux. Depuis ma toute première émission en ligne il y a sept ans, je suis insultée, dénigrée, lynchée publiquement. Régulièrement. Certaines calomnies répandues de manière coordonnée finissent même par semer le doute sur ma crédibilité dans mon milieu professionnel. Un état de fait que je dénonce inlassablement depuis plusieurs années, en vain. Passé la vague éphémère de compassion, ça recommence, encore et encore, avec une intensité toujours plus vive.
Et le pire, c’est que je m’y suis accoutumée. Me faire traiter de « salope » ou de « pute » au lever du lit ne me fait presque plus rien. Lire « connasse », « va crever », « toi tu vas voir le jour de la purge », « je vais t’enculer », ça fait partie du job, c’est comme ça. Parfois, on crée de fausses images pornographiques avec mon visage ou on essaie de pirater mes comptes. Je suis désormais parée, je regarde le moins possible, j’ai développé mille stratégies pour m’habituer à être dégradée et menacée sans vaciller, c’était ça ou abandonner mon rêve de journalisme. Mon histoire n’a absolument rien d’exceptionnel, je ne suis pas plus visée qu’une autre, j’ai comme toutes les femmes qui s’expriment dans l’espace public – quelles que soient leurs opinions – trouvé des moyens pour composer avec cette situation.
Seulement tout l’objet de cet article est d’essayer de vous faire comprendre que ce n’est pas parce que c’est banal que c’est normal. Le cyberharcèlement n’est pas seulement virtuel, il est réel, ses conséquences sont physiques, concrètes.
Plongée au cœur d’une vague de haine
Pour ceux qui ne l’ont pas vécu, laissez-moi vous décrire ce que l’on ressent la première fois que l’on subit une vague de haine. C’est comme si vous receviez un énorme coup de poing dans le ventre, le souffle coupé, le cœur qui bat à 10 000 à l’heure, les larmes qui montent inexplicablement aux yeux, l’envie de vomir, l’impression que tout s’effondre et que vous allez crever. Vous essayez de vous reprendre, vous coupez le réseau où tout a commencé, désinstallez l’application, et voilà que la horde vous suit ailleurs, parfois jusque dans vos SMS.
« Le cyberharcèlement n’est pas seulement virtuel, il est réel, ses conséquences sont physiques, concrètes. »
Alors vous mettez le téléphone ou l’ordinateur de côté, coupez tout, mais les voix assassines résonnent encore dans votre tête, vous imaginez l’ampleur que le rabaissement public prend en votre absence et c’est presque pire. Vous vous demandez si c’est la fin de votre carrière, de votre vie. Votre entourage vous dit « mais calme-toi enfin, tu surréagis », mais vous, vous ne pensez plus qu’à ça, vous n’arrivez plus à vous défaire de la sensation de ces insultes sur votre peau, ni de la peur viscérale que les menaces se transforment en actes et que ces gens viennent vous tuer pour de vrai.
Au bout de quelques jours, 48 heures généralement, le tourbillon s’amenuise. Un matin vous vous réveillez et Internet est passé à autre chose, le beau temps après la tempête, c’est d’ailleurs pour cette raison qu’on parle de shitstorm, « tempête de merde » en anglais. Les gens ont déjà oublié, mais vous, vous êtes hanté par l’angoisse que ça recommence et ne pouvez plus dormir. Vous n’en parlez à personne parce que ça semble un peu ridicule de prendre des somnifères à cause d’un réseau social.
C’est exactement ce qu’il m’est arrivé à 23 ans, lorsque j’ai dû faire face, journaliste novice, à ma première vague de haine – le début d’une longue série. À l’époque je n’ai rien dénoncé du tout, comme beaucoup, j’ai pensé que le problème venait de moi, que j’étais simplement trop faible et trop sensible. Au niveau médiatique, on décrit souvent ces bûchers modernes comme des histoires individuelles, contextuelles. On titre rarement « elle est violemment cyberharcelée », on dit plus souvent « elle provoque la colère des internautes », ou « polémique autour de la vidéo de… ». Au mieux, on parle d’un cas unique de cyberharcèlement comme d’une fatalité ponctuelle, en évacuant la gravité du phénomène, ainsi que sa dimension collective.
Un problème systémique
Car il s’agit bien là d’un problème structurel face auquel les femmes et les minorités sont naturellement en première ligne. Chacun se croit trop faible de son côté, mais beaucoup sont plongés dans un état de grave détresse. Un tiers des femmes journalistes pensent à abandonner leur carrière à cause du cyberharcèlement1. Sur les 35 créateurs de contenu d’information en ligne les plus suivis à travers le monde en 2024, 34 sont des hommes. Sur les 230 chaînes les plus suivies sur YouTube France2, tous domaines confondus, 18 % seulement sont tenues par des femmes.
Pourquoi ? Car lorsqu’elles s’exposent, quelle que soit leur profession, elles se font fracasser publiquement, à coup sûr, à un moment ou à un autre. Artistes, politiques, scientifiques, influenceuses, sportives… Même traitement. En décembre 2024, la neuroscientifique Samah Karaki expliquait se sentir en « insécurité constante » après un passage télé où elle parlait de sciences cognitives qui lui avait valu d’être lynchée et menacée pendant plusieurs jours. Elle confiait avoir par conséquent annulé certaines de ses interventions.
Le cyberharcèlement ne touche pas que les femmes exposées publiquement, il peut détruire la vie d’anonymes qui sont encore moins outillées pour y faire face. Globalement, les femmes ont 27 fois plus de probabilité d’être harcelées en ligne que les hommes3. Les conséquences psychiques sont de plus en plus documentées, notamment les risques d’anxiété, d’insomnie et de dépression. Dans les cas les plus graves, cela peut provoquer le suicide, notamment chez les enfants ou les adolescents.
Ainsi, en 2021, Juliette met fin à ses jours à l’âge de 15 ans suite à un épisode de cyberharcèlement, sans que les autorités n’aient pour l’instant pu en identifier les auteurs4. 60 % des jeunes de 18 à 25 ans5 ont été victimes de haine en ligne et la moitié d’entre eux ont alors pensé au suicide. Les personnes issues de minorités ethniques, religieuses, ou appartenant à la communauté LGBTQIA+ sont elles aussi particulièrement visées. Les statistiques sont moins nombreuses sur le sujet, mais une étude internationale commandée par l’Unesco6 montre que quand 64 % des journalistes blanches déclarent avoir subi des violences en ligne, ce taux bondit à 81 % pour les journalistes noires. Les attaques en ligne ont touché 72 % des journalistes hétérosexuelles contre 88 % des journalistes lesbiennes.
Endiguer le harcèlement une bonne fois pour toutes
Bref, sur Internet comme ailleurs, les plus vulnérables sont en ligne de mire. Là où les réseaux sociaux étaient censés être un espace où l’on peut s’exprimer librement, ils deviennent à certains endroits un lieu d’oppression où l’on persécute, bâillonne, silencie, pousse au suicide. Résultat, le droit à l’expression, voire à la production de contenu, est surtout réservé à ceux qui n’ont pas à faire face à tant de haine organisée. Pour endiguer ce fléau, la loi prévoit déjà de sanctionner le cyber-harcèlement en France, mais les procédures sont longues, compliquées, et aboutissent rarement.
En attendant, les nombreuses victimes sont bien seules pour affronter cette violence encore banalisée, alors c’est à nous de sensibiliser, d’éduquer, d’informer. Posez-vous la question avant de poster un commentaire négatif : est-il vraiment utile et constructif ? Ou participe-t-il… à du cyberharcèlement ?
1. Selon le collectif « Coalition against online violence ».
2. Garance Bailly, « Le YouTube Game, un boys’ club fermé aux femmes », Stratégies, 1er mars 2024.
3. «#HerNetHerRights», étude européenne du lobby européen des femmes, 2017.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don