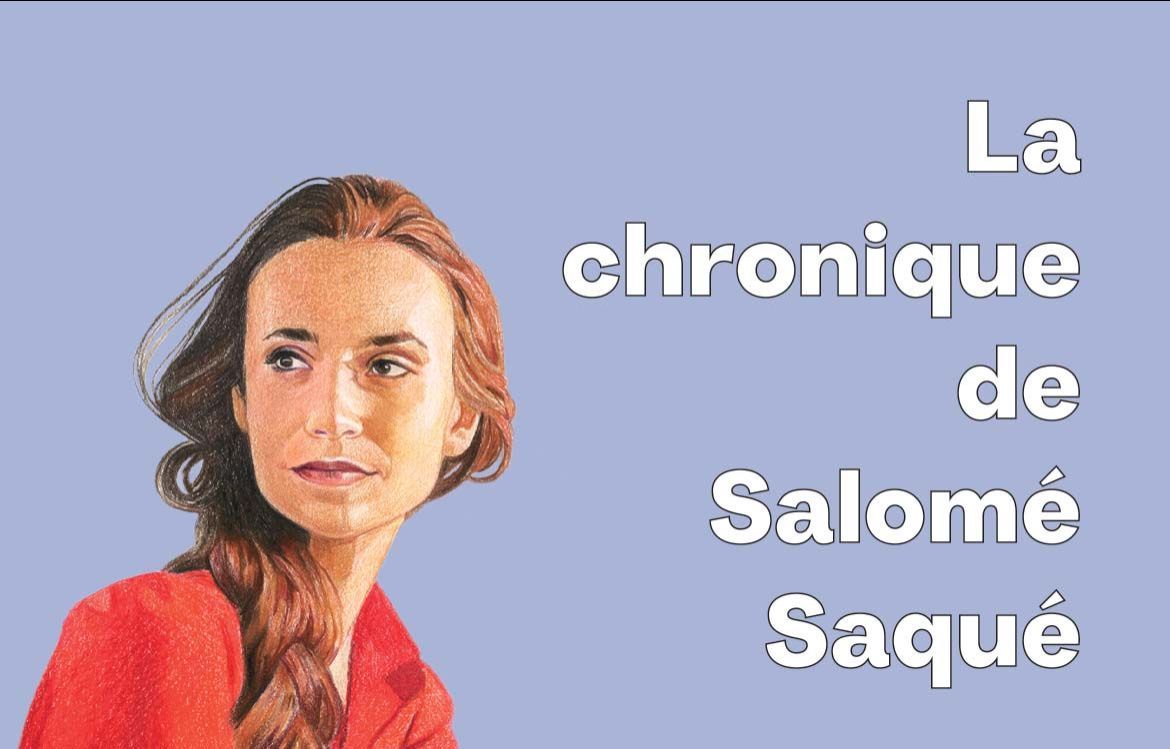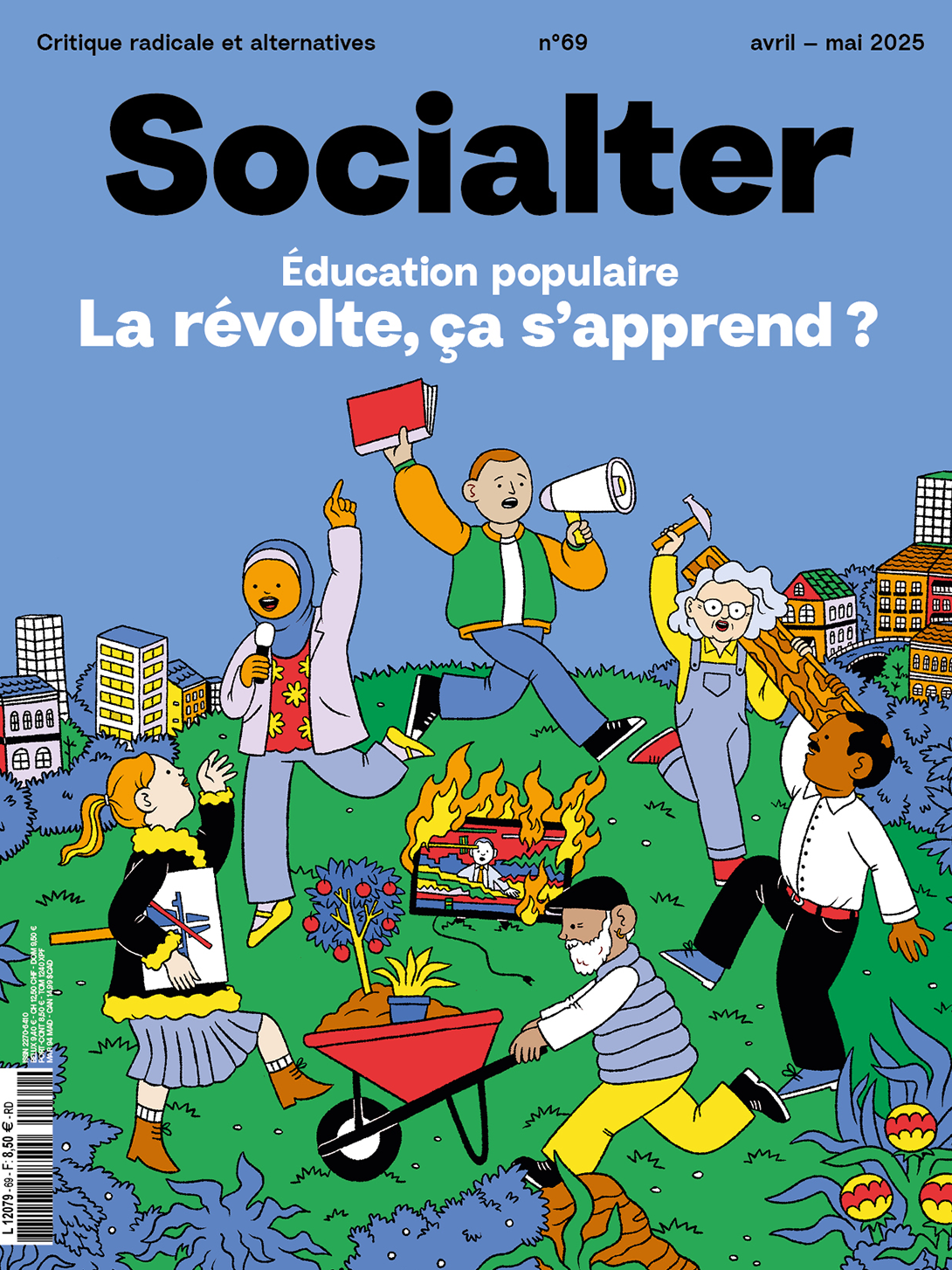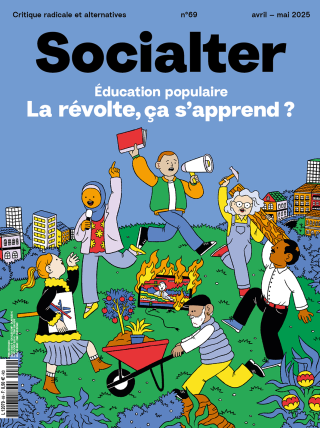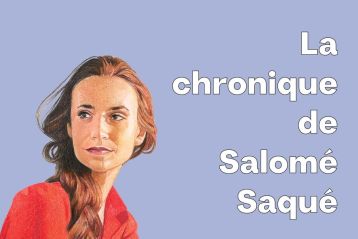J’ai grandi dans un pays où l’on enseigne longuement à l’école les ravages du fascisme au XXe siècle. D’une certaine façon, il se crée une distance confortable face à cette histoire.
Ce n’était pas « nous ». C’était un autre peuple. Une humanité voisine mais étrangère, qui aurait failli. Cette période interroge bon nombre d’entre nous : comment des sociétés entières ont-elles pu à ce point glisser, tolérer l’intolérable ? Depuis un pays en paix, à l’orée du XXIe siècle, dans un État de droit, cela m’a longtemps paru absurde, incompréhensible.
Et puis Elon Musk a fait un salut nazi. Et une partie de la presse a hésité à le qualifier ainsi. Il s’agissait pourtant du signe annonciateur d’une longue série de mesures plus autoritaires les unes que les autres, que beaucoup refusent encore de désigner ainsi. Parce qu’on a peur de surjouer, de « faire un point Godwin », d’exagérer. Le camp des modérés serait celui qui ne sort pas les grands mots, qui évite les concepts lourds pour parler de dirigeants occidentaux, qui contourne la référence à « la période la plus sombre de l’Histoire ».
Alors « fascisme » ? Ce mot-là, surtout pas. Il serait trop violent, trop définitif, trop accusateur. Un mot de « militant », pas d’analyste. Et pourtant. Ce qu’on voit aujourd’hui – aux États-Unis, mais aussi ailleurs – nécessite que l’on nomme.
Chronique de notre n°69 « Éducation populaire », disponible en kiosque, sur notre boutique et sur abonnement.
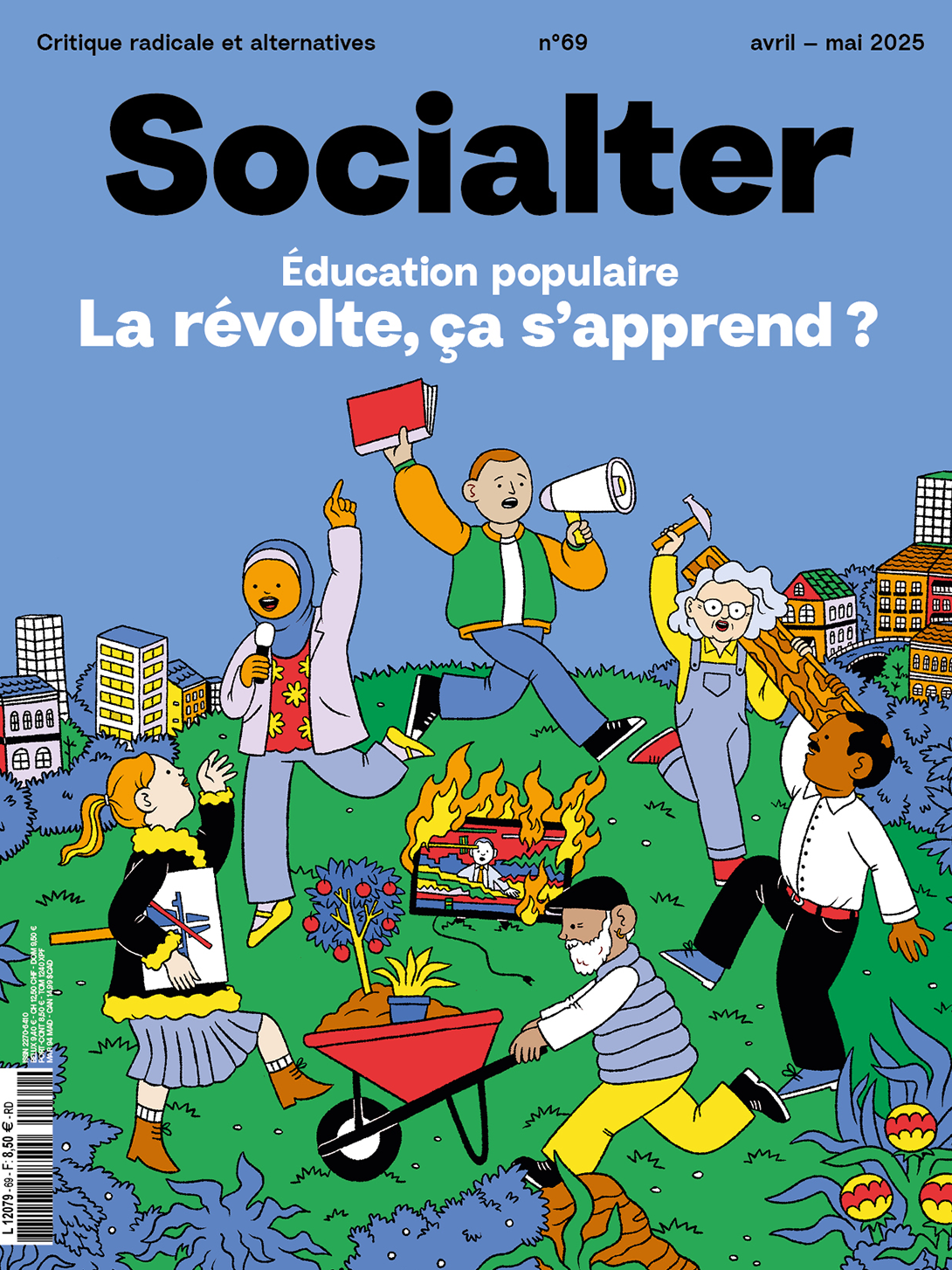
Reconnaître le monstre : Umberto Eco et l’Ur-fascisme
Umberto Eco, intellectuel italien qui a connu enfant le régime de Mussolini, publie en 1995 un texte devenu une référence mondiale : Reconnaître le fascisme (Grasset, 2024). Il y propose une grille de lecture accessible à tous de la montée rampante de ce qu’il appelle l’Ur-fascisme – le fascisme « éternel », ou plutôt réactivable à tout moment. Il ne donne pas une définition figée du fascisme mais dresse un faisceau de ses caractéristiques, un spectre mobile. Il prévient : une seule d’entre elles suffit à enclencher la mécanique. Or le trumpisme ne se contente pas d’en activer une ou deux. Il coche la quasi-totalité des quatorze cases.
Parmi ces caractéristiques, le culte de la tradition. Trump promet un retour à la « vraie Amérique » : celle d’avant les droits civiques, avant les mouvements féministes. Une Amérique figée dans un passé fantasmé, pétrie de racisme et de virilisme. Deux autres grands traits sont soulevés par Eco : la suspicion envers le monde intellectuel, et le refus du rationalisme. Or le président des États-Unis a érigé l’irrationalité en méthode : les éoliennes causeraient le cancer, la crise climatique ne serait qu’une lubie de gauche, voire un complot chinois, et la science, un obstacle au « bon sens ».
Ce n’est pas une déduction ou une interprétation de journaliste, c’est une doctrine assumée. Son vice-président J.D. Vance le déclarait dès 2021 : « les universités sont l’ennemi » et depuis le mois de janvier le gouvernement mène une politique répressive sans précédent envers le monde académique. Une très longue liste de termes tels que « climat » ou « femme » a été proscrite dans la recherche et les administrations, de nombreux scientifiques ont été brutalement licenciés, les musées sont « désendoctrinés », alors que le ministère de l’éducation nationale a tout bonnement été… supprimé.
L’ennemi du gouvernement Trump est désigné : le savoir. On pourrait rajouter parmi les critères d’Umberto Eco l’obsession du complot – alors que le président des États-Unis ne cesse d’invoquer une élection volée en 2020 et a carrément nommé à la tête du FBI une des figures du complotisme américain – ou la peur de la différence, à l’heure de l’explosion des discours et politiques xénophobes et racistes. Reste d’autres traits qui font particulièrement écho aujourd’hui : l’usage d’une novlangue (pauvreté lexicale, slogans martelés, destruction du langage complexe), l’appel aux classes moyennes frustrées ou le mépris pour les faibles.
Ce petit livre décrit avec une précision stupéfiante le trumpisme, avant même que celui-ci n’existe, et connaît d’ailleurs un regain de succès dans les librairies ces derniers mois. Trump n’est ni Hitler ni Mussolini. Mais il incarne ce qu’Eco décrivait il y a déjà plusieurs décennies : un fascisme mutant, sans uniforme ni croix gammée, mais avec les mêmes fondations émotionnelles et politiques.
Une dérive mondiale
Si l’on est en désaccord avec la grille de lecture d’Eco, regardons ce que disent les historiens. L’Étatsunien Robert Paxton, sommité en ce qui concerne le régime de Vichy, et qui a toujours refusé de qualifier Trump de fasciste, a franchi le pas en 2024 : pour lui, Trump incarne une forme avérée de fascisme. Et il n’est pas le seul. De nombreux historiens de renommée mondiale font désormais la comparaison avec les années 1930 et n’hésitent pas, eux non plus, à utiliser ce terme. Federico Finchelstein1, Timothy Snyder2, ou encore Ruth Ben-Ghiat3 : la liste est longue, et plus le temps passe, plus les spécialistes s’accordent à employer le mot « fascisme ». D’autres utilisent aussi les termes autoritarisme ou dictature.
Trump n’est ni Hitler ni Mussolini. Mais il incarne ce qu’Eco décrivait il y a déjà plusieurs décennies : un fascisme mutant, sans uniforme ni croix gammée, mais avec les mêmes fondations émotionnelles et politiques.
Mais à quoi cela servent-ils ces mots ? Avant tout à tirer une sonnette d’alarme. Qualifier, nommer, c’est permettre un sursaut. Si nous ne sommes pas, pour la plupart d’entre nous spécialistes, nous savons tous que le « fascisme » désigne quelque chose de dangereux. Et le moins que l’on puisse dire aujourd’hui, c’est qu’il y a urgence à reconnaître le péril majeur pour les démocraties et les droits humains en 2025. Si l’on peut toujours discuter de l’emploi de grands concepts politiques, on ne peut nier la destruction démocratique en cours, la banalisation de la violence qui en découle, et son expansion à travers le monde, y compris en France.
Et il est essentiel d’arriver à une prise de conscience collective, car les critères d’Umberto Eco peuvent être appliqués à de nombreux partis politiques en Amérique latine (notamment au parti au pouvoir en Argentine) ou en Europe. C’est ce que s’évertuent à rappeler l’historien français spécialiste du nazisme Johann Chapoutot depuis déjà plusieurs années, ou encore le philosophe Michaël Foessel dans son livre Récidive, 1938 (PUF, 2021).
Le retour des années 30 ?
Alors peut-on vraiment comparer la période actuelle aux années 1930 ? Oui et non. Comparer oui, car c’est le propre de l’histoire d’établir des parallèles, mais certainement pas y voir une réplique exacte. Car il existe de très nombreuses différences entre les époques. Cette comparaison est un réflexe politique et mémoriel : on revient aux années 1930 parce qu’elles structurent notre imaginaire du basculement politique, et parce que nous pouvons relever de nombreux points communs avec cette période.
À commencer par la remise en cause du droit international, notamment du côté du trumpisme. C’est ce qu’explique Olivier de Frouville, professeur à l’université Paris Panthéon-Assas et directeur du Centre de recherche sur les droits de l’Homme et le Droit humanitaire (CRDH) dans les colonnes du journal La Croix4 : « L’analogie avec les années 1930 n’est pas vaine ni inutile, notamment parce que, dans les deux cas, le droit international se retrouve en ligne de mire. (…) À part de rares États voyous comme la Corée du Nord ou l’Afghanistan des talibans, aucun gouvernement n’avait jamais affiché un tel mépris décomplexé pour les principes juridiques fondamentaux établis après la Seconde Guerre mondiale. »
Et ce n’est que l’un des aspects. George Orwell à la fin des années 1940 mettait déjà en garde sur les manières dont le fascisme peut ressurgir à tout moment avec de nouveaux apparats, en « chapeau melon et parapluie roulé ». Celui d’aujourd’hui a plutôt des cheveux blond platine. L’histoire ne se répète jamais à l’identique : elle récidive dans d’autres formes, d’autres contextes. Encore faut-il avoir les mots pour alerter et réagir à temps.
Notes
1.The Wannabe Fascists, A Guide to Understanding the Greatest Threat to Democracy, UC Press, 2024.
2. « What Does It Mean That Donald Trump Is a Fascist? », The New Yorker, 8 novembre 2024.
3. « Ruth Ben-Ghiat, historienne : “Les Italiens ont eu Mussolini, nous avons Trump” », Le Nouvel Obs, 18 octobre 2024. Elle y explique notamment : « Trump a habilement conditionné les électeurs à accepter la violence, ce qui est une caractéristique du fascisme. [...] Selon le relevé de mon assistant de recherche, Trump a fait l’éloge de dictateurs plus de soixante fois en un an ! »
4. « Trump coche presque toutes les cases du “fascisme fondamental” », La Croix, 5 mars 2025.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don