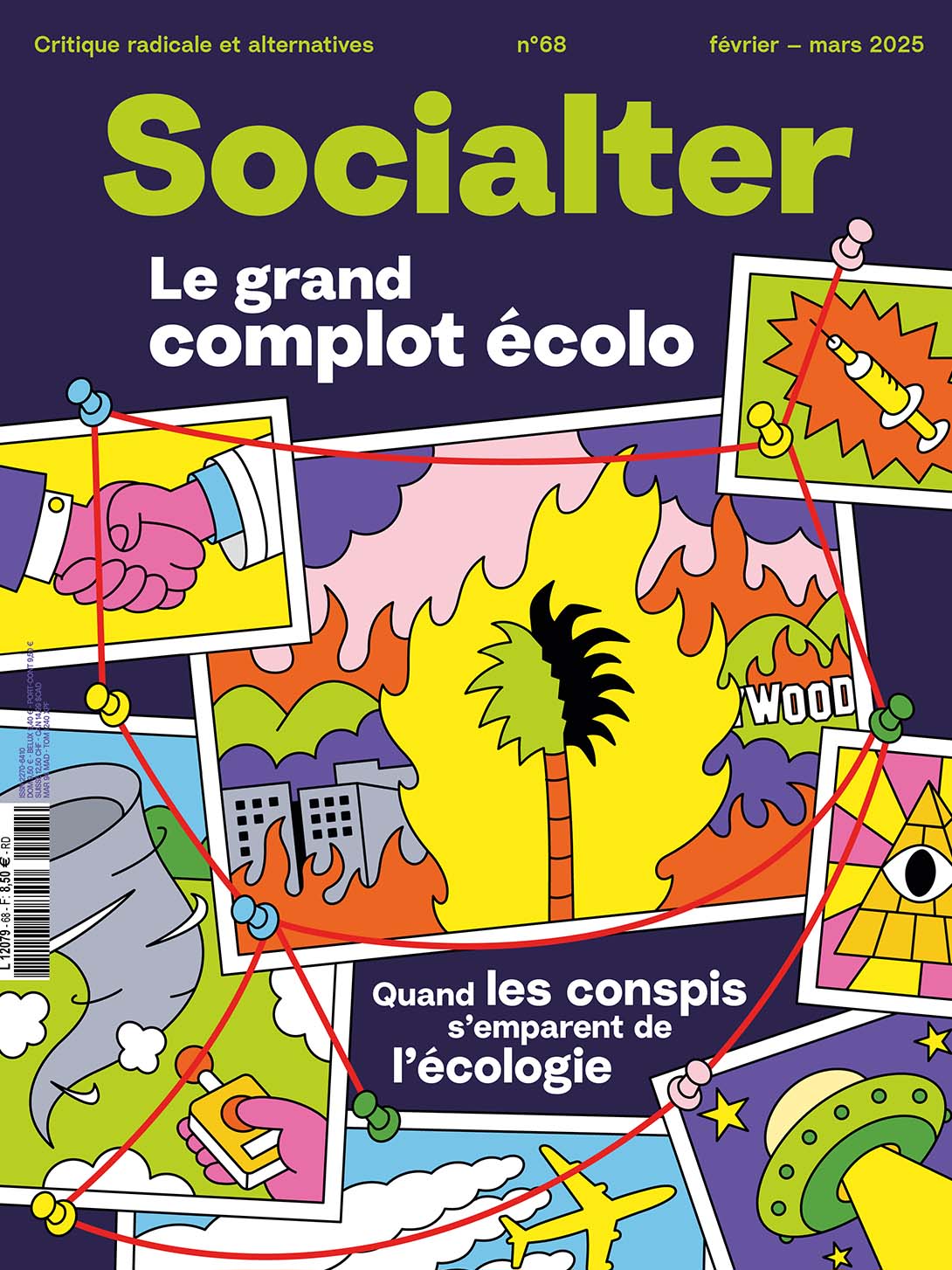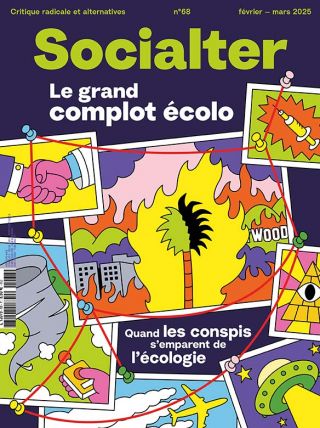Qui sont les Scientifiques en rébellion ?
Léa Bonnefoy, astrophysicienne Le collectif Scientifiques en rébellion est né à la suite de la publication d’un appel de plus de 1 000 scientifiques dans Le Monde en février 20201, qui encourageaient leurs pairs à s’engager. Il compte aujourd’hui environ 500 membres de 18 à 70 ans, et 3 700 sympathisants, avec des domaines de compétence variés, qui dépassent les seules sciences climatiques : on retrouve des spécialistes de l’économie, de la médecine, de l’enseignement et de la vulgarisation scientifique.
Dulca, écologue Nous essayons d’aller vers une multidisciplinarité. Pour l’instant, seuls 10 % de nos membres sont issus des sciences humaines et sociales. C’est pourtant un domaine clé pour la compréhension de la crise écologique. La transition écologique ne peut pas se faire sans être sociale et juste. La société est traversée d’inégalités de classes, de genres, de races. Comme d’autres collectifs, nous souhaitons une convergence des luttes avec une approche intersectionnelle2.
Article de notre n°68 « Le grand complot écolo », disponible en kiosque, en librairies et sur abonnement.
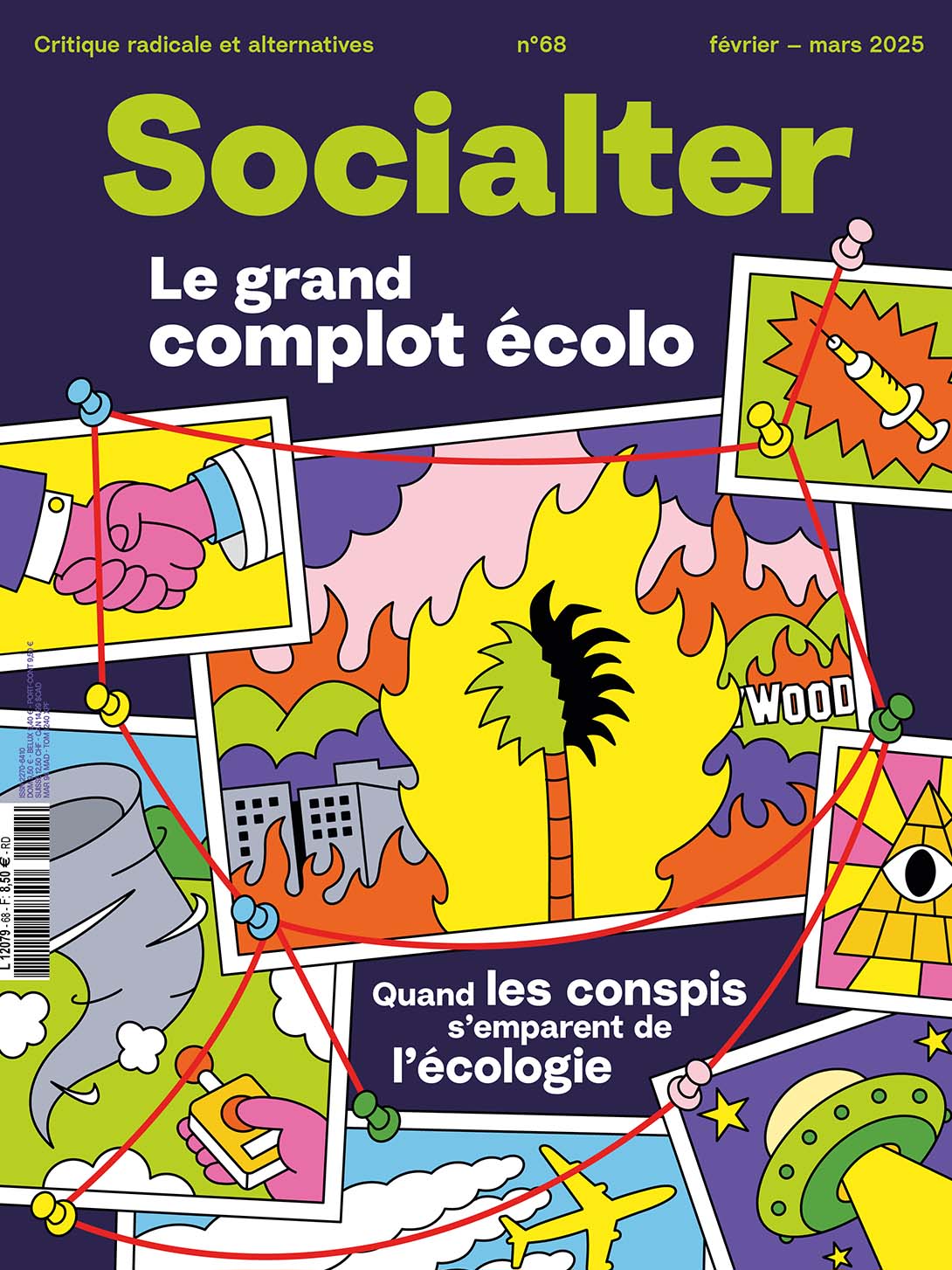
Pourquoi vous a-t-il semblé nécessaire d’intervenir en tant que scientifiques dans les luttes en faveur de la préservation du climat et de l’environnement ?
L B De nombreux scientifiques alertent depuis longtemps sur le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité, mais il ne se passe toujours rien de vraiment concret. Alerter ne suffit pas, il faut aller plus loin.
D Nous ressentons la responsabilité d’agir car nous avons constamment sous les yeux des chiffres, des résultats d’études, comme l’impact des pesticides sur certaines populations d’oiseaux ou d’insectes par exemple. Il y a une dissonance cognitive qui se crée entre notre quotidien de chercheuses et la crise écologique. Nous avons tendance à être plutôt fatalistes, avec l’impression que rien n’aboutit. Nous voyons bien les limites des manifestations dans un cadre légal ou purement académique.
De quelle manière entrez-vous en rébellion ?
L B Nous nous sommes fait connaître par le recours à la désobéissance civile non violente mais nous ne faisons pas que ça. Nous écrivons de nombreuses tribunes, organisons des conférences, des tables rondes. Nous soutenons d’autres collectifs, comme les Soulèvements de la Terre sur la campagne contre l’empire Bolloré, et nous participons à des manifestations, notamment contre les mégabassines ou l’A69.
Souvent, les collectifs militants font appel à nous pour apporter une expertise, mais en général, ils ont déjà une excellente connaissance scientifique de l’objet de leur lutte. Nous bénéficions d’une excellente visibilité, d’une crédibilité et d’une très bonne image auprès du public et des médias, alors que d’autres mouvements sont peut-être davantage décrédibilisés et affublés de stéréotypes, voire insultés.
D Dans la plupart de nos actions, il y a une prise de parole en blouse blanche pour rappeler les consensus scientifiques sur le thème de l’action. Nous pouvons aussi témoigner pour des militants en procès en raison d’actions. Nous avons la chance d’avoir accès à de nombreux résultats d’études, à la connaissance, et nous avons un devoir de les partager. Nous voulons utiliser la confiance que le public nous accorde pour alerter et être entendus par les médias. La blouse blanche a pu être mal interprétée, comme une posture d’autorité, de sachant. C’est un symbole pour nous, afin d’être identifiés.
Quelles ont été les actions les plus marquantes du collectif ?
L B Nous avons par exemple occupé la galerie de paléontologie du Museum national d’histoire naturelle de Paris, en avril 2022, pour mettre en lumière la crise de la biodiversité. C’était non violent, les militants sont entrés en payant leur ticket, ils sont seulement restés au-delà des heures de fermeture pour donner des conférences retransmises en ligne. Le Museum a porté plainte, non pas pour une quelconque dégradation car il n’y en a pas eu, mais pour les frais engagés afin de payer les gardiens plus longtemps.
« Nous voulons une science robuste, fiable, sourcée, rigoureuse, mais pas une science “neutre”. »
À l’occasion de la COP 28 en 2023, nous avions organisé une COP alternative citoyenne à Bordeaux, en invitant les gens à discuter et s’emparer avec nous de diverses thématiques plutôt que de les laisser à certains gouvernements, aux lobbyistes et aux experts. C’est une expérience très intéressante, très productive.
Nous avons également des groupes locaux qui travaillent sur les enjeux de leur territoire. À Grenoble par exemple, notre groupe local composé d’une dizaine de scientifiques a fait une manifestation festive et installé un faux pipeline devant l’entreprise Schneider Electric, pour dénoncer leur participation au projet Eacop. En amont de l’action, nous avons rencontré les employés de l’entreprise pour leur parler des enjeux de ce projet, et il y a eu un certain soutien de leur part pour l’action.
Quels rapports entretenez-vous avec le mouvement international Scientist Rebellion ?
L B Nous nous rejoignons pour des actions et des campagnes internationales. En 2022, nous avions mené des actions en Allemagne, notamment dans les locaux de Blackrock, et dans un showroom de BMW où des militants de Scientifiques en rébellion et d’autres collectifs ont collé leurs mains à des voitures. Certains ont été détenus jusqu’à six jours pour cela, et sont encore en procès avec le risque de lourdes amendes.
Quels sont les principaux objectifs que vous défendez en tant que scientifiques ?
D La sortie des énergies fossiles, l’arrêt des pesticides et de projets polluants ou inutiles. Nos principaux objectifs sont d’alerter sur les consensus scientifiques, de dénoncer les manipulations et contradictions politiques, d’encourager les bonnes pratiques en recherche, et d’instaurer par la désobéissance civile un rapport de force, notamment avec certaines entreprises ou institutions néfastes au vu de l’état actuel de la biodiversité3.

©Scientifiques en rébellion
L B Chaque année, Scientist Rebellion propose une ou deux campagnes thématiques que nous pouvons rejoindre. La dernière portait sur la décroissance, et auparavant sur les jets privés ou les énergies fossiles.
Certaines actions ont mené plusieurs membres de Scientifiques en rébellion à être arrêtés et traduits en justice. Quel rôle jouent ces procès ?
D Les procès font avancer les choses et peuvent amener à des changements de loi. Ils jouent un rôle important pour montrer la répression de l’État mais aussi le fait que le droit international est de notre côté. En effet, la désobéissance civile est reconnue et protégée. Pour les scientifiques entrés au Museum national d’histoire naturelle, et dans d’autres luttes écologistes, il y a parfois des relaxes au motif de l’état de nécessité4.
L B Si une maison brûle, le fait de casser une vitre et d’entrer par effraction pour sauver la vie de quelqu’un est autorisé. C’est ce qu’on appelle l’état de nécessité. Nous sommes face à une urgence écologique planétaire : les petites infractions que nous commettons sont justifiées pour tenter d’alerter. Et nos actions sont toujours non violentes. Il n’y a pas de raison que les scientifiques soient traités différemment des autres citoyens. Cela dit, comme l’a souligné le rapporteur de l’ONU Michel Forstlire Socialter n°63, il y a une répression des mouvements écologistes qui augmente et qui est disproportionnée.
Vous dénoncez le principe de neutralité scientifique. Pourquoi, et par quoi le remplacer ?
D Ce concept est sorti d’une conférence de Max Weber, « Le savant et le politique », qui a été mal traduite et mal interprétée selon Isabelle Kalinowski5. En tant que professeurs, nous ne pouvons évidemment pas influencer les élèves, mais nous sommes légitimes à défendre un point de vue et à nous engager, sans remettre en question notre rigueur scientifique ni la qualité de nos recherches.
Nous préférons parler de rigueur scientifique et de transparence. Le comité d’éthique du CNRS, le Comets, affirme dans un rapport que ce terme de neutralité est infondé et que l’engagement fait partie du rôle du scientifique. Nous voulons une science robuste, fiable, sourcée, rigoureuse, mais pas une science « neutre ».

COP 28 alternatives, novembre-décembre 2023.
L B La neutralité scientifique n’existe pas, elle n’est ni possible ni désirable. Nos recherches sont financées, orientées, nous avons des biais. Et quand la science mène à un résultat qui implique un changement de société, il est de notre devoir d’aller au bout du raisonnement. Si nous n’agissons pas alors que nous annonçons de nombreuses catastrophes climatiques, cela diminue notre crédibilité. Agir et s’engager, cela permet d’être plus cohérent avec notre pratique scientifique.
Comment vous positionnez-vous par rapport à l’institution scientifique, à vos collègues, vos étudiants ?
L B Pour certains, le fait d’être avec Scientifiques en rébellion se passe bien, pour d’autres moins, et des collègues ne vont tout simplement pas mentionner leur engagement. Quant à l’évolution de carrière, cela dépend. Une membre de Scientifiques en rébellion a récemment décroché un poste permanent alors que son appartenance au collectif était connue, donc ce n’est pas forcément un frein.
Beaucoup de nos collègues nous soutiennent sur le principe, face à l’urgence et la nécessité d’agir. En revanche, il est plus compliqué d’aborder la réorientation, la modification des pratiques dans l’enseignement et la recherche pour les rendre cohérentes avec un futur vivable. C’est une question difficile, que nous devons pourtant tous nous poser.
D Dans mon laboratoire d’écologie, le piège serait plutôt de créer une espèce d’entre-soi. Nous avons parfois l’impression d’être dans une bulle, d’être tous d’accord. Nous allons en manifestation ensemble. Mais être en collectif apporte énormément d’espoir, c’est stimulant. Et la lutte est joyeuse.
Sources
1. « L’appel de 1 000 scientifiques : “Face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire” », Le Monde, 20 février 2020.
2. Une approche tenant compte des différentes formes de dominations ou discriminations de genre, d’origine ethnique, de classe sociale, etc.
3. Scientifiques en rébellion, Sortir des labos pour défendre le vivant, éditions du Seuil, novembre 2024.
4. En procès pour avoir contesté les amendes qui leur avaient été délivrées après l’occupation du musée, plusieurs militants ont été relaxés en septembre 2024, au nom de l’état de nécessité, selon l’article 122-7 du Code pénal : « N’est pas responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »
5.La Science, profession et vocation, éditions Agone, 2005.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don