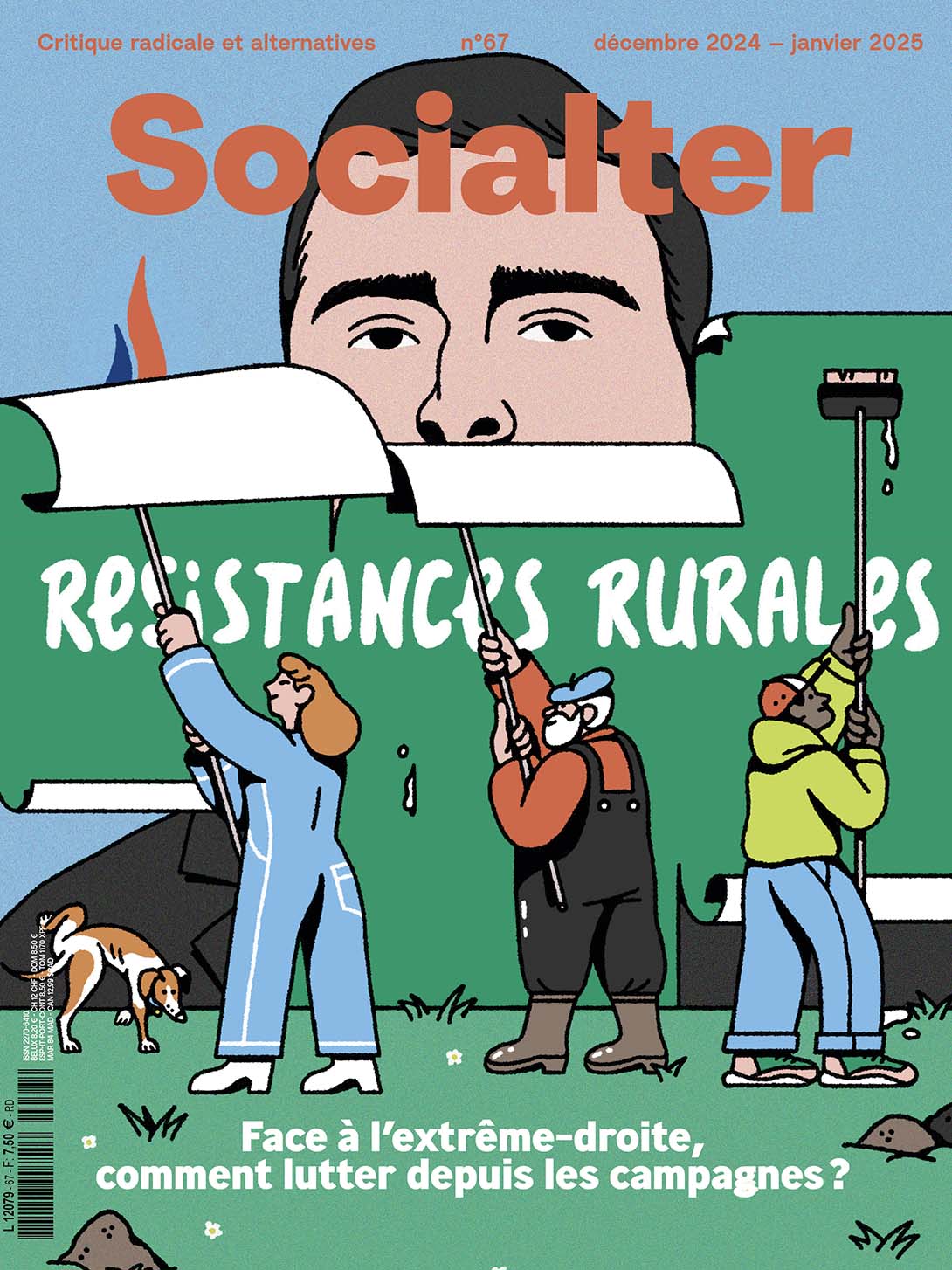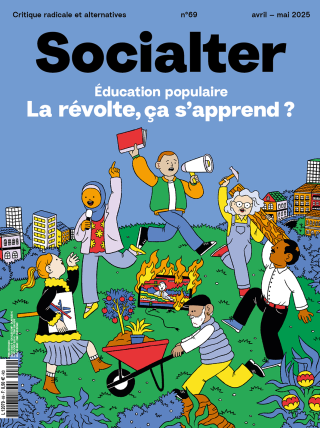Vous êtes installée en polyculture-élevage bio dans le Gers depuis des décennies. Et vous avez représenté récemment la Confédération paysanne, pour laquelle vous militez depuis vingt-cinq ans, à la COP16 sur la biodiversité en Colombie, dans le cadre du réseau international Via campesina1. La protection du vivant est-elle un moteur central de votre engagement ?
C’est plus qu’un moteur. En tant que paysans, la dégradation de l’environnement aboutit au fait que nous n’arrivons plus à produire. Sans pollinisation, vous n’arrivez tout simplement plus à féconder vos cultures. Sans biodiversité des insectes, vous vous retrouvez avec des moucherons qui transmettent des virus aux animaux. Et les conséquences d’un climat qui se réchauffe, c’est la dispersion d’un certain nombre de maladies que l’on ne voyait pas avant. Tous les ans nous avons un nouveau virus, parce que ces derniers trouvent des conditions favorables dans les élevages industriels.
Article issu de notre n°67 « Résistances rurales », disponible en librairies et sur notre boutique.
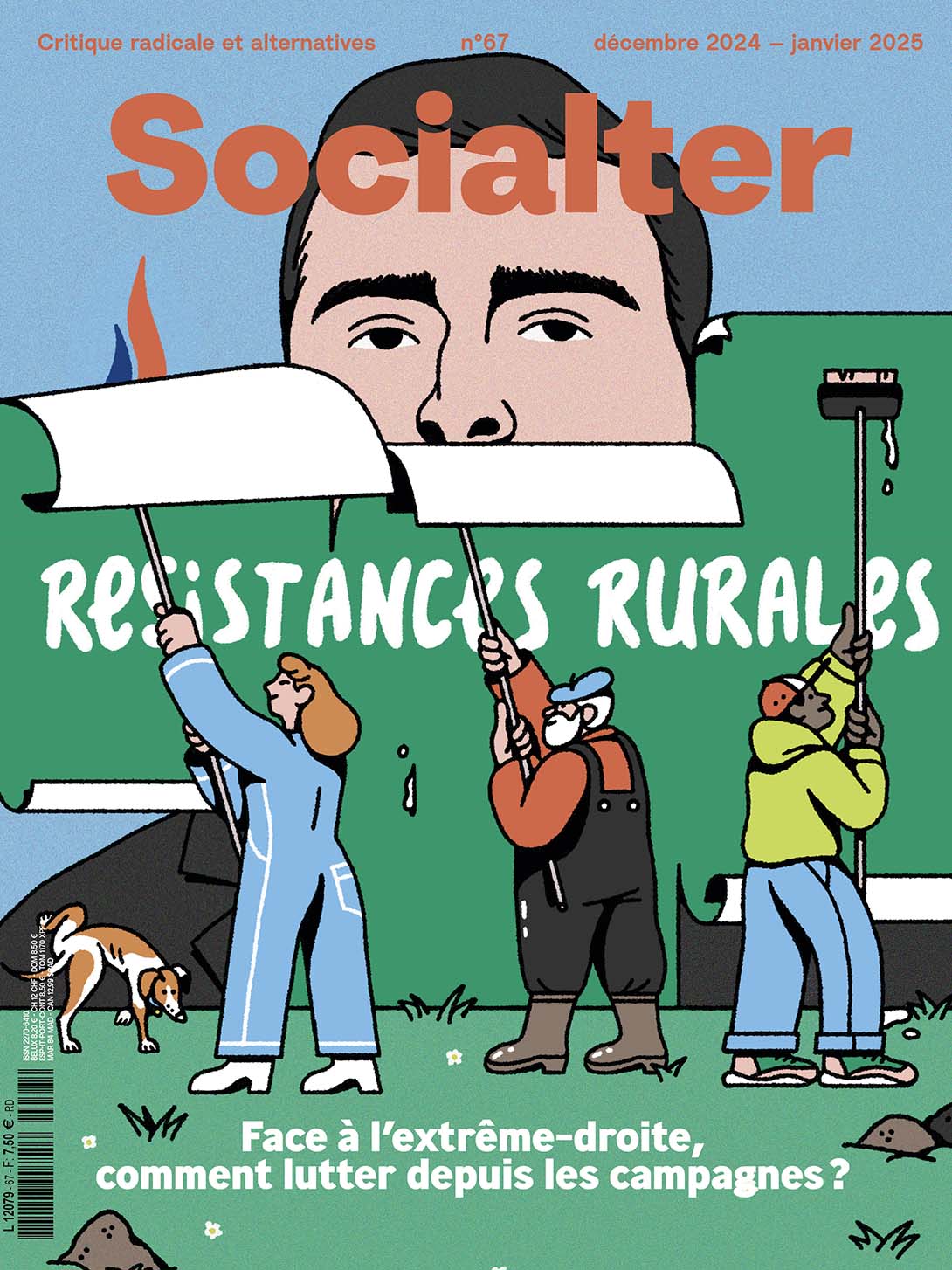
Quand un virus entre dans un élevage de 20 000 poules pondeuses, c’est une véritable bombe sanitaire. Il contamine toute la faune sauvage alentour. Aujourd’hui, les rendements en agriculture baissent dans toutes les régions. Cette année, nous allons perdre environ un tiers de l’élevage de moutons en France. Et tout cela contribue à l’abandon du métier. Il faut donc qu’on préserve nos zones humides, nos haies, nos forêts, nos oiseaux, pour conserver un équilibre. L’agriculture a été trop longtemps en guerre contre la nature.
Pourtant, l’importance donnée à la protection de la biodiversité semble aujourd’hui inaudible à toute une partie des agriculteurs, qui se braquent contre des normes qu’ils jugent excessives, comme on a pu le voir lors des dernières mobilisations agricoles.
Quand vous avez 55 ans, que vous êtes endetté, il est difficile de changer de modèle. C’est le vieux monde. Ces agriculteurs sont vieillissants. Ils ont la tête dans le guidon, ils sont endettés. C’est ce que je dis aux associations environnementales quand certains stigmatisent par exemple un agriculteur possédant un gros tracteur. Ce tracteur dont il semble si fier, en réalité, n’est même pas à lui : il l’a pris en leasing(2) et n’arrive plus à le payer. L’objectif d’avoir les meilleurs rendements et le tracteur le plus puissant a été inculqué à des générations d’agriculteurs. Et puis il y a aussi un désir de reconnaissance sociale au sein du monde paysan, qui s’est longtemps senti à l’écart de la société.

Aujourd’hui, quand les agriculteurs manifestent, c’est un baroud d’honneur pour dire qu’ils existent. Il y a un effondrement de notre métier. Comme il y a eu la désindustrialisation de la France, il y a aujourd’hui une disparition de l’agriculture. Les chiffres le montrent : on ne sera plus que 200 000 à 250 000 paysans en France en 2030-2035 [contre environ 400 000 aujourd’hui, NDLR].
Ce contexte social nourrit un désarroi, qui semble largement partagé dans les campagnes. Or, le RN est très habile à capter ce sentiment de déclassement. Est-ce que vous percevez la montée des discours d’extrême droite autour de vous ?
Dans le Gers, les gens ont finalement voté à gauche et au centre au second tour des législatives, mais au premier tour, dans quasiment tous les villages, le RN était devant. C’est terrible. Il y a un entre-soi de la ruralité, un manque d’ouverture d’esprit.
Certains expriment une crainte à l’égard des personnes issues de l’immigration pour justifier leur vote, alors qu’il n’y a pas d’étrangers dans le département et quasiment aucune personne racisée. Et par ailleurs beaucoup de Gersois ont des origines italiennes, espagnoles, belges, pied-noir... Le RN surfe sur la pauvreté et l’inculture – qui sont liées. Dans ce contexte, les discours populistes, faciles, trouvent un écho.
Y a-t-il à vos yeux un problème du côté des discours portés par la gauche et les écologistes ?
Les écologistes des villes ont peu de discours prenant en compte la situation des campagnes. Sandrine Rousseau [députée EELV de Paris, NDLR] dit par exemple qu’il faut interdire tous les véhicules au diesel et prendre les transports en commun. Mais pour prendre mon bus je dois demander à mon voisin de me déposer à l’arrêt qui est à trois kilomètres de chez moi ! Cela pose une vraie question d’aménagement du territoire. Par ailleurs, dans la ruralité, il y a peu de cadres, les habitants sont des ouvriers, de petits commerçants, de petits retraités de la fonction publique. Donc l’incitation à acheter de coûteuses voitures électriques n’est pas audible et mal perçue.
Loin du cliché de l’écolo « bobo » urbain, la Confédération paysanne représente une écologie ancrée dans le monde du travail et dans les campagnes. Est-ce que le syndicat joue à vos yeux un rôle de pont entre certains milieux écologistes et le monde rural ?
À la Confédération paysanne, nous avons beaucoup de relations avec la société civile, c’est-à-dire la majorité des gens. Car les paysans représentent de moins en moins de monde dans les territoires. On se retrouve donc souvent dans des combats transversaux avec les syndicats de salariés – CGT, Sud. Et aussi avec France nature environnement ou les Amis de la Terre, dans l’opposition à des projets de photovoltaïque ou de construction sur des terres agricoles.

Mais la société civile ne connaît pas du tout le monde paysan. Il nous faut souvent réexpliquer comment on en est arrivé là, d’où viennent les agriculteurs, pourquoi ils ont ces pratiques. Il ne suffit pas de leur dire qu’il ne faut pas monter tel bâtiment industriel. Changer le système, alors que ça fait des générations qu’il fonctionne comme ça, c’est très long.
La Confédération paysanne s’est impliquée ces dernières années dans plusieurs luttes écologistes emblématiques, avec parfois des modes d’action radicaux, comme celle contre les mégabassines. Comment cet engagement est-il perçu dans le monde agricole ?
Nous militons à la Conf’ pour le bon usage de l’eau, sa juste répartition, on s’est donc beaucoup engagé contre les projets de mégabassines. Ça a suscité de fortes réactions, notamment dans mon département. Le Gers est un territoire sec, chaud, il y a donc beaucoup d’agriculteurs qui irriguent. À la session de la chambre d’agriculture qui a suivi Sainte-Soline [en mars 2023, NDLR] les commentaires virulents ont fusé, évidemment. Et encore, les autres élus syndicaux [FNSEA et Coordination rurale, NDLR] ne m’ont pas emmenée vers la sortie parce que je suis moi-même irrigante.
Le débat sur l’irrigation n’est pas le même à Sainte-Soline et dans le Gers, c’est toute la complexité. J’ai dû expliquer que les mégabassines n’avaient rien à voir avec ce qui est pratiqué dans le département. Ici, ce sont des retenues collinaires, qui sont remplies par les bassins versants, avec un quota d’eau attribué, contrôlé, que l’on essaye de répartir au mieux.
Et de l’autre côté, j’avais des associations environnementales et des jeunes des Soulèvements de la Terre, qui me disaient : « Celui-là, il arrose, on va lui éteindre son enrouleur. » Je leur disais : « Non là, vous n’avez pas compris. » De l’eau, certains agriculteurs en ont besoin pour leurs cultures. Il faut savoir pour quelle culture, d’où vient cette eau, et rien ne dit qu’il en est fait un usage excessif. D’autant que personne ne questionne par ailleurs la consommation d’eau d’une usine de lait végétal qui vient d’ouvrir, ou le fait qu’une partie de l’eau du Gers va refroidir la centrale nucléaire de Golfech.
Il est important de reposer la question des usages, sinon on stigmatise uniquement les pratiques agricoles. Il faut qu’on soit ensemble, comme c’est le cas par exemple avec les Amis de la Terre, qui siègent à nos côtés dans une institution comme le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) pour discuter les volumes d’eau, les arrêtés d’interdiction pour préserver la ressource, lorsqu’il faut par exemple maintenir l’étiage des rivières pour protéger la faune et la flore. La Conf’ n’est pas contre tout. Nous disons simplement qu’il y a des priorités dans l’arrosage.
Y a-t-il parfois à vos yeux de la maladresse dans les modes d’action des mouvements écologistes ?
Le citoyen militant associatif peut parfois agir de façon très stigmatisante. Aller couper un tuyau d’irrigation dans un champ, cela crée des dégâts. C’est de l’eau qui va s’écouler toute la nuit, et cela risque de brûler une pompe d’irrigation. Ça peut même être dangereux pour les gens autour.
Autre exemple : j’ai eu un dialogue avec des militants de l’association Résistance aux fermes usines (Rafu) qui voulaient bloquer les camions de volailles à l’abattoir de Condom, où sont tuées 60 000 volailles par jour. Mais si vous bloquez ces camions, dans l’heure qui suit, toutes les volailles meurent dans les caisses, donc vous créez de la souffrance animale. À mes yeux, ce n’est pas là qu’il faut agir mais en amont, contre la construction de ces bâtiments industriels. Cela dit, il y a un vrai problème de démocratie concernant les projets contestés, car les travaux commencent avant la fin du processus juridique, comme c’est le cas pour l’A69.

Les recours ne sont pas terminés que déjà il y a des pelleteuses qui détruisent des arbres, des haies, des zones humides. Et ça c’est irréversible. C’est pour cela qu’on est obligés d’intervenir rapidement. Or dans l’actuel projet de Loi d’orientation agricole3, il est prévu de limiter encore le temps des recours, pour que la société civile n’ait pas le temps de se mobiliser.
En janvier 2025 se dérouleront les élections pour renouveler les représentants syndicaux dans les chambres d’agriculture. Pouvez-vous expliquer comment les règles de ce scrutin favorisent le statu quo agricole ?
Avec la Confédération paysanne, nous recueillons à peu près 20 % des voix, que ce soit dans le Gers ou au niveau national. Mais l’élection à la chambre d’agriculture n’est pas une vraie proportionnelle, car le syndicat arrivé premier rafle la majorité des sièges. Donc, par exemple à la chambre du Gers, avec 20 % des voix, je suis la seule élue de la Conf’ à siéger sur 18 représentants. Et cela se répercute sur le mode de financement des syndicats, dont 25 % est attribué en fonction du nombre d’élus.
La Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) est ainsi quasiment sûre d’emporter les majorités de chambres. Et ensuite on leur donne une voix prépondérante dans toutes les institutions agricoles : les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer), les organisations de filières, France Agri Mer… Et quand le ministère lance une étude, il s’adresse en priorité au syndicat majoritaire.
Au-delà des biais du jeu électoral, une large partie des agriculteurs semble accepter la FNSEA comme porte-parole. On sait pourtant que les dirigeants du syndicat majoritaire, comme Arnaud Rousseau, président du conseil d’administration du groupe agro-industriel Avril4, sont plus des hommes d’affaires que des paysans. Comment expliquez-vous le maintien de son influence ?
Monsieur Rousseau, avec son côté très libéral – opposé aux normes écologiques, favorable aux projets de méthanisation et d’agrivoltaïsme – dit des choses que certains sont très contents d’entendre. Ils sont vieux, isolés, fatigués, donc ils ne veulent pas se compliquer la tâche. Surtout, beaucoup ont fait une croix sur le fait que leurs enfants reprennent leur ferme. Ils n’ont plus cet horizon de transmission de la terre et de l’outil.
Le syndicat majoritaire est un syndicat d’égoïstes. Ses membres ne pensent pas au-delà de leur génération. Ils sont en rupture avec les jeunes agriculteurs, notamment sur la question du foncier.
L’ensemble des syndicats agricoles convergent dans l’opposition à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur. L’horizon d’une relocalisation de l’agriculture fait-il consensus au sein du monde agricole ?
Ça devrait faire consensus. Mais il y a beaucoup d’hypocrisie. Certains – comme la FNSEA ou la JA (Jeunes agriculteurs, proches de la FNSEA) – s’affichent contre les accords, en expliquant que dans le Mercosur on utilise des produits interdits en France. Mais le même jour, des membres de ces syndicats érigent dans l’Oise un mur de béton pour entraver l’activité des agents de l’Office français pour la biodiversité (OFB), parce qu’ils sont en réalité opposés aux normes environnementales. La FNSEA, dans tous les débats autour de la Loi d’orientation agricole, appuie d’ailleurs un usage renforcé des pesticides, notamment de substances utilisées en Espagne.
Alors qu’à la Conf’, nous considérons que les conditions d’exploitation de la terre et des salariés dans le Mercosur créent non seulement une concurrence déloyale, mais surtout fatale pour l’environnement et la santé de tout le monde. Y compris des travailleurs brésiliens dans les usines de découpe de poulet qui n’ont pas de pause de midi, ou des voisins des champs de soja qui voient leur eau polluée à l’atrazine [herbicide interdit en Europe, NDLR]. Nous ne voulons pas de concurrence entre les peuples, mais d’une souveraineté alimentaire inscrite dans une démarche de localisation de la production.

Il faut redonner aux agriculteurs le sens de leur métier. Et d’abord le rôle de protéger leur terre. Cette terre ne nous appartient pas, elle appartient aux générations futures.
Comment, tout en étant minoritaire, la Confédération paysanne contribue-t-elle néanmoins à transformer le monde rural ?
Nous avons la chance d’accompagner, grâce à nos structures, comme la Fédération de l’agriculture et du développement agricole et rural (Fadear), de nombreuses installations de néo-ruraux, de personnes en reconversion professionnelle sur le tard, parfois à 35 ou 40 ans. Presque 30 % des agriculteurs sont installés par nos structures. Ces jeunes réussissent, alors qu’ils sont les moins aidés de la Politique agricole commune (PAC), parce qu’ils sont sur des productions de maraîchage ou de volailles. Je ne dis pas que c’est facile.
Mais on propose ainsi au consommateur un produit de qualité, localisé, qui est moins cher qu’au supermarché parce qu’il n’y a pas d’intermédiaires. Et ce sont des agriculteurs novateurs, qui créent des outils de transformation, qui s’installent en collectif. Ils ont tout compris ! Il faut faire société, dans l’outil et le travail au quotidien. Cela leur permet de se relayer sur les marchés, d’avoir davantage de temps pour militer, accueillir des migrants, avoir une activité socioculturelle sur la commune. Dans ma génération – moi qui suis fille d’agriculteur – on travaillait en famille et avec les voisins, et tout cela faisait société. Aujourd’hui, ces jeunes renouvellent les liens au sein du monde rural.
1.La Via campesina (« La Voie paysanne » en espagnol) est un mouvement altermondialiste qui coordonne des organisations de petits et moyens paysans et de communautés autochtones du monde entier.
2. Location avec option d’achat d’un bien d’équipement (voiture, tracteur).
3. Adopté par l’Assemblée nationale, ce projet de loi doit être débattu au Sénat début 2025.
4. « FNSEA : Arnaud Rousseau, un agro-industriel à la tête du syndicat agricole », Le Monde, mars 2023.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don