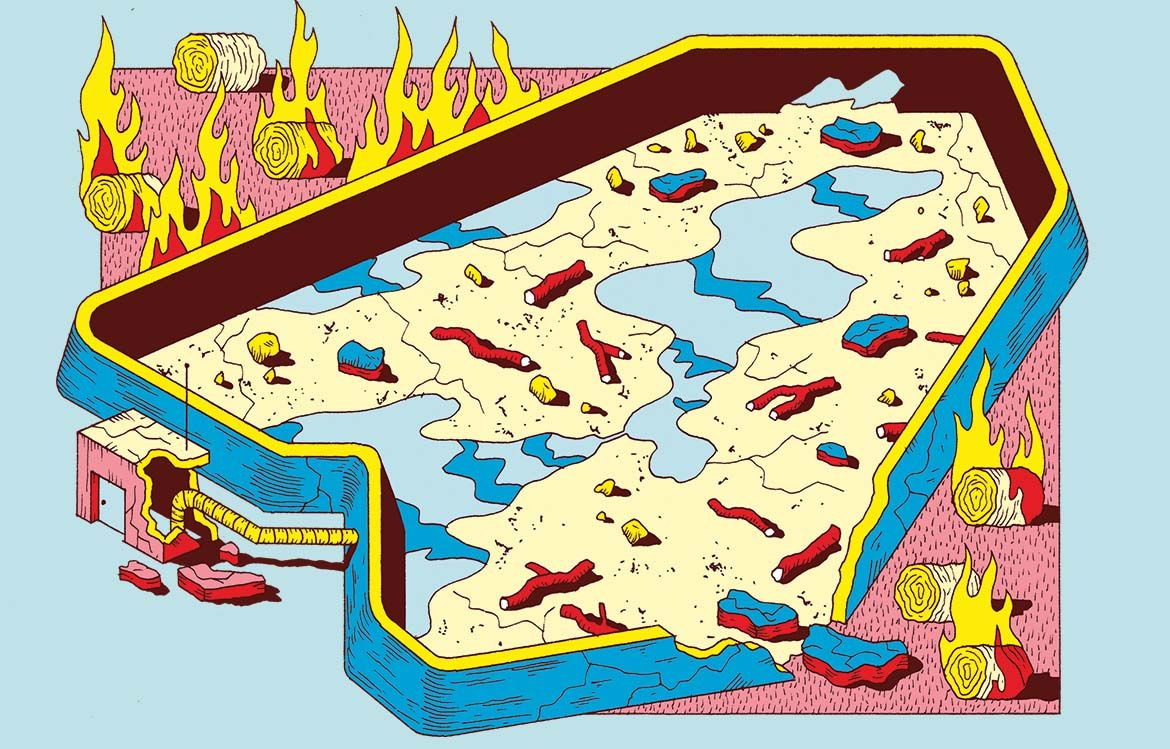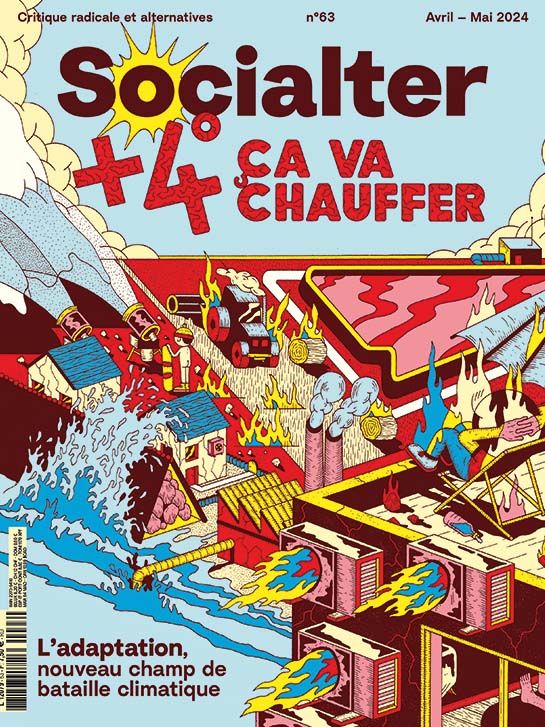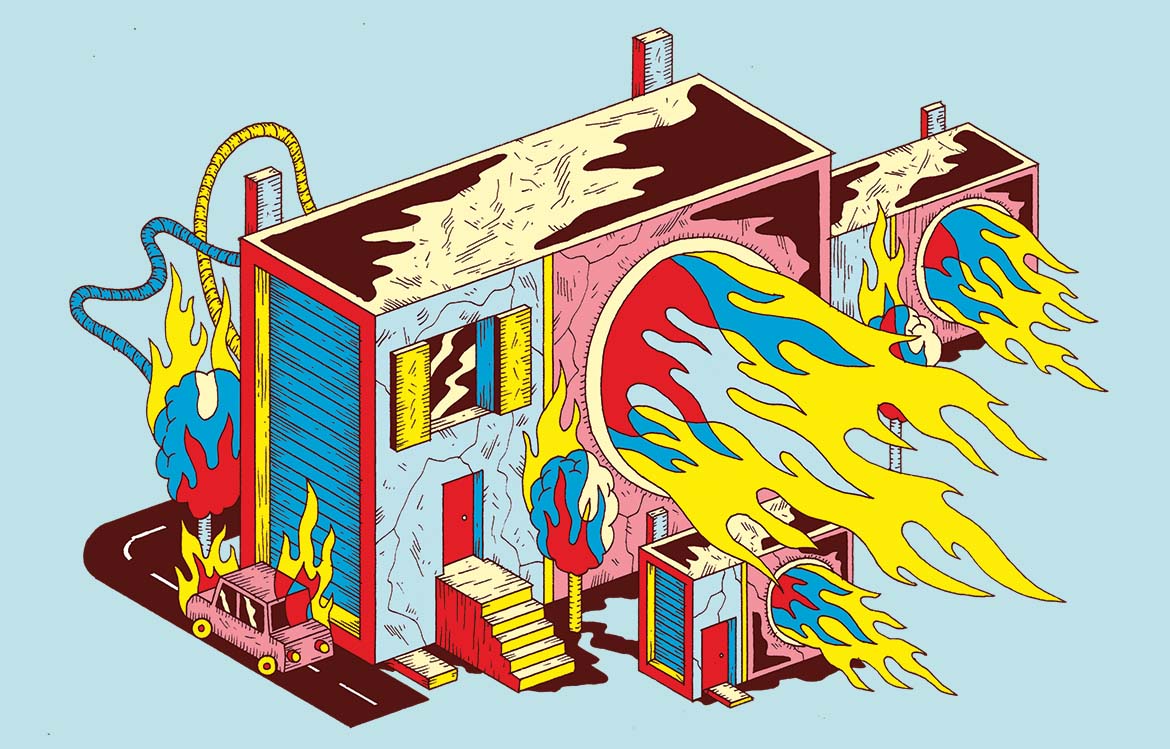Le terme de « maladaptation » désigne une adaptation au changement climatique qui aggrave en réalité la situation, par sa consommation d’énergie (carbonée), par ses autres impacts environnementaux (destruction d’écosystèmes, extraction de matières), en transférant les contraintes sur d’autres acteurs ou encore en augmentant la vulnérabilité sur le long terme.
Article issu de notre numéro 63 « +4°, ça va chauffer ! », en librairie et sur notre boutique.
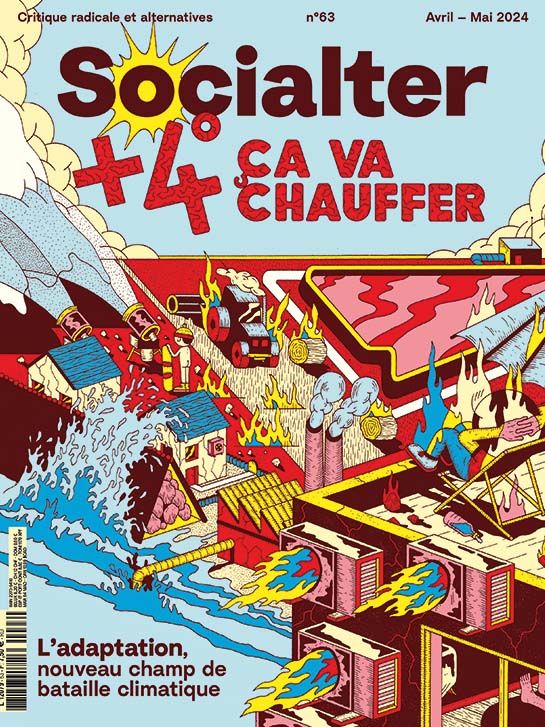
Elle témoigne d’une vision de court terme, d’un refus de questionner les modèles en place et d’une « sur-confiance dans les moyens économiques et la technologie pour tout régler », selon Alexandre Magnan, chercheur à l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) et ancien membre du GIEC. Mais aussi, comme le pointe Vincent Viguié, spécialiste des politiques climatiques, d’« un manque d’adaptation planifiée en amont par les pouvoirs publics », souligné encore récemment par le dernier rapport de la Cour des comptes. Plusieurs réponses actuelles au changement climatique, soutenues à grand renfort d’argent public, constituent des cas d’école de cette maladaptation.

Mégabassines : Main basse sur la ressource
Il s’agit sans doute de l’exemple le plus emblématique. Les mégabassines, ou « retenues de substitution », sont devenues en très peu de temps l’objet d’un débat national, à la faveur des mobilisations lancées par le collectif Bassines Non Merci et Les Soulèvements de la Terre. Ces retenues imperméabilisées et bâchées, de grande taille (entre 8 et 18 hectares, soit jusqu’à l’équivalent de 300 piscines olympiques), sont destinées à puiser de l’eau dans les nappes phréatiques en hiver pour répondre à la raréfaction de la ressource en été, due notamment au réchauffement climatique. En raison de leur gigantisme et de leur coût, elles sont portées par des groupements d’exploitants agricoles de grande taille, qui pratiquent une agriculture intensive gourmande en intrants et en eau. Bien qu’initiées par des acteurs privés, elles sont largement financées par la collectivité. Ainsi, le coût des 16 mégabassines prévues dans le Marais poitevin, dont celle de Sainte-Soline, s’élève à 76 millions d’euros, dont 70 % de fonds publics.
Ces retenues de substitution cochent toutes les cases de la maladaptation dans la mesure où elles sont synonymes d’un accaparement de la ressource par une poignée d’acteurs, 7 à 10 % selon Vincent Bretagnolle, directeur de recherche au CNRS. Elles n’incitent aucunement à remettre en question un modèle agricole qui met à mal le cycle de l’eau et ne visent qu’à répondre au court terme. Rien n’assure en effet que l’on puisse remplir ces bassines si le niveau des cours d’eau et des nappes continue à baisser, situation à laquelle nos voisins espagnols sont confrontés. « Les premières bassines en France, c’était il y a 20 ans en Vendée, complète Vincent Bretagnolle, mais elles étaient dix fois plus petites. La première mégabassine, c’est celle de Mauzé-sur-le-Mignon, terminée depuis 2021. C’est très récent et les études manquent encore. ».
Toutefois, pour l’hydrologue Sylvain Kuppel, membre de l’Atelier d’écologie politique (Atécopol), cette absence de recul scientifique n’empêche pas de formuler plusieurs hypothèses. Les mégabassines illustreraient ainsi un « effet réservoir » qui nous pousse à construire toujours plus de réserves pour répondre aux sécheresses, jusqu’au moment où il ne serait plus possible de le faire. Elles créent un « effet rebond », une consommation accrue d’eau, et actent un « verrouillage socio-technique » : « On met des fonds sur certaines solutions et cela empêche d’explorer d’autres choix possibles. »

Désalinisation : La « soupe » au chaud
Les usines de désalinisation de l’eau de mer sont une autre réponse, technologique, à la montée du stress hydrique. En 2022, on comptait 21 000 stations de désalinisation dans le monde, deux fois plus que dix ans auparavant. Le secteur est en plein boom avec une croissance de capacités de l’ordre de 6 % à 12 % par an, selon un rapport de l’Institut français des relations internationales (IFRI). Deux techniques coexistent, l’une par distillation, qui consiste à faire chauffer l’eau de mer, l’autre par « osmose inverse », qui met l’eau sous pression et la fait passer dans des membranes pour la filtrer.
Dans les deux cas, le procédé se révèle très énergivore. En Arabie saoudite, où 70 % de l’eau provient de la désalinisation, la consommation électrique du secteur a été multipliée par trois entre 2005 et 2020, avec un recours massif aux énergies fossiles. « C’est une spirale infernale, pointe l’hydrologue Christophe Mori de l’université de Corse, on augmente massivement la production de gaz à effet de serre, qui aggrave le problème du réchauffement et va nous inviter à faire de la désalinisation ailleurs. On ne s’en sort pas et on se retrouve avec des situations comme celle de Chypre où 15 % de la consommation d’électricité est absorbée par la désalinisation et où un projet de pipeline pétrolier avec la Turquie est sur la table pour alimenter les usines. » Les énergies renouvelables, elles, ne fournissent que 1 % de l’électricité nécessaire à la désalinisation.
Ces usines de désalinisation génèrent aussi une pollution écologique en rejetant de la saumure, de l’eau plus salée, plus chaude et plus dense que l’eau de mer. Une « soupe », qui contient également de nombreux produits chimiques (anti-tartre, anti-mousse, stabilisateurs…). Ces rejets privent le milieu marin d’oxygène et mettent en danger tout un écosystème, notamment les herbiers marins, une espèce « clé de voûte ». « Si cette espèce s’effondre, c’est tout le système qui s’effondre », souligne Christophe Mori. Pour 20 millions de litres d’eau potable produits annuellement par désalinisation, 30 millions de litres de saumure sont rejetés à la mer. « C’est un modèle insoutenable, un aveu d’échec total de notre gestion de l’eau », conclut le chercheur.

Digues : La solution béton
Face aux risques d’inondations et de submersion marine, la construction de digues reste aujourd’hui la solution la plus plébiscitée. Selon une étude du Commissariat général au développement durable (CGDD) et de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), environ 20 % du littoral français est couvert par des ouvrages artificiels, soit 1 600 kilomètres de côtes. Comme souvent avec la maladaptation, ce n’est pas tant la technologie en elle-même qui est mauvaise que sa systématisation. « Rehausser une digue existante à New York, ce n’est pas en soi de la maladaptation, souligne ainsi Alexandre Magnan, spécialiste de l’adaptation au changement climatique, car vous ne pouvez pas déplacer New York ni vous limiter à planter de la végétation. »
La construction de digues est toutefois une réponse de court terme et procure un dangereux sentiment de sécurité. « On érige une digue et on se dit qu’on est protégé, poursuit le chercheur, sans penser à son entretien sur des décennies, ni à son financement, ni au fait qu’on ne pourra pas les rehausser indéfiniment. » Car les digues coûtent cher, s’érodent et se fissurent, comme ce fut le cas à La Nouvelle-Orléans avant le passage de l’ouragan Katrina, où la construction d’ouvrages de défense avait permis d’urbaniser toujours plus, en négligeant les risques d’inondation. La digue a également un coût environnemental. Elle requiert de la matière, notamment du sable, de plus en plus rare.
Face à ces limites, d’autres solutions fondées sur la nature sont avancées : restaurer les récifs coralliens, qui permettent de briser la force des vagues, planter de la mangrove et de la végétation pour stabiliser le sable… ou opter pour un « retrait stratégique », c’est-à-dire déplacer les populations des zones à risque. « Pour moi c’est la grande solution même si c’est une décision difficile à prendre, avance Alexandre Magnan. Aujourd’hui, cette option est sur la table. »
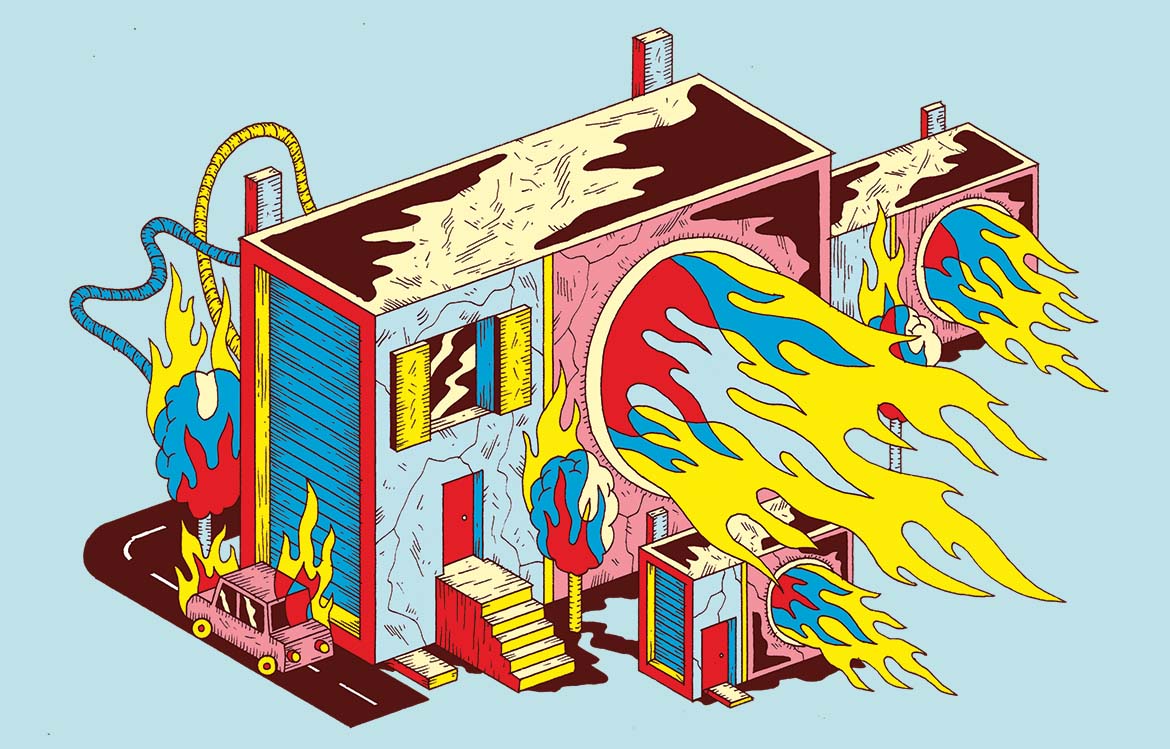
Climatisation : Les autres en font les frais
« Si tout le monde utilisait la climatisation en Île-de-France, lors d’une canicule comparable à celle de 2003, on augmenterait de deux degrés la température dans les rues en raison des rejets d’air chaud », nous livre Vincent Viguié, chercheur en économie du climat au Centre international de recherches sur l’environnement et le développement (Cired). Ce faisant, on aggraverait la canicule pour ceux qui vivent dehors, travaillent en extérieur ou n’ont pas les moyens ou l’envie d’avoir recours à la climatisation. Nous sommes ici dans un cas exemplaire de « transfert d’impact ».
Face au réchauffement climatique, le recours à la climatisation explose en tout cas en France. Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), 25 % des foyers étaient équipés en 2020, contre seulement 5 % en 2005. Un chiffre, en hausse, qui ne rivalise pas encore avec les 90 % des États-Unis. Si la climatisation peut s’avérer indispensable dans certaines situations, pour les hôpitaux ou maisons de retraite, sa généralisation confine à la maladaptation. Car les climatiseurs rejettent non seulement de l’air chaud – deux fois plus qu’ils ne produisent d’air frais – mais demandent aussi beaucoup d’électricité, 10 % de la consommation mondiale aujourd’hui, et laissent s’échapper des fluides réfrigérants, gaz à effet de serre, en raison de fuites. Les systèmes électriques ne sont de surcroît pas conçus pour répondre à une hausse de la demande estivale, dans une période où l’eau est moins disponible pour les centrales nucléaires et les barrages.
Si les climatiseurs se développent tant, c’est qu’ils sont une réponse individuelle face au changement climatique, là où des approches collectives, plus égalitaires et écologiques, pourraient être développées. La liste est longue : changements dans les modes de vie par voie réglementaire, pour travailler par exemple aux heures les moins chaudes ; isolation des logements ; toits et surfaces qui reflètent la chaleur ; végétalisation des villes ; ou bien encore diminution des activités humaines les plus productrices de chaleur (voitures notamment)… « Dans plein de pays chauds, pensons au Maghreb, on a vécu longtemps sans climatisation, rappelle Vincent Viguié, on sait faire ! Mais pour qu’il n’y en ait pas, il faut des politiques adaptées. »

Canons à neige : Skier plus blanc que blanc ?
En 2022, 39 % des pistes de ski françaises avaient recours à de la neige de culture, selon les chiffres des Domaines skiables de France. En Auvergne-Rhône-Alpes, un objectif de 70 % de taux de couverture a été annoncé en 2021 par le président de région Laurent Wauquiez. Face à la baisse de l’enneigement et des températures qui augmentent, la production de neige artificielle serait la planche de salut d’une industrie du ski qui n’entend pas mourir, et devrait permettre, aux dires des professionnels, de continuer à slalomer paisiblement jusqu’en 2050. « Cette date est un trompe-l’œil, affirme Hugues François, chercheur à l’INRAE de Grenoble, car les situations seront très différentes selon les lieux, en fonction de l’altitude et de la latitude. La production de neige de culture est en premier lieu tributaire des températures. »
Si différentes techniques existent aujourd’hui, la principale consiste à projeter des micro-gouttelettes d’eau dans l’air afin qu’elles congèlent instantanément. Pour ce faire, il faut du froid, un air sec et pas de vent. Surtout, cette production vient capitaliser sur la neige déjà tombée. S’il ne neige pas ou que les températures sont trop élevées, produire de la neige de culture n’a plus de sens. « On ne peut pas exploiter durablement un domaine skiable en ne produisant que de la neige de culture », résume ainsi Hugues François. L’équation se complexifie encore quand on sait que la production de neige nécessite de l’eau.
Si les Domaines skiables de France évoquent « 25 millions de mètres cubes pour toutes les stations françaises », soit six fois et demie moins que le remplissage des piscines individuelles dans l’Hexagone, les conflits d’usage ne manquent déjà pas dans un contexte de stress hydrique. Hugues François entrevoit la production de neige comme une solution transitoire : « La neige de culture peut permettre de consolider temporairement une filière, mais elle doit accompagner une transition. »
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don