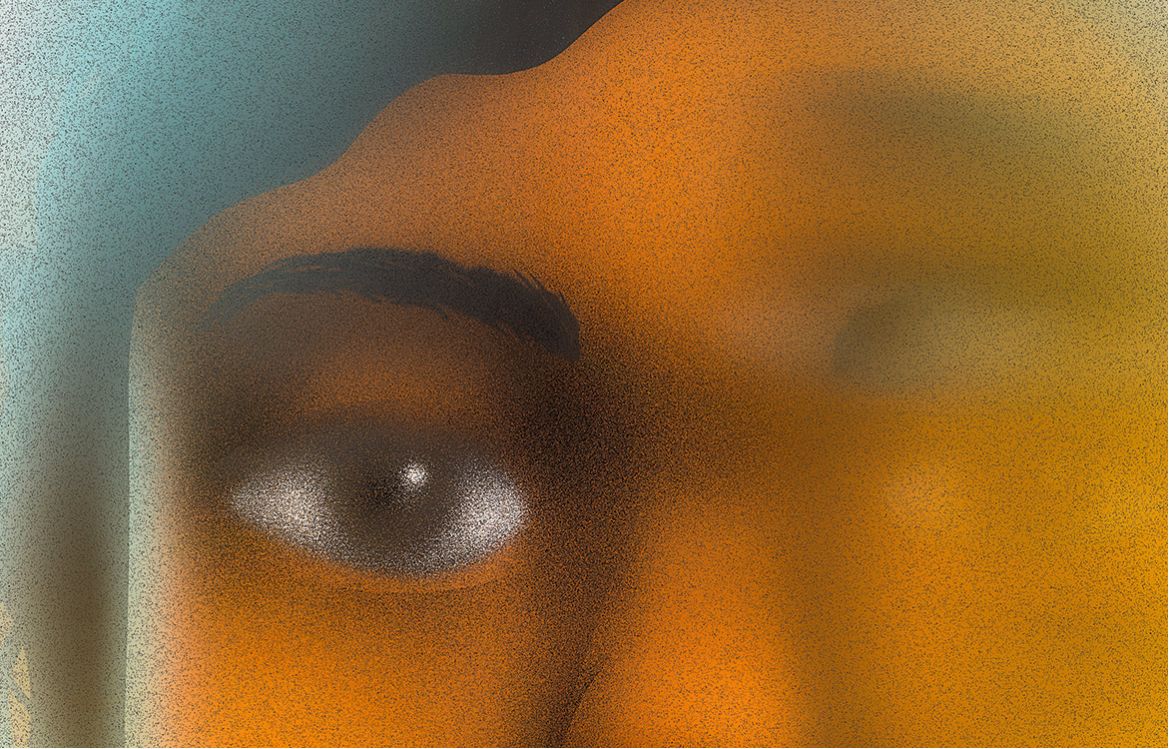Le discours universaliste occidental opère-t-il une dépossession historique, en Afrique comme ailleurs ?
Il peut sembler surprenant, pour certains, d’envisager l’universalisme comme une forme de dépossession, ou comme un discours masquant une perpétuation de la violence. Et cet étonnement est compréhensible, puisque l’universalisme, en tant qu’il stipule qu’il existe des valeurs communes à l’humanité tout entière, par-delà les différences culturelles, porte l’idéal puissant d’une commune émancipation. Mais, au-delà de son contenu, il faut être attentif aux usages du terme. Rapporté à la situation coloniale, un certain usage du discours universaliste a permis de soutenir l’idée que l’Europe constituait un modèle pour l’humanité, puisqu’elle en réalisait l’essence. Les espaces non européens sont dès lors apparus comme des lieux de l’arbitraire, ne produisant du sens que de façon accidentelle. Se loge ainsi, dans le langage de l’universalisme, une synecdoque (cette figure de style dans laquelle la partie est prise pour le tout) : le mot « Europe » signifie le « monde », et les peuples européens incarnent l’humanité. L’universel apparaît comme une simple généralisation du particulier. Par ailleurs, toute énonciation de l’universel est piégée dans la situation de celui qui l’énonce, produisant de façon intrinsèque de l’exclusion. C’est précisément ce démontage du discours de l’universalisme que l’on retrouve dans de nombreuses pensées contemporaines critiques, en particulier les études féministes et de genre, mais aussi décoloniales et postcoloniales.
La notion d’universalisme est-elle définitivement disqualifiée par cet usage, selon vous ?
Pour certains penseurs, l’idée d’universalisme est tellement piégée qu’il est devenu impossible de se l’approprier, elle ne peut plus devenir ce à partir de quoi un discours émancipateur peut être tenu ; pour d’autres, les critiques de la notion invitent à la reprendre et à la corriger. L’universel ne peut plus se polariser autour d’un particulier qui surplombe les autres ; il doit apparaître comme une visée, soit une ouverture à tous les particuliers. Plusieurs relectures de l’universalisme ont déjà pris en charge ces critiques, en tentant de le renouveler sans prétendre définir en amont ce qu’est l’humain. Aimé Césaire (1913-2008), dans sa lettre de démission du Parti communiste en 1956, distingue l’universel conquérant et dominateur (celui de la synecdoque) d’un autre universel, riche de tous les particuliers. Pour ma part, je considère que ce travail de reconstruction critique de l’universalisme a déjà été fait de manière puissante et définitive par des intellectuels comme Aimé Césaire ou d’autres penseurs de la négritude. La querelle des universalismes m’apparaît close. On peut ainsi passer à autre chose.
Quelles conséquences cette façon de mobiliser l’universel a-t-elle eu sur la façon dont les Européens ont appréhendé le continent africain ?
Des préjugés sont nés de l’idée que l’Europe était le lieu tenant de l’universel, produits par de nombreux acteurs (savants, explorateurs, militaires, etc.) à l’époque coloniale (XIXe siècle), qui ont soutenu qu’il fallait civiliser les espaces non européens. Concernant le continent africain, ces préjugés ont forgé l’idée selon laquelle l’Afrique et l’humanité africaine n’auraient jamais pris part à l’histoire du monde. Continent du particulier et de l’immédiateté, l’Afrique ne pourrait ainsi jamais faire signe vers l’universel. Cette manière d’appréhender depuis l’Europe le continent africain est toujours perceptible aujourd’hui. Ce signe africain est un marqueur de subalternité. Il faut ainsi réfuter ces discours tout en élaborant d’autres pensées capables de rendre justice à des savoirs, des productions de signification qui ont trop souvent été déconsidérées.
Dans plusieurs textes, vous avez interrogé l’idée de « miracle grec ». Cette expression, qu’on retrouve entre autres sous la plume d’Ernest Renan à la fin du XIXe siècle, est passée à la postérité pour situer l’origine de « la civilisation » en Grèce, au Ve siècle avant notre ère. Quel problème pose cette expression, notamment pour notre conception de l’histoire des idées ?
Cette formule a été largement revue et critiquée par les hellénistes eux-mêmes, notamment par Jean‑Pierre Vernant (1914-2007). Le travail qui m’importe s’attache plutôt à ce qu’implique l’idée de « miracle grec » dans notre manière d’appréhender les géographies de la vie de l’intelligence et de l’esprit. Comment cartographie-t-on la pensée quand on donne une consistance à cette formule de « miracle grec » ? Cette expression, qui se forge à partir d’un vocabulaire théologico-religieux, suppose qu’il existe un lieu d’élection pour la pensée, et que tous les autres espaces du monde sont des déserts. S’il y a eu « miracle », c’est qu’il n’y a rien eu avant ; il se serait produit, en Grèce, un surgissement de la rationalité dont on ne peut, paradoxalement, pas rendre raison : l’éclosion de la philosophie ne serait pas contingente, mais relèverait d’une exception signalant l’émergence de la civilisation. En nourrissant un tel récit sur l’exceptionnalité grecque, on rate des circulations de la pensée, des métissages, à l’intérieur du bassin méditerranéen par exemple, qui ont contribué à la constitution du discours philosophique au Ve siècle avant J.-C.
Par ailleurs, cette formule impose des généalogies et des filiations philosophiques : la raison n’aurait suivi qu’une seule route, celle qui va de la Grèce aux grandes nations de l’Ouest européen. Or, les idées, la raison, ont aussi emprunté d’autres itinéraires, dans les mondes arabes, en Chine, en Inde, en Afrique… Les mondes non européens ne sont pas des lieux rétifs à l’activité pensante, libre et rationnelle. Pourtant, nous appréhendons encore trop souvent la philosophie à partir d’un canon qui se construit sur des gestes d’exclusion. L’histoire de ces gestes d’exclusion (des pensées arabes, chinoises par exemple) a été faite par de nombreux historiens des idées, de la philosophie. L’idée persiste, pourtant, que l’idée de « philosophie » devrait toujours faire signe vers l’Europe. Critiquer l’idée d’un « miracle grec », c’est surtout interroger la manière dont s’est formé, historiquement, le canon classique de la philosophie tel qu’on l’enseigne en Europe, et chercher à l’ouvrir, à l’éclater.
« Déconstruire cette histoire de la philosophie, c’est paradoxalement la réhistoriciser », avez-vous écrit. Qu’entendez-vous par là ?
Il existe une essentialisation de la philosophie, qui l’inscrit exclusivement dans l’espace européen. « Réhistoriciser » l’histoire de la philosophie, c’est ainsi la dés-essentialiser. Il faut ainsi être attentif à de nouvelles spatialisations de la pensée, mais également comprendre comment, en Europe, la philosophie s’est constituée historiquement comme une discipline codée axiologiquement. Pour saisir une partie de la longue histoire intellectuelle du continent africain, des travaux comme ceux d’Ousmane Kane dans Beyond Timbuktu: An Intellectual History of Muslim West Africa(Harvard University Press, 2016, non traduit) ou encore du philosophe Souleymane Bachir Diagne apparaissent fondamentaux : ils retracent des itinéraires intellectuels qui ouvrent d’autres archives, non européennes, de la philosophie.
Comment mettez-vous en pratique cet enseignement d’une autre histoire de la philosophie dans vos cours à l’université Paris-VIII ?
Je considère que l’idée de philosophie ne recouvre pas toutes les expériences de la pensée. Je fais donc des cours de philosophie dans lesquels j’enseigne des auteurs considérés comme classiques dans l’enseignement supérieur. Mais je travaille également sur d’autres archives de l’intelligence et de l’esprit, non européennes cette fois : des auteurs classiques de la philosophie africaine contemporaine, comme Boulaga ou Mudimbe. Certains auteurs et certaines auteures que j’aime étudier ne collent pas nécessairement avec la normativité du canon de la discipline philosophique telle qu’on peut se la représenter. Certains grands textes des pensées noires américaines ou caribéennes du XXe siècle entremêlent des registres de discours différents, à la croisée de la parole poétique, de la méditation religieuse ou encore de l’engagement politique. Il est toujours intéressant de voir ce que l’entremêlement de ces registres de langage fait à la philosophie, ou encore comment il produit des problèmes qui, en retour, affectent la manière dont on se la représente et la définit.
Plus que « déconstruire », vous parlez plutôt d’une « décolonisation » du savoir : quelle différence faites-vous entre ces deux pratiques ?
Je préfère le terme « démontage » à celui de « déconstruction », qui appartient au lexique de la philosophie de Jacques Derrida (1930-2004). Quand j’emploie ce terme, c’est pour parler, ici encore, de la manière dont le canon philosophique s’est constitué normativement, distinguant les discours dignes d’elle et excluant les autres. La distinction que je fais entre une pratique de démontage et la « décolonisation » de la philosophie peut s’expliciter comme suit : un des effets positifs du démontage, c’est l’intégration. Le démontage du canon n’invite pas nécessairement à remettre radicalement en cause la normativité du discours philosophique, il s’agit essentiellement de l’assouplir en l’élargissant – soit accueillir sous le nom « philosophie » des écritures et des discours qui en avaient d’emblée été exclus (pratiques orales, textes produits en langues non européennes, etc.). C’est une pratique presque cannibale, qui consiste à avaler l’autre, et parfois même à le domestiquer, le contrôler. Elle se satisfait d’ailleurs pleinement de l’injonction à la nouveauté, qui traverse une vision marchande du savoir dominant l’université à l’échelle globale.
Or, l’enjeu de la « décolonisation du savoir » (ou « décolonisation épistémique ») ne consiste pas à vouloir étendre un canon préexistant en y intégrant des voix ignorées. La décolonisation comporte une dimension critique radicale : elle interroge les injustices épistémiques à l’œuvre dans les disciplines, les modes de légitimation à partir desquels les sujets et les objets du savoir sont reconnus ou déconsidérés. Sa visée n’est pas nécessairement l’intégration, mais plutôt l’écart : produire d’autres espaces de savoir, qui ne prennent pas nécessairement en charge le devenir des disciplines telles que nous les connaissons. Pour dire les choses simplement, décoloniser la philosophie, par exemple, ce n’est pas se sentir responsable du devenir de la philosophie en tant que telle. C’est faire constamment un pas de côté, quitte, pour le dire comme Fabien Eboussi Boulaga, à évoluer dans un « espace sans nom ». Cette approche de la décolonisation épistémique interroge nos institutions de connaissance. Il n’est pas sûr que le lieu d’une telle pratique soit effectivement l’université telle que nous la connaissons.
Face à une histoire africaine marquée par la violence, vous avez développé l’idée de laetitia africana, lors de la première édition des « Ateliers de la pensée » initiés par le philosophe Achille Mbembe et l’écrivain Felwine Sarr à Dakar, en 2016. En quoi cette idée peut-elle donner des armes pour se projeter vers l’avenir sans escamoter cette mémoire troublée ?
L’idée de laetitia africana est issue d’une longue méditation de l’œuvre d’Aimé Césaire, mais elle est aussi inspirée par le parcours intellectuel et politique de Patrice Emery Lumumba [figure de la lutte contre le colonialisme, assassiné au moment de l’indépendance du Congo, en 1961, ndlr]. J’ai produit cette notion car je souhaitais sortir d’un discours de la mélancolie et du deuil que l’on retrouve dans de nombreuses écritures postcoloniales : l’enjeu consiste à mettre en lumière les langages utopiques qui se sont constitués dans les mondes africains et diasporiques confrontés à l’expérience de la perte et du deuil. L’idée n’est pas de défendre un nouvel optimisme mais d’être attentif aux expériences de création qui demeurent, malgré la défaite, le sang et le meurtre. L’écrivain congolais Yoka Lye possède une belle expression pour désigner cela : être sensible aux « signes de vie ».
Vous êtes vous-même née à Bruxelles d’une mère franco-italienne et d’un père congolais. En quoi le fait d’être issue de la diaspora nourrit-il votre pensée ?
Ce que j’aime dans l’idée de diaspora, c’est qu’elle permet une désaffiliation du « national ». Elle comporte une utopie politique, comme l’ont montré les auteurs Stuart Hall ou Paul Gilroy : démanteler les catégories nationalistes et identitaires. Mais ce qui m’interpelle dans la condition diasporique, c’est non pas la question de l’identité (« Qui suis-je ? ») mais celle de la territorialité (« Quel est mon territoire, l’espace où j’habite ? »). C’est la question de la double présence, du fait d’habiter deux lieux – au moins – en même temps, d’habiter deux mondes. Je considère que j’ai deux territoires d’ancrage (la France et la République démocratique du Congo) ; je n’interprète pas cette dualité sur un mode mélancolique, c’est-à-dire comme une déchirure entre deux lieux d’appartenance, ou encore un écartèlement identitaire.
Entre ces deux lieux se déploie une ligne de partage géopolitique : la ligne Nord/Sud, qui porte avec elle toutes les inégalités et les prédations possibles. La question qui se pose pour moi est très concrète : comment est-il possible de déployer également des conditions de vie dignes dans des mondes antagonistes, des mondes en conflit ? Les espaces dominés par des économies d’abondance se nourrissent des richesses produites dans des espaces prolétarisés, constitués comme réserves, ressources. Dès lors, qu’est-ce que cela peut vouloir dire, politiquement, que d’habiter à la frontière de tels espaces ? Repolitiser l’idée de diaspora, ce n’est pas la soumettre exclusivement au registre des questions liées à l’identité, à la définition du soi. Mais c’est plutôt poser la question suivante : comment habiter deux espaces dont l’un se nourrit de la mort de l’autre pour vivre ? C’est cette approche micropolitique de l’idée de « diaspora » qui m’intéresse ; elle installe de plain-pied dans les contradictions matérielles qui façonnent les inégalités de notre monde.
Justement, comment la laetitia africana pourrait-elle être une ressource philosophique pour affronter les enjeux écologiques et humains d’ores et déjà tragiques de notre siècle ?
J’ai du mal à considérer que tous les objets de pensée aient pour visée de produire un résultat sur le plan politique. Je dirais juste, sans rien prétendre de ce qu’on peut faire pratiquement de cette idée, que cette laetitia pointe l’émergence continue de la vie au milieu des ruines. Elle part du primat de la vie sur la mort. J’ai été très marquée par l’œuvre du chorégraphe congolais, Faustin Linyekula, intitulée More more more… future. Ce titre prend explicitement le contre-pied du mot d’ordre punk de la jeunesse occidentale des années 1970-1980 : no future. Le monde s’emballe sous l’effet d’une surproduction capitaliste sur laquelle reposent les nouvelles sociétés de consommation, et c’est précisément dans ces sociétés d’abondance qu’une jeunesse développe un discours de négation du futur. Or, More more more… future part de la perspective des jeunesses de Kinshasa qui, confrontées à la ruine du Congo postcolonial, ne peuvent accepter qu’on leur barre encore le chemin, pour produire des imaginaires qui fécondent le présent, l’avenir, malgré la défaite environnante ; et refuser de renforcer la mort là où la vie demeure malgré tout.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don